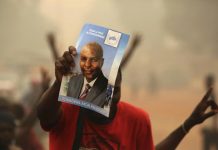Répété comme une évidence, le désarmement du Hezbollah reste un mot d’ordre creux, reflet d’une impasse stratégique et politique. Derrière les injonctions extérieures, c’est l’impossibilité d’agir, la paralysie de l’État et la crise du Liban qui se dévoilent.
Désarmer le Hezbollah : l’expression occupe, depuis des mois, le centre des débats diplomatiques, médiatiques et militaires sur le Liban. Présentée comme la condition sine qua non d’un retour à la souveraineté nationale, elle fait consensus parmi les partenaires occidentaux, les alliés arabes du Golfe, et bien sûr chez les dirigeants israëliens, qui n’ont jamais cessé d’exiger le retrait et le désarmement total de la milice chiite.
Pourtant, ce slogan, répété comme une évidence, masque une réalité beaucoup plus complexe : aucune des parties prenantes, y compris les plus favorables à ce désarmement, n’est en mesure d’en préciser les modalités, les garanties, ni d’en assurer la faisabilité à court ou moyen terme.
Le désarmement, un leitmotiv
Depuis la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies en 2006, qui a mis fin à la guerre de juillet entre Israël et le Hezbollah, le désarmement de toutes les milices au Liban, y compris le Hezbollah, figure sur l’agenda international et national. En pratique, ce dossier n’a jamais avancé d’un pouce. Ni l’État libanais, affaibli par des décennies de crise, ni la FINUL, dont le mandat est avant tout d’observer et de stabiliser la frontière, n’ont obtenu le moindre début de démantèlement de l’arsenal du Hezbollah, estimé par la plupart des experts à plus de 150 000 roquettes, drones, missiles antichars et systèmes sophistiqués répartis dans tout le Sud, mais aussi en banlieue sud de Beyrouth et dans la vallée de la Bekaa.
Aucune autorité n’est en mesure de dresser un inventaire exhaustif des capacités militaires du Hezbollah. Les services de renseignement libanais, sous-dotés et infiltrés par toutes les factions du pays, reconnaissent en privé leur ignorance des réseaux logistiques du parti. Même les agences occidentales admettent qu’en dehors d’une poignée de chefs connus, l’essentiel de la structure opérationnelle du Hezbollah demeure opaque. Cette opacité est une stratégie délibérée : le Hezbollah se présente à la fois comme acteur politique légal, détenteur de ministres au gouvernement, et comme acteur militaire souterrain, bénéficiant d’un système de commandement cloisonné, d’une discipline éprouvée, et du soutien logistique de l’Iran et de la Syrie.
L’injonction du désarmement, un instrument politique
À chaque crise, l’appel au désarmement ressurgit, brandi par les chancelleries étrangères, les organisations internationales et une partie des forces politiques libanaises. Mais ce mot d’ordre sert le plus souvent d’exutoire ou de diversion, plus que de solution. Pour Washington, Paris ou Tel-Aviv, exiger le désarmement permet de poser un cadre de négociation, de justifier sanctions et pressions diplomatiques, mais sans jamais définir ni calendrier ni mesures concrètes. Pour une partie des élites libanaises, réclamer le désarmement du Hezbollah, c’est déplacer le centre de gravité du débat politique et rejeter sur le parti la responsabilité de l’effondrement de l’État, sans assumer les faillites internes de la gouvernance.
À Gaza, la rhétorique israélienne d’un « démantèlement total du Hamas » a montré ses limites. Après des mois de guerre, l’armée israélienne a certes détruit des infrastructures, tué des commandants, mais la résistance armée persiste, le chaos s’est aggravé, et la population civile en paie le prix. Au Liban, la transposition de cette logique se heurte à des obstacles encore plus grands : la géographie, la topographie, la nature hybride du Hezbollah, et surtout la réalité confessionnelle et sociale du pays.
À quand une stratégie nationale?
Le désarmement du Hezbollah ne peut se concevoir ni comme un acte purement militaire, ni comme une décision imposée par l’extérieur. L’armée libanaise, qui incarne en principe l’unité nationale, n’a ni la volonté politique ni les moyens logistiques de s’attaquer frontalement au Hezbollah. La composition du commandement militaire, les équilibres internes, les réseaux de solidarité qui traversent l’institution, tout concourt à paralyser toute velléité d’affrontement. Aucun gouvernement libanais ne survivrait politiquement à une telle opération : les précédents historiques (1975, 1984, 2008) montrent que chaque tentative de marginaliser un acteur armé majeur débouche sur une explosion du système, des affrontements confessionnels, et un retour à la case départ.
Une offensive israélienne de grande ampleur, sur le modèle de Gaza, impliquerait des pertes humaines et matérielles massives, un risque d’embrasement régional, et l’effondrement total du Liban déjà exsangue.
Qui décide de la « fin du Hezbollah » ?
Dans ce contexte, la notion même de désarmement devient un instrument de langage, non un projet politique opérationnel. Qui déciderait que le Hezbollah est « désarmé » ? Sur quels critères ? Selon quels standards internationaux, et avec quel contrôle ? Aucune instance indépendante, ni libanaise ni étrangère, n’a accès à l’ensemble des sites ou dépôts d’armes. Le parti conserve, dans toutes ses zones d’implantation, une capacité de dissimulation, de redéploiement, et une logistique robuste soutenue par l’Iran. Les services occidentaux reconnaissent que toute tentative d’inventaire serait inévitablement partielle, soumise à des manipulations, voire à des fuites orchestrées.
Ce flou n’est pas accidentel : il sert toutes les parties. Le Hezbollah maintient l’ambiguïté pour préserver son pouvoir de dissuasion, Israël s’en sert pour légitimer ses opérations, les dirigeants libanais pour justifier leur impuissance, et les puissances étrangères pour conserver un levier diplomatique. Dans ce jeu de dupes, l’expression « désarmement du Hezbollah » fonctionne comme un marqueur de position politique, plus que comme un horizon atteignable à court terme.
Un objectif innateignable
La persistance de cette impasse nourrit un cycle d’instabilité : chaque offensive israélienne contre le Hezbollah renforce sa légitimité interne comme « rempart contre l’agression », chaque appel international au désarmement aggrave la polarisation au sein du Liban, chaque blocage politique affaiblit l’État central et favorise l’autonomie des acteurs armés. La frontière sud reste le théâtre d’un équilibre précaire : ni guerre totale, ni paix véritable. La prolongation de la FINUL jusqu’en 2026 est vécue comme un compromis fragile, destiné à éviter le pire sans rien résoudre.
Au-delà, la question du désarmement du Hezbollah cristallise toutes les contradictions du système libanais : souveraineté empêchée, fractures confessionnelles, dépendance aux acteurs extérieurs, absence de projet national. Loin d’offrir une perspective de résolution, l’injonction répétée du désarmement fonctionne comme un miroir des échecs collectifs, et comme un symptôme du malaise géopolitique qui mine le pays et la région.
Pour saisir les racines de cette impasse, il faut désormais interroger la réalité du Hezbollah : une puissance hybride, bâtie sur le vide d’État, et dont l’enracinement régional fait du Liban un terrain de jeu stratégique pour l’Iran. C’est l’objet du prochain article.
Dans le 3eme volet de notre enquète, le Hezbollah au Liban : un État dans l’État