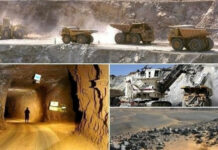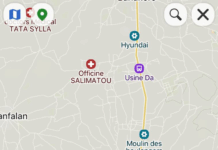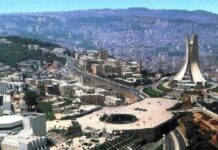Un plan de paix de 20 points présenté par Donald Trump et Benyamin Netanyahou fait actuellement couler beaucoup d’encre. Analyse d’un pari diplomatique à haut risque, où les illusions de règlement pourraient bien cacher les préparatifs d’une guerre durable.
L’image avait de quoi frapper les esprits : ce lundi à la Maison Blanche, Donald Trump, de retour au centre du jeu international, recevait Benyamin Netanyahou pour sceller ce qui était annoncé comme le plan de paix du siècle. À la clé : un accord en vingt points censé ouvrir la voie à la résolution du conflit israélo-palestinien, à la pacification de Gaza et, plus largement, à l’instauration d’un « nouvel ordre » au Proche-Orient. L’ambition est à la mesure du désastre : en près d’un an, la bande de Gaza a été ravagée par une guerre d’usure meurtrière, les relations régionales se sont enflammées, et la communauté internationale multiplie les alertes sur l’urgence d’un cessez-le-feu. Mais derrière la mise en scène et la gestuelle solennelle, une question essentielle demeure : ce plan a-t-il la moindre chance de survivre à la brutalité du réel ?
Les grandes lignes du plan, révélées avant même la conférence de presse, affichent des objectifs spectaculaires : retrait progressif de l’armée israélienne de Gaza, libération des otages, arrêt de la colonisation en Cisjordanie, retour des réfugiés gazaouis, mise en place d’une administration internationale de transition sous l’égide de l’ONU, relance des Accords d’Abraham, supervision par Tony Blair et « International Board of Peace »… Sur le papier, tout est là pour dessiner une paix « éternelle », selon la formule de Trump.
Mais l’illusion ne tient que quelques minutes à la lecture des détails. Car ce plan ne repose pas sur une négociation directe entre Israéliens et Palestiniens : il s’impose, d’en haut, dans la plus pure tradition des diktats internationaux, en posant comme préalable la dissolution du Hamas, la reddition de ses armes, et l’acceptation, par les dirigeants du mouvement islamiste, d’une amnistie. En d’autres termes, tout – absolument tout – repose sur un acteur majeur, absent de la table des négociations : le Hamas, que le plan somme de se saborder sans condition.
Derrière cette façade de consensus, le fin mot de l’histoire saute aux yeux des analystes : le plan, sous des airs de compromis historique, est d’abord une habile manœuvre politique pour Benyamin Netanyahou. Surnommé « le prestidigitateur » par ses adversaires, le Premier ministre israélien a, selon de nombreux observateurs, obtenu de Trump un accord « conditionnel » dont il sait qu’il ne sera jamais accepté dans sa totalité. Le piège est redoutablement simple : en posant la barre des exigences à un niveau inatteignable pour le Hamas, Israël se donne le beau rôle, celui de la paix refusée par l’autre camp. Et en cas de refus du Hamas – hautement probable –, le plan prévoit, noir sur blanc, l’option d’une nouvelle offensive militaire, cette fois avec la « bénédiction » des États-Unis et, implicitement, l’assentiment tacite des pays arabes modérés.
Autrement dit, Netanyahou transforme un risque diplomatique en levier stratégique. S’il signe l’accord, il se présente en homme de paix forcé de reprendre les armes face à l’intransigeance terroriste. S’il le refuse, il accuse le Hamas d’avoir torpillé la paix. Dans les deux cas, il garde la main. Cette capacité à intégrer dans un plan de paix les conditions de son échec était déjà à l’œuvre lors de la précédente administration américaine, mais elle atteint ici une dimension nouvelle : celle d’un consentement simulé, destiné à reporter la faute sur l’ennemi désigné.
Pour Donald Trump, le pari est autrement plus risqué. Certes, présenter un plan de paix majeur à quelques mois de l’élection présidentielle américaine lui permet de se poser en « faiseur de miracles » sur la scène internationale. Mais ce coup de poker diplomatique, s’il échoue, peut aussi le transformer en fossoyeur de la paix, incapable de contenir l’extrémisme régional.
Pièges, illusions et jeux d’influence
Dès l’annonce, les critiques n’ont pas manqué : comment imaginer qu’une administration internationale de Gaza, pilotée par l’ONU et des personnalités occidentales, puisse s’imposer sans le consentement des principaux acteurs palestiniens ? Pourquoi ignorer la réalité d’un Hamas certes affaibli, mais loin d’être éradiqué, encore capable de nuisance et d’enracinement social ? Les analystes soulignent que l’exclusion de l’Autorité palestinienne des premiers cercles de discussion est également une faute stratégique, qui prive le plan de relais locaux et de légitimité populaire.
La presse américaine et internationale, de The Guardian à Reuters, insiste sur la part d’illusion contenue dans la rhétorique trumpienne : l’idée que les acteurs régionaux, épuisés par la guerre, seraient prêts à accepter une solution « clé en main » dessinée à Washington, sans tenir compte des rancœurs, des humiliations et des équilibres communautaires. Le danger ? Que le plan, au lieu de calmer le jeu, n’accélère une nouvelle radicalisation et ne serve de prétexte à de nouvelles interventions armées, sous couvert d’un mandat « international ».
Un autre aspect du plan suscite l’attention : la place laissée aux pays arabes dans la future architecture de sécurité. Si l’Arabie saoudite, l’Égypte et la Jordanie saluent officiellement « l’effort pour la paix », aucune ne s’engage clairement à soutenir une opération contre le Hamas. Derrière la diplomatie de façade, le scepticisme est palpable. Beaucoup redoutent qu’une transition trop brutale à Gaza ne provoque un effondrement sécuritaire, une poussée des groupes radicaux, ou même une intervention de l’Iran, qui surveille chaque avancée israélienne comme une menace directe.
Plus encore, l’hypothèse d’un retour des réfugiés et d’un arrêt de la colonisation en Cisjordanie – éléments centraux du plan – restent des promesses en suspens. Le gouvernement israélien, sous la pression de son aile droite et des colons, n’a cessé d’envoyer des signaux ambigus. Netanyahou a même laissé entendre, devant la Knesset, que la question des implantations restait « ouverte à la discussion », en clair : rien n’est acté, tout peut être renégocié.
La grande absente, c’est la voix palestinienne – et singulièrement celle du Hamas. Le mouvement islamiste, qualifié de terroriste par Israël et les États-Unis, n’a pas été officiellement associé à la rédaction du plan. Le pari, du côté américain et israélien, est clair : acculer le Hamas à un choix impossible, l’inviter à se dissoudre sous la menace d’une amnistie en cas de reddition, et utiliser son refus comme justification d’une reprise des hostilités.
En réalité, ce calcul s’inscrit dans une longue tradition de « paix imposée » dans la région, où l’absence de négociation réelle nourrit le cycle de la violence. Les précédents accords, d’Oslo à Camp David, avaient au moins pour eux de faire dialoguer les deux parties. Ici, on assiste à une forme de « trompe-l’œil diplomatique », où le principal intéressé n’est ni consulté, ni même reconnu comme interlocuteur légitime.
Entre faux-semblants et risques de guerre
Les critiques ne s’y trompent pas. Pour de nombreux experts, ce plan de paix porte en lui toutes les conditions de son propre échec : exigences maximalistes, absence de partenaires palestiniens crédibles, promesses de normalisation régionales sans garantie, et surtout, la menace explicite de la force en cas de refus. Au lieu d’apaiser la région, il risque de polariser davantage les opinions, d’enhardir les extrémistes des deux bords, et d’ouvrir la voie à une guerre plus large, avec l’assentiment – même implicite – des grandes puissances.
La phrase de Trump, prononcée lors d’une réponse à la presse (« Vous savez, cette guerre dure tellement longtemps… des décennies et des décennies »), résume involontairement l’impasse : en s’appuyant sur la lassitude du conflit, le président américain pense pouvoir imposer la paix par l’usure. Mais l’histoire récente montre que chaque tentative de « solution rapide » ne fait qu’ajouter de la complexité, du ressentiment et, trop souvent, de la violence.
Au final, le plan Trump-Netanyahou ressemble à un jeu de dupes où chacun s’efforce de gagner du temps. Israël affiche une volonté de paix, tout en préparant ses options militaires. Les États-Unis endossent le rôle d’arbitre, mais gardent à l’esprit leurs propres échéances électorales. Les pays arabes saluent l’effort, sans vouloir s’engager. Et le peuple palestinien, pris en étau, risque une fois encore d’être la première victime d’une paix proclamée mais jamais vécue.
Il reste que la région, usée par la guerre, aspire à autre chose : un règlement digne de ce nom, impliquant toutes les parties, respectant les équilibres locaux, et garantissant enfin le minimum d’humanité à ceux qui vivent sous les bombes. Or, tant que les plans seront dictés d’en haut, sans la voix ni la volonté des principaux concernés, la paix, réelle ou non, restera une illusion fugace, et la guerre, un horizon redoutablement proche.