Depuis plus d’une décennie, le président Recep Tayyip Erdoğan a perfectionné un double langage : une rhétorique enflammée de solidarité islamique pour sa base intérieure, et un pragmatisme de négociateur avec ses adversaires lorsque l’économie l’exige. Nulle part cette tension n’est plus vive que dans son choix entre le Qatar, partenaire financier et idéologique de longue date, et le bloc émergent des Accords d’Abraham formé par Israël, les Émirats arabes unis et les États-Unis.
Depuis 2017, le Qatar est le soutien le plus fiable de la Turquie. Doha a élargi une ligne de swap de 15 milliards de dollars, investi dans les banques et l’immobilier turcs, et hébergé une base militaire turque qui a protégé l’émir pendant le blocus du Golfe. Politiquement, Al Jazeera a relayé les récits d’Ankara, tandis que les deux capitales soutenaient des réseaux islamistes.
Mais le soutien de Doha a des limites. Son capital, bien que considérable per capita, reste modeste en termes absolus. Son aide est épisodique et politiquement coûteuse. Le Qatar peut fournir de la liquidité et une légitimité idéologique, mais pas l’ampleur d’investissement qu’Erdoğan recherche aujourd’hui pour sauver son économie.
Les Émirats: capital, technologie et corridors
Le bloc des Accords d’Abraham offre ce que le Qatar n’a jamais pu apporter. Les Émirats Arabes Unis peuvent offrir une échelle, une prévisibilité et des investissements programmatiques que le Qatar ne peut pas fournir. Les échanges commerciaux avec Israël ont historiquement été lucratifs — les exportations turques d’acier et de machines ont alimenté l’économie israélienne même en période de rupture diplomatique. Réactivés, ces flux pourraient à nouveau atteindre 7–9 milliards de dollars par an.
1. Le capital émirati. Le cadre CEPA vise 40 milliards de dollars d’échanges avec la Turquie, soutenu par des dizaines de milliards en accords signés.
2.La technologie israélienne. Drones avancés, défense antimissile et guerre électronique pourraient renforcer considérablement la posture militaire turque.
3.L’indulgence américaine. L’alignement avec ce bloc s’intègre à la stratégie de containment de l’Iran et pourrait atténuer l’hostilité du Congrès, débloquant des ventes d’armement gelées.
4.Les corridors, une mine d’or. L’India–Middle East–Europe Corridor (IMEC) et les routes énergétiques de l’Est méditerranéen pourraient redonner à la Turquie le rôle de carrefour indispensable.
Sur le papier, l’offre est irrésistible. Mais ces gains s’accompagnent de conditions et de risques. Le mécanisme européen d’ajustement carbone à la frontière pénalisera les exportations intensives en carbone, comprimant les marges turques. Les méga-projets comme les pipelines font face à des obstacles climatiques et financiers : sans garanties européennes, le coût du capital explose. Quant à l’argent émirati, il n’est jamais inconditionnel : il est généralement lié à des prises de participation stratégiques (ports, télécoms) qui réduisent l’autonomie d’Ankara.
Paris et Athènes en embuscade
La géographie de la Turquie la place au centre des routes énergétiques et commerciales, mais aussi sous pression. L’expansion de TANAP/TAP pour le gaz azéri est réaliste ; la construction d’un nouveau gazoduc Israël–Turquie ne l’est pas.
Les obstacles ne sont pas seulement politiques mais aussi juridiques. La Grèce et la France, soutenues par Chypre, s’opposeraient farouchement à tout corridor validant les revendications turques contestées sur la ZEE. Leurs outils sont nombreux : diplomatie du Conseil de l’UE, contentieux UNCLOS, critères de financement climatique et participations d’entreprises (TotalEnergies à Chypre, hubs GNL grecs). Même si Israël et les Émirats veulent une route turque, Athènes et Paris peuvent l’étouffer en silence en refusant permis et financements.
La technologie militaire est une autre tentation. L’ISR et la défense antimissile israéliens pourraient multiplier la puissance turque en Syrie et en Irak. Mais le prix serait un enlisement dans des conflits régionaux plus larges.
Même un partage limité de renseignements comporte des risques d’attribution. Une fuite, un UAV abattu, ou une frappe contre des actifs turcs pourrait entraîner Ankara dans des cycles de représailles qu’elle ne contrôlerait pas. La Turquie récolterait les risques d’affrontement sans jamais pouvoir en fixer l’issue politique.
La position politique d’Erdoğan sur le plan intérieur est plus faible qu’à tout autre moment de ses vingt années de pouvoir. La défaite de l’AKP aux municipales de mars 2024 reflétait non seulement la colère liée à Gaza, mais aussi l’inflation et la lassitude face à sa gouvernance.
Il ne peut rouvrir le commerce avec Israël que si deux conditions sont réunies : La désinflation est visible et soulage la douleur économique.
Les cadres nationalistes peuvent présenter tout rapprochement comme servant la sécurité — par exemple via des dividendes anti-PKK — plutôt que comme une soumission à Israël.
L’Irak, la Syrie et le Yémen orphelins
Le vrai danger d’un pivot vers le bloc abrahamique ne réside pas au Liban, mais dans les théâtres où la Turquie a déjà des troupes et des corridors commerciaux.
En Irak du Nord, les bases et convois turcs sont exposés aux milices pro-iraniennes comme Kata’ib Hezbollah et Asaïb Ahl al-Haq. Ces groupes ont déjà harcelé les positions turques ; un alignement avec Israël et les Émirats intensifierait sûrement ces attaques. Bagdad détient aussi un levier juridique : sous pression iranienne, il pourrait utiliser l’arbitrage sur l’oléoduc KRG–Turquie pour couper les flux énergétiques.
En Syrie du Nord, les garnisons turques à Idlib, Afrin et dans la zone Bouclier de l’Euphrate sont à portée des milices liées aux Gardiens de la Révolution. Des frappes par procuration — roquettes, drones, IED — pourraient saigner les positions turques à faible coût.
Plus loin, les Houthis du Yémen représentent un autre canal de harcèlement. Leurs attaques en mer Rouge, présentées comme une solidarité avec Gaza, pourraient facilement viser des navires battant pavillon turc si Ankara est perçue comme alliée d’Israël et des Émirats. Le coût économique en assurances maritimes et l’atteinte réputationnelle seraient importants, sans réelle riposte possible.
Pris ensemble, ces fronts illustrent le risque réel, une érosion progressive de l’influence turque via l’Iran et ses proxys en Irak, en Syrie et au Yémen.
Les risques de la surenchère
Un pivot trop marqué comporte des coûts plus larges avec la possibilité de vives réactions sur le plan intérieur. Islamistes et nationalistes rejettent une normalisation visible avec Israël. Une riposte qatarie n’est pas à exclure . Doha peut prolonger ses swaps, activer Al Jazeera et présenter Erdoğan comme traître à la cause palestinienne. Le retour de Riyad sur la scène internationale se ferait également sentir . Le capital pétrolier saoudien surpasse Doha et Abou Dhabi. Si le royaume revient dans la politique des corridors, la Turquie risque d’être marginalisée.
Enfin la Russie et la Chine peuvent jouer les trouble-fêtes : Moscou via la mer Noire et l’Arménie, Pékin par le rationnement du crédit si elle est exclue des projets.
Rhétorique bruyante, coordination discrète
L’instinct d’Erdoğan est de ne jamais s’engager totalement. Son intérêt est dans l’alignement de facto : encaisser l’argent émirati, rouvrir discrètement les échanges avec Israël, profiter de l’indulgence américaine — tout en maintenant le Qatar comme réserve de liquidité et de légitimité. Publiquement, il continuera de dénoncer Israël pour satisfaire sa base. Privément, il encaissera les chèques.
Le bloc abrahamique offre une logique économique réelle. Mais l’arithmétique politique est périlleuse : contrecoup intérieur, veto gréco-français, harcèlement des proxys iraniens en Irak et en Syrie, et risque de débordement en mer Rouge peuvent effacer les gains du jour au lendemain.
La voie la plus rationnelle ferait coexister une rhétorique bruyante où Israël serait dénoncé ouvertement, mais avec une coordination discrète et sans traité avec le bloc des accords d’Abraham, tout en gardant toujours une porte de sortie ouverte vers le Qatar. Tout autre choix reviendrait à payer le prix fort pour la guerre des autres, ce dont le président Erdogan s’est toujours gardé.

































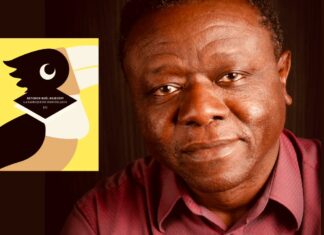


xxxx