Cet accord « historique » reconnaît la souveraineté de l’île Maurice sur les Chagos, incluant l’atoll de Diego Garcia dont la position stratégique dans l’océan Indien pour des opérations militaires en Mer Rouge, au Moyen-Orient et la région Indo-Pacifique n’est plus à faire.
Vel Moonien
L’archipel des Chagos, qui abrite la base militaire américano-britannique de Diego Garcia — d’où les bombardiers américains ont décollé lors de l’invasion du Koweït par l’Irak — a finalement été rétrocédé à l’île Maurice. Jeudi, le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, et son homologue britannique, Sir Keir Starmer, ont signé un accord en ce sens, lequel devra encore être ratifié par le Parlement britannique. Depuis plus de cinquante ans, Maurice conteste la décision du Royaume-Uni d’avoir détaché l’archipel de son territoire peu avant de lui accorder son indépendance, le 12 mars 1968, et d’avoir, dans la foulée, expulsé les natifs.
Cet accord qualifié d’« historique » entérine la souveraineté de l’île Maurice sur l’archipel des Chagos, y compris l’atoll de Diego Garcia, dont l’importance stratégique dans l’océan Indien — pour des opérations militaires en mer Rouge, au Moyen-Orient et dans la région indo-pacifique — est bien établie. Pour permettre aux forces américaines et britanniques de continuer à utiliser cet atoll, le Royaume-Uni s’est engagé à verser à Maurice une rente annuelle de 165 millions de livres sterling, soit environ 10,06 milliards de roupies, pendant les 28 premières années d’un bail de 99 ans.
Le prix à payer
Sir Keir Starmer a précisé que le versement moyen de 100 millions de livres sterling à l’île Maurice représente pratiquement « le coût d’exploitation d’un porte-avions […] ou légèrement moins, s’il est dépourvu de ses avions ». À cela s’ajoutent 45 millions de livres sterling que le Royaume-Uni allouera sur une période de 25 ans pour appuyer le développement économique de l’île Maurice, ainsi qu’un montant supplémentaire de 40 millions de livres destiné à un fonds d’aide en faveur des habitants des Chagos.
L’accord stipule que l’île Maurice ne pourra céder aucune des quelque cinquante îles de l’archipel des Chagos à une puissance étrangère à des fins militaires. Cette disposition fait écho aux craintes exprimées par les conservateurs britanniques et les républicains américains, qui agitaient le spectre d’une possible implantation chinoise dans l’archipel, malgré la proximité géopolitique de Maurice avec l’Inde. Par ailleurs, l’accord prévoit que les entreprises et contracteurs mauriciens bénéficieront d’une priorité lors des appels d’offres pour les travaux à réaliser sur l’atoll de Diego Garcia.
La fin de l’exil
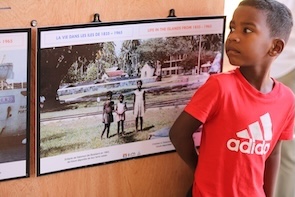
Les Chagossiens auront également la possibilité de retourner s’installer sur deux des principales îles de l’archipel : Peros Banhos et Salomon. Un fonds sera mis en place afin de rendre ces îles de nouveau habitables. Olivier Bancoult, leader du Groupe Réfugiés Chagos et lui-même natif de Peros Banhos, a annoncé vendredi avoir mandaté le cabinet juridique Denton pour étudier les modalités de réinstallation des anciens habitants et de leurs descendants. Plusieurs pays amis, dont l’Inde, ont déjà exprimé leur volonté de soutenir l’île Maurice dans cette initiative.
Olivier Bancoult n’était encore qu’un enfant lorsqu’il a été contraint de quitter les Chagos pour s’installer à l’île Maurice. À partir de la fin des années 1990, il est devenu l’artisan principal d’une série d’actions en justice engagées contre le Royaume-Uni. Le gouvernement mauricien a suivi son exemple, notamment après la décision du Royaume-Uni de créer, en 2010, un parc marin autour de l’archipel, perçue comme une tentative d’empêcher le retour des Chagossiens. En 2015, cette démarche a été couronnée de succès avec une victoire devant le Tribunal international du droit de la mer.
Cette instance des Nations Unies a jugé que la décision britannique était illégale. Pour étayer sa position, l’île Maurice s’est appuyée sur des câbles diplomatiques échangés entre l’ambassade des États-Unis à Londres et Washington, révélés par WikiLeaks. Ces documents ont mis en lumière le mépris affiché par les autorités britanniques à l’égard des natifs, allant jusqu’à les comparer à « Vendredi », le personnage subalterne du roman Robinson Crusoé.
Cette fois-ci, le Royaume-Uni s’engage à soutenir la communauté chagossienne de l’île Maurice en mettant en place un nouveau fonds fiduciaire et en leur apportant d’autres formes d’aide distinctes. Par ailleurs, les deux pays collaboreront étroitement dans les domaines de la protection de l’environnement et de la sécurité maritime, notamment pour lutter contre la pêche illégale, l’immigration clandestine, ainsi que le trafic de drogue et d’êtres humains dans la région des Chagos. Une zone marine protégée sous juridiction mauricienne sera également instaurée.
Ce dénouement a été rendu possible après que la Cour internationale de justice a statué, en février 2019, que l’occupation de l’archipel était illégale et que celui-ci appartenait à l’île Maurice. À cette occasion, l’ancien Premier ministre mauricien, Sir Anerood Jugnauth, avait endossé sa robe d’avocat pour plaider la cause de son pays devant la Cour. La délégation mauricienne y a souligné que quelque 2 000 habitants avaient été expulsés de force vers l’île Maurice et les Seychelles. Une partie a pris la nationalité britannique par la suite.
Le Royaume-Uni avait initialement ignoré la décision, la qualifiant de simple avis consultatif. Toutefois, deux mois plus tard, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution reconnaissant la souveraineté de l’île Maurice sur l’archipel des Chagos. Lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a saisi l’occasion pour dénoncer le double discours britannique sur les questions de souveraineté et de respect de l’intégrité territoriale. Cette prise de position aurait contribué à accélérer l’évolution du dossier.
Il est important de rappeler que, dans les années soixante, le Royaume-Uni justifiait le maintien de ces îles sous son contrôle en invoquant des besoins liés aux télécommunications. En réalité, il menait des négociations avec les États-Unis en vue d’y installer une base militaire. En contrepartie, Londres devait bénéficier de missiles Polaris. À cette époque, l’archipel avait été placé sous l’autorité du British Indian Ocean Territory (BIOT), le Territoire britannique de l’océan Indien.
Les 2 000 natifs des Chagos, expulsés entre 1963 et 1973, n’ont jamais été autorisés à retourner sur leur terre d’origine. Contrairement aux habitants de Chypre, des îles Malouines ou encore des îles Sandwich, ils ont été traités de manière inéquitable, soulignait Human Rights Watch l’an dernier (voir Mondafrique du 15 février 2023). Bien que les autorités britanniques aient, à un moment donné, envisagé un plan de retour pour les Chagossiens, celui-ci a rapidement été abandonné en raison de son coût jugé trop élevé.
































