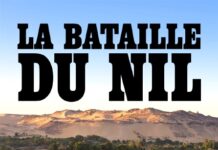La Chine au coeur de l’énergie en Afrique
Stanislas Houël, Naphtomines, 21 janvier 2025

Le soleil couchant illumine les milliers de panneaux solaires qui s’étendent à perte de
vue dans le désert égyptien. Nous sommes à Benban, plus grande installation
photovoltaïque d’Afrique, symbole éclatant de la nouvelle route de la soie énergétique.
Cette gigafactory solaire de 1.8 GW, fruit d’un partenariat sino-égyptien de 4 milliards
de dollars, illustre parfaitement l’ampleur des ambitions chinoises sur le continent
africain.
Une présence qui transforme le paysage
La présence chinoise dans le secteur énergétique africain dépasse aujourd’hui la
simple relation commerciale. Selon la Banque Africaine de Développement, les
investissements chinois dans les infrastructures énergétiques africaines ont atteint 18
milliards de dollars en 2023, transformant profondément le paysage énergétique du
continent.
Au cœur de l’Éthiopie, le corridor énergétique vers le Kenya prend forme. Cette ligne
de transmission de 2,000 kilomètres, financée à 80% par l’Export-Import Bank of
China, transcende les frontières nationales pour créer le premier grand réseau
électrique est-africain interconnecté. Coût du projet : 1.2 milliard de dollars, 2,000
emplois locaux créés, une capacité de transport de 2,000 mégawatts.
En Guinée, le complexe hydroélectrique de Souapiti raconte une autre histoire de cette
collaboration. Ses turbines de 450 MW, installées par China International Water &
Electric Corp, fournissent désormais 60% de l’électricité du pays. Plus qu’une centrale,
c’est un exemple vivant du « modèle chinois » : financement, construction, formation et
transfert de technologie dans un package intégré.
Au-delà des infrastructures
La stratégie chinoise dépasse largement la simple construction d’infrastructures. Dans
les centres de formation technique répartis à travers le continent, plus de 50,000
techniciens africains ont déjà été formés aux technologies énergétiques chinoises.
À Addis-Abeba, l’académie Huawei forme chaque année 2,000 spécialistes en smart
grids et énergies renouvelables.Dans la zone industrielle de Tanger, au Maroc, une usine de fabrication de panneaux
solaires, fruit d’un partenariat avec le géant chinois Jinko Solar, produit désormais 100
MW de capacité annuelle. Elle emploie 300 techniciens locaux et exporte vers toute
l’Afrique de l’Ouest. C’est l’illustration parfaite de la stratégie chinoise de localisation
industrielle.
Un modèle de développement unique
Le succès du modèle chinois repose sur une approche intégrée du développement
énergétique. La China Development Bank a déployé une enveloppe de 40 milliards de
dollars sur cinq ans pour le secteur énergétique africain. Les prêts, souvent adossés
aux ressources naturelles, offrent des conditions avantageuses : taux d’intérêt moyens
de 2%, maturités allant jusqu’à 30 ans.
L’intégration verticale caractérise cette approche. À Madagascar, la construction d’une
centrale hydroélectrique de 120 MW s’accompagne de la formation de 200 techniciens
locaux, de la création d’une unité de maintenance et d’un centre de contrôle dernier
cri. Le transfert de compétences est systématique, même s’il reste parfois incomplet.
L’impact sur le terrain
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En cinq ans, les équipements énergétiques chinois
ont permis une réduction de 60% du coût moyen des installations solaires en Afrique.
La capacité renouvelable installée avec le soutien chinois a dépassé les 15 GW en
2023, soit l’équivalent de quinze centrales nucléaires.
Dans les zones rurales du Sahel, les kits solaires chinois, assemblés localement, ont
révolutionné l’accès à l’électricité. Leur coût, divisé par trois en quatre ans, les rend
accessibles aux populations les plus modestes. Plus de 5 millions de foyers en
bénéficient déjà.
35 milliards de dette énergétique
Cette success story n’est pourtant pas sans zones d’ombre. La dette énergétique
africaine envers la Chine atteint des niveaux préoccupants : 35 milliards de dollars
selon la Banque Mondiale. Certains pays, comme la Zambie, consacrent plus de 30%
de leur budget au service de cette dette.
La question environnementale soulève également des inquiétudes. Si les projets
récents intègrent des standards environnementaux plus stricts, les premières
réalisations chinoises en Afrique ont parfois négligé cet aspect. Le barrage de Merowe
au Soudan en est l’exemple le plus controversé, avec des impacts écologiques et
sociaux significatifs.
L’évolution du modèle chinois
Le modèle chinois évolue néanmoins. La nouvelle génération de projets, comme le
complexe solaire de Kom Ombo en Égypte, intègre dès la conception les
préoccupations environnementales et sociales. Les entreprises chinoises s’associent
désormais plus systématiquement avec des partenaires locaux, créant de véritables
joint-ventures.
L’innovation devient également un axe majeur de coopération. Le centre sino-africain
de recherche sur les énergies renouvelables de Pretoria, fruit d’un partenariat entre
Tsinghua University et l’Université de Witwatersrand, développe des solutions
adaptées aux conditions locales. Quinze brevets ont déjà été déposés conjointement.
Perspectives d’Avenir
L’engagement chinois dans le secteur énergétique africain dessine une nouvelle
géographie de l’énergie. Les projets planifiés pour 2025-2030 représentent plus de 30
milliards de dollars d’investissements, avec un accent particulier sur l’hydrogène vert
et le stockage d’énergie.
Pour les pays africains, l’enjeu est désormais de maximiser les bénéfices de cette
coopération tout en préservant leurs intérêts stratégiques. La formation d’une expertise
locale solide et la maîtrise des technologies transférées deviennent cruciales pour
transformer cette relation en véritable partenariat.
L’Afrique cherche à rattraper son retard abyssal en électricité (volet 1)
Sources et Références
• Banque Africaine de Développement (2023) : « Chinese Investment in African
Energy Sector »
• Boston University Global Development Policy Center (2023) : « China’s Global
Energy Finance Database »
• International Energy Agency (2023) : « Chinese Energy Investment in Africa »
• McKinsey & Company (2023) : « Dance of the Lions and Dragons: Africa-China
Economic Relations »
• World Bank (2023) : « Belt and Road Initiative in Africa – Energy Sector Analysis »
• China Africa Research Initiative, Johns Hopkins University (2023)
• IRENA (2023) : « Renewable Energy Statistics – Africa Focus »
• African Energy Chamber (2023) : « African Energy Investment Trends »
• Power China (2023) : « Annual Report on African Operatio