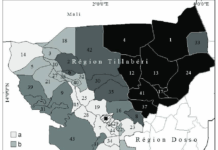Ancienne ministre d’Emmanuel Macron et ex membre du Conseil Consttutionnel, Noëlle Lenoir qui prétend défendre l’écrivain franco-algéries Boualem Sansal au nom de la liberté d’expression, n’hésite pas à dresser un portrait haineux de « millions d’Algériens » terroristes. Et cela sans que cela ne semble gêner grand monde.
Début août, l’ancienne ministre Noëlle Lenoir a provoqué une vive polémique après avoir tenu, sur une chaîne de télévision, des propos visant directement la communauté algérienne en France. Elle a évoqué « des millions d’Algériens » susceptibles de « sortir un couteau » ou de « foncer dans une foule ».
Ces déclarations, immédiatement qualifiées de racistes par plusieurs associations, ont donné lieu à des actions en justice. SOS Racisme a déposé plainte pour injure publique à caractère raciste. L’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne a saisi le tribunal administratif de Paris contre la chaîne de diffusion, estimant qu’elle avait contribué à la propagation d’un discours de haine. Parallèlement, un collectif de chercheurs, d’intellectuels et de militants a publié une lettre ouverte appelant les autorités à se saisir du dossier.
La société civile s’est rapidement mobilisée. Outre les plaintes déposées, plusieurs élus locaux et parlementaires ont dénoncé des propos « abjects » et « indignes ». Pour ces acteurs, il ne s’agit pas d’une simple maladresse verbale, mais d’une stigmatisation de masse qui porte atteinte aux principes républicains.
Une retenue politique remarquée
En revanche, du côté des responsables politiques nationaux, les réactions sont restées limitées. Peu de prises de position publiques ont été enregistrées, un contraste notable avec d’autres affaires de propos jugés discriminatoires. Cette retenue interroge : traduit-elle une gêne à critiquer une personnalité issue du monde institutionnel, ou reflète-t-elle une forme de banalisation des discours visant certaines communautés ?
L’affaire met en lumière une question récurrente : la différence de traitement de propos quasiment racistes selon l’identité de la personne qui les tient. Pour les associations antiracistes, le silence politique constitue un signal préoccupant. « Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit », rappellent-elles, estimant que l’absence de condamnation officielle contribue à affaiblir la lutte contre les discriminations.
Une affaire symptomatique
Au-delà de la polémique immédiate, l’épisode illustre les tensions persistantes autour de la mémoire coloniale, des migrations et de l’intégration. Les relations franco-algériennes, marquées par une histoire douloureuse, demeurent un terrain sensible où la parole publique engage bien plus qu’un simple débat d’idées.
Dans ce contexte, le silence des responsables politiques prend une signification particulière. Il n’est pas seulement une absence de réaction : il devient un choix. Choix de ne pas affronter la banalisation du racisme, choix de laisser s’installer une hiérarchie implicite entre les discriminations, choix enfin de détourner le regard au risque d’entamer la crédibilité même du discours républicain.
Or, la lutte contre le racisme ne saurait souffrir d’ambiguïté. En s’abstenant de condamner clairement de tels propos, la sphère politique contribue, volontairement ou non, à normaliser une parole qui fracture et stigmatise. L’affaire Lenoir agit ainsi comme un révélateur : celui d’une République qui peine encore à se montrer à la hauteur de ses principes lorsqu’ils sont mis à l’épreuve.