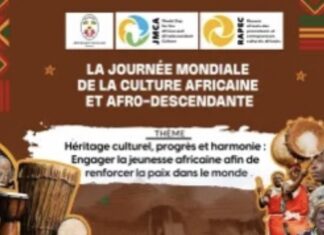Les richesses stratégiques du Mali constituent une formidable source d’enrichissement pour Pékin et laissent Bamako exsangue. Sur l’image ci dessus, on découvre le général Assimi Goita, président du gouvernement de transition malien, inaugurer la première mine de lithium du pays à Goulamina, située à environ 65 kilomètres à l’ouest de Bougouni, dans la région de Sikasso, au sud du Mali.
Mohamed AG Ahmedou journaliste et acteur de la société civile du Mali,
Le 10 septembre, l’Union africaine a dévoilé un projet de déclaration visant à fédérer les pays producteurs de minerais critiques – cobalt, lithium, graphite, uranium – en une coalition capable de défendre leurs intérêts collectifs face aux grandes puissances. Mais au Mali, comme dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne, la réalité est tout autre : les ressources s’évaporent, les profits s’envolent, et les populations demeurent les grandes oubliées de cette ruée mondiale aux métaux stratégiques.
La mine de Bougouni : un symbole d’extraction sans valeur ajoutée
Au sud du Mali, la mine de Bougouni illustre crûment le paradoxe. Le site, contrôlé à 65 % par la co-entreprise Kodal Minerals (Royaume-Uni) et Hainan Mining (Chine), est présenté par les autorités comme une manne potentielle pour l’économie nationale. Or, l’accord conclu stipule que la production de lithium sera exclusivement exportée vers la Chine pour y être raffinée et transformée, et ce pour une durée d’au moins quatre ans.
En clair : aucune transformation locale, aucune filière industrielle nationale, aucun transfert de technologie. Le Mali, pourtant assis sur une ressource stratégique au cœur de la transition énergétique mondiale, se contente de vendre au rabais une matière brute dont la valeur est décuplée une fois intégrée dans les batteries, l’automobile électrique ou l’aéronautique.
« Ce modèle est un copier-coller de l’ancien schéma colonial : extraction en Afrique, transformation ailleurs, captation des bénéfices hors du continent », dénonce un économiste malien basé à Bamako.
Pékin, 65 accords de coopération en Afrique
Selon un rapport de l’Africa Policy Research Institute (APRI) publié début 2025, la Chine a signé la majorité des 65 accords de coopération minière conclus ces dernières années en Afrique dans le domaine des minerais critiques. En République démocratique du Congo, elle rafle le cobalt ; en Guinée, la bauxite ; au Zimbabwe et au Mali, le lithium.
La stratégie est claire : sécuriser les approvisionnements pour ses propres industries en aval, sans se soucier du développement local. Les compagnies chinoises importent même leur propre main-d’œuvre, contournant l’emploi de travailleurs locaux et réduisant à peau de chagrin les retombées économiques pour les communautés riveraines.
Le Mali, maillon faible de la ruée mondiale
Dans un contexte de crise politique et sécuritaire, Bamako apparaît comme une proie facile. La junte militaire au pouvoir, isolée diplomatiquement, cherche désespérément des partenaires financiers. Pékin avance ses pions avec une redoutable efficacité, proposant financements rapides, infrastructures à crédit et partenariats miniers inégaux.
« La Chine sait que l’État malien, fragilisé et illégitime, n’a pas la capacité de négocier d’égal à égal. Elle profite de la faiblesse institutionnelle pour verrouiller des contrats qui privent le pays de toute marge de manœuvre », souligne un chercheur en politiques minières à Dakar.
Une coalition africaine, un mirage pour Bamako ?
L’initiative de l’Union africaine visant à créer une coalition des producteurs africains de métaux critiques pourrait, en théorie, changer la donne. Elle permettrait aux pays de fixer des prix en commun, harmoniser les conditions contractuelles, développer une stratégie de transformation locale et limiter le dumping extractif.
Mais dans les faits, le Mali illustre la difficulté de concrétiser cette ambition. Faute de vision industrielle et sous la coupe d’accords bilatéraux déjà signés, le pays s’enferme dans une dépendance accrue. Le lithium de Bougouni pourrait être une chance historique pour poser les bases d’une industrie malienne du raffinage et de la fabrication de composants électriques. Au lieu de cela, il alimente directement les chaînes de valeur chinoises, laissant derrière lui un paysage dévasté et des communautés dépossédées.
Un futur sous tutelle minière
L’histoire semble se répéter : après l’or, dont l’exploitation n’a guère enrichi que quelques élites locales et partenaires étrangers, le lithium risque de connaître le même destin. La rhétorique souverainiste de Bamako, souvent martelée par les militaires au pouvoir, se heurte ici à une réalité brutale : le Mali n’exerce aucun contrôle réel sur ses ressources stratégiques.
« Tant que le pays ne sortira pas de ce modèle rentier d’extraction brute, il restera une périphérie de l’économie mondiale, un simple fournisseur de matières premières au service des puissances industrielles », résume un analyste nigérien.
La coalition que promet l’Union africaine pourrait offrir un sursaut collectif. Mais pour le Mali, encore faudrait-il rompre avec l’opacité des contrats miniers, exiger une transformation locale et replacer l’intérêt des citoyens au cœur des choix économiques. Faute de quoi, Bougouni deviendra un nouveau nom sur la longue liste des occasions manquées de l’histoire malienne.