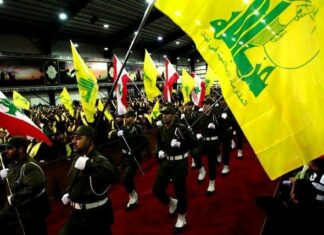Si la communauté internationale dans son ensemble défend toujours, en paroles du moins, la solution dite « des deux États », il convient aussi d’examiner celle de l’État unique israélo-palestinien. Une possibilité crédible, à condition que des concessions importantes soient faites de part et d’autre.
Le site « The conversation » nous autorise à reprendre cet article
Professeur émérite de sociologie, Université Paris Cité
Cet article a été co-écrit avec Elena Qleibo, anthropologue, spécialiste de la Palestine, autrice de Gaza, S’en sortir sans sortir, Ethnographie de la vie quotidienne sous blocus, Éditions du Croquant, 2020.
Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique
Une issue positive au conflit israélo-palestinien est-elle possible ? La réponse que Donald Trump vient d’apporter à cette question – transformer la Bande de Gaza en « Riviera » tout en relogeant les 2 millions de Gazaouis dans « de belles maisons » en Égypte et en Jordanie – a suscité une condamnation unanime du monde arabe et plongé la communauté internationale dans la perplexité. Aussi indécente et irréaliste qu’elle soit, cette idée met en évidence l’incapacité de la diplomatie internationale, comme si l’échec des accords d’Oslo (1993) et des tentatives qui ont suivi avait entravé définitivement l’imagination politique.
Or une autre solution existe qui, comme le rappelait Edward Saïd dans un article paru en 1999, avait déjà été proposée, avant même la création de l’État d’Israël, par des intellectuels juifs parmi lesquels Judah Magnes, Martin Buber ou encire Hannah Arendt… et que vient de reprendre à son compte, en 2024, l’historien israélien Shlomo Sand, dans Deux peuples pour un État. C’est celle de la création d’un seul État dans lequel vivraient ensemble Israéliens et Palestiniens. Une solution, qui, si l’on analyse la situation israélo-palestinienne actuelle d’un point de vue sociologique, est non seulement envisageable, mais réaliste.
L’État unique est viable
Il suffit en effet de regarder les cartes d’Israël et des territoires palestiniens pour se rendre compte que le développement ininterrompu de la colonisation en Cisjordanie a rendu quasiment impossible la solution à deux États, laquelle posait aussi le problème de l’absence de continuité géographique entre la Bande de Gaza et du partage de Jérusalem.
En revanche, en l’état actuel, le pays constitué par la réunion d’Israël et des territoires palestiniens, y compris Gaza, est viable. Avec environ 15 millions d’habitants, il aurait, sur un territoire dont la superficie (27 555 km2) est à peine inférieure à celle de la Belgique, une densité de population (544) légèrement supérieure à celle du Liban et bénéficierait d’une population jeune qui pourrait contribuer à son développement économique.
La société israélienne est déjà une société multiculturelle
Ce nouvel État serait bien évidemment multiculturel, mais au regard de ce qu’est déjà la société israélienne, c’est un bouleversement moins radical qu’on pourrait le penser, car la population israélienne est déjà une population multiculturelle.
Elle comprend en effet, selon les statistiques officielles du Central Bureau of Statistics, plus de 21 % d’Arabes israéliens (dont une petite partie de chrétiens, de druzes et de bédouins), descendants des Palestiniens autochtones. Même si, le plus souvent, ils n’habitent pas les mêmes villes que les Israéliens – le cas de villes mixtes comme Haïfa est peu fréquent –, ni les mêmes quartiers, même si leur niveau de vie est très inférieur à celui du reste de la population israélienne et s’ils sont confrontés à de nombreuses discriminations, ils ont encore, comme l’ont voulu les fondateurs d’Israël en créant un État juif et démocratique, le droit de vote et sont représentés au Parlement (à eux deux, les partis arabes Hadash-Ta’al et Ra’am disposent actuellement de 10 des 120 sièges de la Knesset).
Quant à la population israélienne non arabe, elle est elle-même multiculturelle, car constituée par des vagues successives d’immigrants qui ne parlaient pas les mêmes langues, n’avaient pas la même culture, ne se sont pas insérés de la même manière. Pour mémoire, de la fin du XIXe siècle jusqu’en 1948, sont arrivés des Juifs d’Europe fuyant les pogroms et les régimes fascistes ; après la création de l’État, des Juifs du Moyen-Orient et des rescapés de la Shoah ; dans les années 1950, des Juifs du Maghreb, venus en majorité du Maroc ; dans les années 1960, des Juifs d’Union soviétique, qui seront encore plus nombreux après la chute de celle-ci dans les années 1990, et auxquels s’ajouteront même, entre 1983 et 1991, un petit nombre de Juifs éthiopiens, les Falachas ; enfin, jusqu’à maintenant, des Juifs venant de Russie, d’Ukraine, de France, des États-Unis…

Bien que la société israélienne ait un fort pouvoir intégrateur porté par l’usage de l’hébreu, par la fabrication d’un narratif commun et les commémorations qui l’accompagnent ainsi que par l’obligation du service militaire, elle n’a pu effacer ces différences, d’autant que le rapport à la religion n’est pas un facteur d’unification. Dans chacune de ces populations se trouvent aussi bien des Juifs ultra-orthodoxes que des pratiquants par tradition ou des laïcs, et, dans le cas des immigrants russes les plus récents qui ont obtenu la nationalité alors qu’un seul de leur grand-parent était juif, aussi bien des laïcs que des chrétiens orthodoxes.
Loin donc d’être une société « juive », la société israélienne est, comme beaucoup d’autres sociétés nationales de notre époque, une société multiculturelle, comme le montrent les fortes mobilisations communautaires qui, dans le contexte d’un régime électoral fondé sur la proportionnelle intégrale, trouvent une expression politique. Mais, comme le soulignait le sociologue Baruch Kimmerling, Israël est un État multiculturel qui ne reconnaît pas son multiculturalisme.
Un État unique ne serait pas nécessairement plus exposé au terrorisme que ne l’est actuellement Israël
Il y a un argument qui s’oppose radicalement à la possibilité de la constitution d’un seul État, c’est celui des extrémistes israéliens qui, par exemple le général de brigade et spécialiste du renseignement Yossi Kuperwasser, voient dans tout Palestinien un terroriste en puissance qui ne veut que la destruction d’Israël.
Il ne s’agit pas de nier les manifestations de violence, qu’il s’agisse des actions terroristes – celle du 7 octobre 2023 étant la plus effroyable – ou des soulèvements populaires, les intifada, auxquelles les Israéliens ont dû faire face depuis la création de l’État ; mais il ne faut pas oublier que cette violence est avant tout une violence réactive : d’abord à la Nakba, l’exode en 1948 de plus de 750 000 Palestiniens, puis à l’occupation des territoires, à la poursuite ininterrompue de la colonisation, aux multiples mesures de répression, aux emprisonnements, aux meurtres non condamnés, aux provocations comme celle qu’a constituée en 2000 la visite d’Ariel Sharon sur l’esplanade des Mosquées, au blocus de Gaza, aux opérations militaires…
Si la violence était aussi inscrite dans la culture palestinienne que veulent le croire une partie des Israéliens, jamais les accords d’Oslo n’auraient pu été signés. À l’inverse de ce que soutiennent les extrémistes israéliens, le souhait le plus cher d’une grande partie des Palestiniens, comme le montre une enquête socio-anthropologique menée dans la bande de Gaza de 2007 à 2019, est d’avoir la possibilité de travailler pour améliorer leurs conditions de vie. Le soutien apporté au Hamas n’est pour une grande part que l’expression du désespoir et de l’impuissance.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, en particulier dans le monde intellectuel et artistique, des relations ont existé et existent jusqu’à maintenant entre des Juifs israéliens, des Arabes israéliens et des Palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie et même de Gaza. Ces relations, dont un exemple a été la création par Daniel Barenboïm de l’orchestre israélo-arabe West-Eastern Divan Orchestra, ont toujours été soutenues par la gauche israélienne dont le journal Haaretz (Le Pays), créé en 1918, reste jusqu’à aujourd’hui le porte-parole ainsi que des mouvements comme La paix maintenant.
Une solution qui suppose un changement radical dans la conception de l’État
La première condition est évidente. Quelle que soit la forme que prendrait cet État, sa création demande d’abord d’abandonner la logique militaire dans laquelle, depuis la création de l’État, les gouvernements successifs, y compris ceux de gauche israélienne, se sont trouvés enfermés, et de faire ces gestes décisifs que seraient l’arrêt de la colonisation et de la répression systématique ainsi que la remise en liberté des quelques hommes politiques palestiniens dont l’objectif est de vivre en paix avec les Israéliens.
Mais ce changement radical de politique, qui suppose préalablement la défaite électorale de la coalition au pouvoir, n’est envisageable que si une majorité d’Israéliens prend conscience que, s’ils veulent vivre dans un pays qui n’est pas continuellement en guerre, ils doivent se rallier à une conception de l’État qui va exactement à l’inverse de celle qui a conduit en 2018 au vote de la loi « Israël État-nation Juif » et à la création par Benyamin Nétanyahou, le 28 mai 2023, de l’Agence gouvernementale de l’identité nationale juive – deux étapes clés qui signent, selon le titre de l’ouvrage de Charles Enderlin, L’agonie d’une démocratie.
Dans cette nouvelle optique, la légitimité de l’État ne repose plus sur le fait d’avoir une histoire et une identité commune, mais sur le choix de vivre ensemble et de partager un même destin. Ce n’est en effet qu’à cette condition que les Israéliens, qui célèbrent la naissance de l’État d’Israël quand les Palestiniens commémorent la Nakba, pourraient vivre avec les Palestiniens. Car cet État, dont le mode de fonctionnement pourrait être emprunté à la Belgique, au Canada… accorderait à tous les citoyens les mêmes droits, y compris la possibilité pour les individus et les groupes de vivre comme ils l’entendent, de préserver leurs particularités, pour autant que cette liberté ne remette pas en question la vie commune.
Ne nous y trompons pas. En ce début du XXIe siècle où nombre d’États sont multiculturels ou le deviennent, le défi auquel doivent faire face les Israéliens et les Palestiniens est aussi le nôtre.