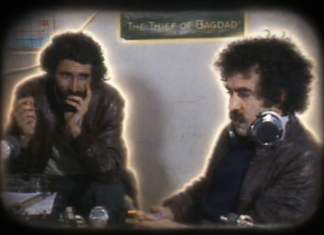Plus de vingt ans après sa création à Durban, en Afrique du Sud, l’Union africaine tient le week-end prochain (15 et 16 février) à Addis-Abeba, en Ethiopie, un sommet des chefs d’Etat crucial dont un des enjeux majeurs sera l’élection d’un nouveau président de la Commission de l’organisation panafricaine. A la veille de cette rencontre décisive, Liesl Louw-Vaudran, Conseillère principale, Union Africaine, à International Crisis Group, plaide, dans cette tribune que publie Mondafrique, en faveur d’une plus grande implication de l’UA dans les solutions aux crises africaines.
Spécialiste reconnue de l’UA, Mme Louw-Vaudran formule également le vœu que le successeur du Tchadien Moussa Faki Mahamat, président sortant de la Commission, soit efficace et qu’il profite de sa légitimité pour faire avancer l’agenda international du continent africain.
Liesl Louw-Vaudran
Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique
Les 15 et 16 février, les États membres de l’Union Africaine (UA) se réuniront à Addis-Abeba pour un sommet qui sera scruté de très près en raison de l’élection du prochain Président de la Commission, à l’issue des deux mandats mitigés de quatre années chacun du Tchadien Moussa Faki Mahamat.
Confronté à une prolifération de conflits et à l’enrayage des mécanismes de maintien de la paix sur le continent africain, le nouveau président devra prendre ses responsabilités et pousser l’UA à redoubler d’efforts. L’élection du nouveau président pourrait servir de catalyseur pour une Union Africaine plus impliquée et active dans les crises continentales.
Parmi les chantiers les plus urgents : la situation désastreuse au Soudan, où se déroule la plus grande crise humanitaire au monde, et le risque imminent de guerre régionale dans l’est de la République Démocratique du Congo, comme le souligne Crisis Group dans ses « Huit Priorités pour l’Union Africaine en 2025 ».
Le nouveau président devra également faire valoir son influence diplomatique au Soudan du Sud, afin d’empêcher ce pays, déjà fragilisé par les répercussions de la guerre chez son voisin et une profonde crise politique et économique, de s’effondrer. L’UA devra aussi s’assurer du financement pérenne de sa force d’intervention censée aider le gouvernement somalien à combattre Al-Shabaab et remettre la crise anglophone du Cameroun à l’ordre du jour. Enfin, elle devra veiller à ce que les États du Sahel central ne s’isolent pas davantage, et faire en sorte de pousser le continent à adopter une position commune sur le climat, la paix et la sécurité.
L’inaction, un luxe qui n’est plus permis
Bien qu’il ne faille pas attendre de miracle de cette nouvelle présidence, l’inaction et le manque d’engagement qui ont caractérisé la présidence de Moussa Faki Mahamat sur certains dossiers, notamment le Soudan, ne sont plus permis. Le nouveau président devra insuffler une énergie nouvelle à sa fonction et redynamiser le travail de l’UA dans une période où le besoin se fait grandement ressentir.
Pour mener à bien cette ambition, les chefs d’État de l’UA devront choisir entre trois candidats aux profils différents : l’ancien Premier ministre du Kenya, Raila Odinga, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, et l’ancien ministre des Finances de Madagascar, Richard Randriamandrato.
Il est difficile, quelques jours avant le sommet, de désigner un favori, bien que Odinga et Youssouf semblent mener la course en tête. Odinga prétend être le mieux placé pour apporter plus de poids politique à l’UA, étant donné son prestige personnel et le statut du Kenya comme puissance majeure en Afrique. Mais certains ambassadeurs africains auprès de l’UA voient en Youssouf, 59 ans, un meilleur choix grâce à sa connaissance précise des institutions de l’UA, sa maîtrise de l’anglais, du français et de l’arabe, ainsi que sa relative jeunesse (Odinga, 80 ans, est son aîné de plus de 20 ans).
Quoi qu’il en soit, les obstacles seront nombreux pour le vainqueur. Contrairement à l’Union Européenne, l’UA est une organisation où les États membres n’ont abandonné aucune souveraineté. Le pouvoir est entre les mains des États membres et le président de la commission possède en vérité très peu d’influence sur leurs actions. Cependant, un président efficace saura profiter de la légitimité de l’UA, un avantage unique sur un continent qui se méfie de plus en plus d’interventions externes.
Menace d’effondrement et le risque d’une guerre régionale
Le Soudan est au bord de l’effondrement et l’impact de cette guerre civile est dévastateur. Plus de 3,2 millions de personnes ont fui vers des pays voisins, tels que l’Égypte, le Tchad, le Soudan du Sud et l’Éthiopie, et 12 millions de Soudanais sont des déplacés internes. Près de la moitié de la population, soit 26 millions de personnes, souffrent de pénuries alimentaires aiguës. La décision du président Trump de geler l’aide étrangère des États-Unis risquent d’aggraver davantage cette situation déjà catastrophique.
Malgré les efforts de médiation des États-Unis, de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, des Émirats arabes unis et de la Turquie, aucune négociation n’a abouti à un cessez-le-feu. L’armée dirigée par le général Abdel Fatah al-Burhan, et les Forces de soutien rapide, menées par Mohamed Hamdan Dagalo « Hemedti », refusent toute rencontre en face-à-face.
Dans de telles circonstances, l’UA a eu du mal à peser sur le déroulement des événements au Soudan. L’élection d’un nouveau président offre une opportunité pour repartir de zéro. Il pourrait commencer par dénoncer publiquement le bain de sang soudanais et exhorter les belligérants à négocier. Il devra également offrir le soutien technique et diplomatique de l’UA à toute piste de médiation prometteuse, et continuer la coordination des dialogues entre politiciens soudanais et parties civiles dans l’espoir d’une transition politique future.
Quant à la RDC, le conflit a sérieusement dégénéré à partir du 27 janvier lorsque les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont capturé la ville de Goma, capitale du Nord-Kivu, située dans l’est du pays. Ils semblent déterminés à continuer leur avancée en territoire congolais, notamment au Sud-Kivu.
Lors du sommet régional du 8 février à Dar es Salam, qui a réuni huit pays membres de l’EAC (Communauté des États d’Afrique de l’Est) et seize de la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe), les deux blocs régionaux ont décidé de fusionner le processus de Nairobi, axé sur les discussions avec les groupes armés, et le processus de Luanda, visant à réunir les dirigeants du Rwanda et de la RDC à la même table.
Le sommet, auquel ont notamment participé le chef d’État congolais Félix Tshisekedi (via visio-conférence) et le Président rwandais Paul Kagame, a abouti à une demande immédiate et inconditionnelle de cessez-le-feu. Bien que l’UA n’ait pas fait partie des délibérations à Dar es Salam, son rôle a été crucial dans la mise en route du processus de Luanda par le truchement de son médiateur désigné, le Président angolais João Lourenço. Lors du sommet ordinaire à venir, l’Angola prendra la présidence tournante de l’UA pour l’année, ce qui suggère que d’autres médiateurs pourraient s’engager sur le dossier épineux de la RDC.
Fondamentalement, les pourparlers entre la RDC et le Rwanda, qui avaient progressé jusqu’aux ministres des Affaires étrangères des deux pays, devront être préservés dans la nouvelle structure que mettront en place l’EAC et la SADC.
L’avenir de la RDC et du Soudan sont des enjeux cruciaux pour le futur du continent. Il est temps pour l’UA, sous l’égide de son futur président, d’assumer ses responsabilités et de mettre tout en œuvre pour aider à ramener les deux pays sur la voie de la paix. Il en va de même pour les autres conflits mentionnés plus haut. Le futur président aura la responsabilité de rechercher un terrain d’entente et de créer un consensus au sein de l’institution, en utilisant ses structures pour soutenir les solutions sur lesquelles ses membres s’accorderont.