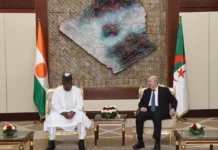Convoqué en urgence par le président camerounais Paul Biya, sous la pression des bailleurs de fonds en particulier le Fonds monétaire international (FMI), le dernier sommet extraordinaire de Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) de décembre 2024 ne semble pas avoir réglé les problèmes que connaît la zone monétaire qui regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée-Equatoriale et le Tchad.
Dans ce texte que Mondafrique publie sous forme de Libre Opinion Djimadoum Mandekor, économiste, ancien directeur de 2012 à 2019 à la Banque centrale des Etats d’Afrique centrale (BEAC), regrette le retard pris dans l’application des décisions prises en décembre. L’économiste, auteur de « Pour sortir la BEAC de sa gouvernance défaillante. Promouvoir une banque centrale assurant l’intérêt général », paru aux Editions Jets d’Encre, en 2024, analyse les difficultés actuelles de la CEMAC et expose quelques pistes pour redresser la barre.
Djimadoum Mandekor, économiste, ancien directeur central à la BEAC (2012-2019)
16 décembre 2024-16 février 2025, deux mois se sont écoulés depuis le sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), à Yaoundé, le 16 décembre 2024. Dans l’ensemble, peu semble avoir été déjà fait pour la mise en œuvre des différentes résolutions, notamment dans le domaine des finances publiques et « en faveur de l’indépendance et du renforcement des capacités de la banque centrale, de la Commission Bancaire et des autres institutions communautaires ». Les retards éventuels risquent de compromettre la conclusion attendue par certains pays d’un accord avec le Fonds Monétaire International (FMI) dans la perspective de l’octroi d’un appui financier de cette institution multilatérale.
Crise de gouvernance à la Banque centrale
S’agissant de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), une des principales institutions de cet attelage communautaire, les actions déjà entreprises sont loin d’être dans le sillage des orientations fixées. L’information publiée sur les réseaux sociaux par la banque centrale communautaire, le 29 janvier 2025, sur l’audit de l’organisation très contestée du concours de recrutement de ses cadres supérieurs de mai 2022, pour favoritisme et népotisme, est à saluer. Cependant, le long délai enregistré entre les deux évènements démontre la faible inclinaison des parties prenantes de cette institution pour sa bonne gouvernance et son efficacité. Pourtant, un risque juridique fort existe sur cette affaire depuis son déclenchement.
De plus, la découverte dans le compte rendu du conseil des ministres du Gabon du 17 janvier 2025, du départ du membre gabonais de la structure de gouvernance de la BEAC, sans aucune communication de la part de la BEAC ou de la Commission de la CEMAC, les deux institutions concernées, replonge l’opinion dans l’opacité tenace dans la gouvernance sous-régionale.
Or, les règles de la BEAC stipulent que le relèvement d’un de ses dirigeants ne peut être décidé que par les Chefs d’Etat, sur avis unanime du Comité ministériel. Une interruption de mandat ne doit donc être imputable, principalement, qu’à une infraction aux « principes d’indépendance, d’impartialité et de neutralité inhérents à leurs fonctions » ou à une faute professionnelle lourde, notamment en matière de conflits d’intérêts.
L’inobservation de ces dispositions, sauf consultation à domicile secrète, contredit la volonté de transparence exprimée le 16 décembre 2024. Elle crée des suspicions légitimes sur des comportements peu avouables ainsi soustraits à un contrôle formel recommandé. Elle renforce aussi le doute élevé sur l’engagement réel des dirigeants de la CEMAC de l’obligation de rendre compte et la lutte contre l’impunité des responsables des institutions sous-régionales.
Cette éviction arrangée est aussi la résultante de fortes dissensions internes déjà apparues au sein du gouvernement de la banque centrale avant le départ du précédent gouverneur. Les tensions devenues vivaces, d’après la presse sous-régionale, en dépit du rappel à l’ordre aux concernés par le Président en exercice de la CEMAC, après le sommet extraordinaire d’avril 2024, proviendraient d’une lecture « anarchiste » et erronée de la notion de collégialité.
A l’analyse, certains membres de cet organe, chacun représentant son pays et étant nommé par la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC, considèrent ne pas avoir à se soumettre à l’autorité du gouverneur. Ensemble, ils feignent d’ignorer que la collégialité (direction exercée de manière concertée), dans le contexte de l’indépendance d’une banque centrale appartenant à plusieurs pays, est axée sur la réalisation primordiale de l’intérêt général sous-régional, principalement la bonne gestion de la Banque centrale selon les normes requises, et non pas de celle d’un intérêt personnel ou d’un seul pays.
Nomination troublante d’un Gabonais au CA de la BEAC
La nomination d’un nouveau membre gabonais du Conseil d’administration de la BEAC, conseiller spécial du président de transition, vient également interroger sur la véritable préoccupation pour l’indépendance effective de la banque centrale. La totalité des membres dudit conseil étant composée de fonctionnaires des Etats, elle accrédite la mainmise politique quasi absolue sur les instances dirigeantes et de contrôle de la BEAC. Il est à noter que pour chaque pays membre considéré, les membres de ces instances ont entre eux des liens politiques et ethniques étroits.
La fréquence des scandales à la BEAC, rendus publics par la presse ou véhiculés par les rumeurs (concours de recrutement des cadres supérieurs de 2022, présumée implication d’un chef d’agence dans la circulation de faux billets en Guinée Equatoriale en 2024, surfacturation des billets d’avion, etc.) montre l’urgence de revoir drastiquement les modalités de fonctionnement et de désignation de ces responsables.
Les dysfonctionnements sont visibles dans toutes les institutions sous-régionales et prennent des fois des proportions insoutenables, notamment au GABAC (Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale). Les mauvais résultats de la sous-région dans ce dernier domaine, avec quatre de ses six pays figurant dans les dix pays du monde ayant le plus grand risque de blanchiment d’argent[1], ne sont sans doute pas fortuits. En effet, le GABAC indique sur son site internet que son dernier rapport d’activité porte sur l’exercice 2013-2014 !
Plus globalement, la CEMAC continue par ne pas briller par son désir de recouvrer sa pleine souveraineté monétaire, sans grand égard pour son obligation de rendre compte. Ainsi, une réunion extraordinaire du Comité ministériel, consacrée à « la réforme du cadre de coopération monétaire en Afrique Centrale », s’est tenue le 04 février 2025, à Douala (Cameroun).
Seul le gouvernement gabonais a heureusement communiqué sur ladite rencontre. Pour leur part, la Commission de la CEMAC et la BEAC, chargées depuis 2019 de ce dossier, sont délibérément restées muettes, malgré leur devoir d’information du public. Même quand ils sont publiés, les communiqués de presse de la BEAC sont de plus en plus squelettiques et sibyllins.
Attachement surprenant au FCFA
Jusqu’à présent rien ne confirme la réalité d’un projet en cours sur une révision de la gestion de la monnaie de la CEMAC. Comme rapporté par certains journaux et les bruits de couloir en 2024, en déphasage d’avec les bonnes pratiques internationales des banques centrales, les membres du gouvernement de la BEAC, sont surtout attachés à défendre l’augmentation de leurs salaires, le versement de primes de bilan, de démonétisation des billets, etc., proscrites dans les autres banques centrales.
Cette situation prospère, au détriment notamment de la consolidation régulière des ressources propres de la Banque, sans réaction nette connue de leurs organes de contrôle (Comité ministériel, Conseil d’administration, Comité d’audit, Collège de censeurs). D’ailleurs, le Collège des censeurs, redondant avec le Comité d’audit introduit en 2007, devrait être dissout.
L’organisation expresse du sommet extraordinaire de décembre dernier, sous la pression amicale des partenaires extérieurs (FMI, France, etc.) inquiétés, notamment, par les tensions de trésorerie publique et les risques d’une importante baisse des réserves en devises, prouve l’absence d’une réflexion interne sérieuse sur ce sujet. Cette infantilisation de la sous-région ne semble pas prêter à conséquence. Un rapport récent du Sénat français, sur les relations entre la France et les pays africains[2], évoque ainsi la réticence des chefs d’État africains à mener à son terme la réforme du franc CFA.
Le choix du statu quo par ces dirigeants, alimenter par leur crainte de ne pas voir maitriser le processus de création d’une monnaie commune autonome, dénote de leur manque de confiance à l’égard de leurs propres cadres et responsables. Pourtant, l’inaction s’avère préjudiciable à leurs économies dont le déclassement pourrait encore s’aggraver à l’heure où la concurrence entre les pays et les régions du monde va s’accroître sous les coups de bélier de Trump.
Pour espérer réaliser la pleine autonomie monétaire de la sous-région, accélérer le développement des pays membres et relancer leur intégration, une vaste réforme de l’architecture institutionnelle de la CEMAC, y compris dans le domaine monétaire, est indispensable. Et cela relève de l’urgence. Elle devrait notamment viser, très courageusement, la rationalisation des institutions et organismes spécialisés existants, avec, entre autres, l’unification des deux unions (économique et monétaire) et une révision profonde des modalités de recrutement des dirigeants des institutions afin qu’ils ne se considèrent plus comme des représentants de leur pays respectif et rendent explicitement compte de leur gestion et de leurs résultats à l’ensemble de la communauté.
L’élaboration d’un plan de réforme, incontournable pour arrêter le décrochage de la sous-région, devrait être confiée à un Comité ad hoc pluridisciplinaire intégrant un nombre significatif d’experts indépendants, afin de limiter les conflits d’intérêts liés à la participation exclusive des membres des organes des institutions actuelles.
Pour atteindre cet objectif, il revient aux chefs d’Etat de la CEMAC de sortir des sentiers battus, en privilégiant notamment la diversité et l’équité dans la nomination des dirigeants de ces institutions.
[1] Indice AML Bâle.13eme indice mondial des risques de BC-FT.
[2] Voir l’Afrique dans tous ses Etats. Rapport d’information. Sénat français. Janvier 2025