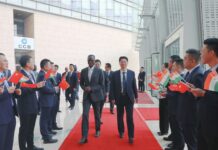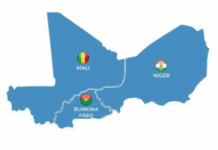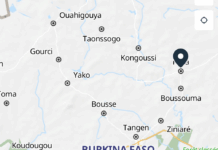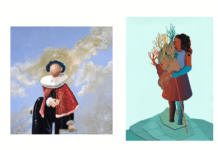Réuni en Égypte, le sommet de Charm el-Cheikh s’annonce décisif pour l’après-ceasez-le-feu à Gaza. Derrière l’unanimité diplomatique affichée, la rencontre révèle les fractures du dossier palestinien, la stratégie américaine et la difficile relance d’une dynamique de paix.
Le sommet de Charm el-Cheikh, qui s’ouvre en Égypte, a tout du rendez-vous diplomatique majeur. L’enjeu affiché : assurer la consolidation du cessez-le-feu récemment conclu entre Israël et le Hamas, enclencher la reconstruction de la bande de Gaza, et définir une nouvelle architecture sécuritaire régionale. À la table, les grands acteurs internationaux – États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Nations unies – multiplient les signes d’unité. Mais un fait s’impose, à la fois symptomatique et révélateur des limites du moment : ni Israël ni aucune représentation palestinienne n’ont été invités à prendre part officiellement aux discussions.
Cette absence, loin d’être anecdotique, éclaire la complexité d’une séquence où chaque acteur tente de préserver ses intérêts, parfois au prix d’une paix durable. Du côté américain, Donald Trump s’affiche en chef d’orchestre d’un processus voulu « inédit », misant sur l’effet d’annonce d’une coalition occidentale et arabe sous égide égyptienne. Il s’agit, selon ses mots, de « coordonner avec de nombreux alliés l’organisation du plan Trump et d’ancrer le soutien international » (Orient-Le Jour). Washington veut mettre en scène sa capacité à relancer la dynamique de paix, mais sans véritable engagement sur les paramètres du conflit, ni interlocuteur local autour de la table.
Le maréchal Sissi, intermédiaire incontournable
L’Égypte, pour sa part, capitalise sur son statut d’intermédiaire incontournable. Le Caire, fort de ses réseaux auprès du Hamas comme de l’Autorité palestinienne, cherche à s’imposer comme garant de la stabilité régionale, tout en contrôlant la reconstruction de Gaza – enjeu diplomatique mais aussi économique majeur. Emmanuel Macron et ses homologues européens, eux, affichent leur appui à une reprise du dialogue, mais se gardent de bousculer les lignes rouges posées par Washington et Jérusalem.
Dans les faits, le sommet s’inscrit dans une séquence incertaine. Le cessez-le-feu, obtenu au prix d’intenses pressions américaines sur Israël, ne dissipe ni la défiance entre les parties, ni les failles béantes du processus. « Il y a en réalité un malaise persistant à Gaza, car le Hamas reste présent à Gaza, et l’Autorité palestinienne demeure le seul représentant légitime du peuple palestinien », confie un diplomate européen cité dans l’article de Dany Moudallal. L’absence de représentants locaux, l’embarras de l’ONU et la prudence des Européens témoignent d’une diplomatie de l’entre-soi, soucieuse d’afficher des résultats mais incapable d’impliquer les premiers concernés.
L’enjeu du sommet, sous ses airs de grand-messe consensuelle, se révèle donc double : d’une part, gagner du temps en affichant la perspective d’un après-guerre à Gaza, d’autre part, imposer un format de négociation qui esquive les points de blocage – la question des otages israéliens, le retour des réfugiés palestiniens, et la gouvernance future de l’enclave.
La pression américaine
Si Charm el-Cheikh se présente comme la première étape d’une « relance du processus de paix », la réalité du rapport de force impose un constat plus nuancé. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, arraché dans la douleur, porte la marque d’une pression diplomatique sans précédent de la Maison-Blanche sur le gouvernement Netanyahou. « Aucun président, sans exception, n’avait exercé une telle pression sur un Premier ministre israélien », rappelle Aaron David Miller, ancien conseiller du département d’État américain, dans l’entretien accordé à L’Orient-Le Jour. Selon lui, c’est la « dynamique du second plan Trump » et la crainte d’une escalade incontrôlable qui ont poussé Israël à céder – temporairement – sur l’arrêt des hostilités.
Mais la fragilité du compromis est manifeste. La trêve ne résulte ni d’un accord politique durable ni d’un règlement des principaux contentieux : elle a été obtenue grâce à un échange partiel d’otages, sous la menace d’une reprise immédiate des combats. Pour Aaron David Miller, la première phase « est cruciale parce qu’elle répond aux trois facteurs essentiels : une gestion espérée de la sortie des otages, la couverture de 50 ou 90 Palestiniens tués par jour, et la bonne architecture ». Mais la fenêtre reste étroite. La suite du processus – notamment la libération massive de prisonniers palestiniens et la possible réintégration de l’Autorité palestinienne à Gaza – bute sur l’absence de confiance mutuelle, et sur les calculs de chaque camp.
La posture de Benyamin Netanyahou est celle d’un leader en sursis, soumis à la fois à la pression de Washington et à la défiance de son propre camp. L’accord sur la trêve, mal accepté par une partie de la droite israélienne, lui coûte sur le plan politique et n’engage en rien une acceptation d’un compromis définitif sur Gaza. L’ouverture de la bande à une administration internationale ou palestinienne demeure un tabou, tout comme la question du retour des réfugiés ou la levée du blocus.
Côté palestinien, le Hamas joue sa survie politique et militaire, refusant tout processus qui signifierait sa mise à l’écart ou son désarmement. L’Autorité palestinienne, elle, se retrouve marginalisée, cantonnée à un rôle d’acteur secondaire, sans réelle prise sur la réalité du terrain.
Dans ce contexte, la diplomatie américaine mise sur un « effet d’entraînement » : la reconnaissance, à terme, d’Israël par certains pays arabes, et la création d’un mécanisme international de reconstruction pour Gaza, géré par l’Égypte et supervisé par l’ONU et la France. Mais le calendrier reste flou, tout comme l’adhésion réelle des acteurs régionaux à ce schéma. La conférence de Charm el-Cheikh s’apparente, pour Washington, à une scène de bal où il s’agit d’occuper l’espace, de fixer le récit, et d’imposer les termes d’un après-guerre qui reste à définir.
Des lignes de fracture assumées
En creux, le sommet égyptien illustre l’incapacité des puissances à trancher les questions centrales du dossier israélo-palestinien. Malgré les annonces et les promesses de reconstruction, la nouvelle architecture régionale promue par l’administration Trump ne règle ni la question du statut de Gaza, ni celle du sort des réfugiés, ni celle des garanties sécuritaires pour Israël.
Les Européens, soucieux d’éviter l’escalade mais impuissants à imposer un cadre contraignant, se bornent à soutenir les initiatives américaines et à défendre la nécessité d’une solution politique négociée, sans offrir de perspectives concrètes. L’Égypte, pivot stratégique, profite du vide diplomatique pour renforcer sa position, mais se garde de s’impliquer au-delà de la gestion humanitaire et logistique.
Quant aux principaux absents – Israéliens et Palestiniens –, ils restent spectateurs d’un processus qui se joue largement sans eux. L’absence de représentants locaux lors des discussions trahit la défiance persistante, l’incapacité à produire un consensus minimal, et l’inadéquation des formats internationaux à la réalité du conflit.
L’après-sommet s’annonce donc incertain. Pour Aaron David Miller, le vrai test viendra dans la durée : « C’est toute la dynamique américaine sur ce que l’on pourrait juger opportun de rappeler “l’architecture Trump d’ordre régional” ». L’ouverture de Gaza, la pérennité du cessez-le-feu et la relance d’un dialogue politique restent suspendus à la capacité des acteurs à dépasser les postures, à accepter des compromis, et à impliquer réellement les sociétés concernées.
En somme, le sommet de Charm el-Cheikh acte davantage une transition prudente qu’un tournant décisif. La paix y est moins l’horizon que le prétexte d’une gestion collective du statu quo, sur fond d’alignements stratégiques, de rivalités régionales et de diplomatie d’affichage. À court terme, il s’agit surtout d’éviter la rechute dans la violence. À plus long terme, la reconstruction de Gaza et la reconnaissance d’Israël par les pays arabes resteront suspendues à des équilibres fragiles, et à l’implication – ou non – des principaux intéressés.
Sources : Article de Dany Moudallal, L’Orient-Le Jour ; entretien avec Aaron David Miller, Carnegie Endowment for International Peace, OLJ.