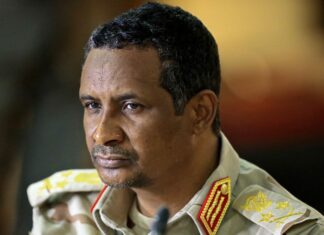L’attrait de nombreux Sahariens pour l’Europe ne faiblit pas. Et ce, en dépit des dangers mortels liés aux voyages clandestins entre les deux continents. Les chiffres de 2024 sont éloquents. Le Maroc a fait avorter 78 685 tentatives d’émigrations irrégulières et plus de 30 000 migrants sahariens ont été expulsés d’Algérie vers le Niger. La police sénégalaise a interpellé 4 630 personnes pour des faits liés directement au trafic de migrants, par voie terrestre, aérienne ou maritime. Environ 16 500 Maliens ont réussi à joindre l’Europe, de manière irrégulière, faisant du Mali le principal pays d’origine des migrants en 2024.
Les africains désirant se rendre, de manière régulière, en Europe se heurtent à un taux de rejet des demandes de visa Schengen à hauteur de 43,1%, soit 704 000 refus enregistrés, en 2023.
Paul Amara, consultant Centre des Stratégies pour la Sécurité du Sahel Sahara (Centre4s.org)
Poussés par l’Union européenne, soucieuse de garder les migrants à bonne distance de ses frontières, les états du Sahel semblent, chacun, gérer cette question à l’échelle nationale. Dans la plupart des pays européens, les immigrés subsahariens représentent en moyenne 0,4 de la population, contre un pic de 1,4% en France.
Selon les Nations-Unies, les migrants sont ‘’les personnes qui ont résidé dans un pays étranger pendant plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer’’. Des personnes en déplacement, peu importe les raisons. Ici, ce terme désigne toutes les personnes originaires du Sahel nourrissant un projet de migration en Europe, par des voies irrégulières.
Trois routes pour joindre l’Europe.
Les migrants subsahariens empruntent essentiellement trois routes pour joindre l’Europe.
– La route atlantique, par laquelle les migrants sahéliens partent des côtes d’Afrique de l’ouest. Ils y embarquent sur des bateaux de différents calibres à destination des îles Canaries, Espagne. Cette route est très meurtrière avec décès et disparitions liés aux naufrages et intempéries. Entre janvier et septembre 2024, 30 808 migrants sont parvenus aux Canaries.
– La route ouest-méditerranéenne, d’où partent les candidats d’Afrique subsaharienne, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le parcours s’effectue à travers le Sahel et le Sahara jusqu’aux côtes algériennes et marocaines. Un itinéraire extrêmement dangereux, car beaucoup perdent la vie, entre autres, dans le désert. Selon l’Organisation pour les migrations internationales (OIM), 11 423 migrants arrivèrent en Espagne, pendant la même période.
– La route méditerranée centrale, qui prend ses racines dans le Sahel et traverse le Sahara jusqu’aux côtes de Libye et de Tunisie, en direction d’Italie ou de Malte. Des subsahariens passent par cette voie, également, très dangereuse. Durant la période considérée, 49 794 migrants ont pu atteindre l’Italie ou Malte par ce circuit.
La Méditerranée, cimetière des migrants
Ces trois routes ont transformé la Méditerranée et le Sahara en cimetières pour migrants. La Méditerranée centrale demeure la route la plus meurtrière au monde, avec environ 25 000 disparus en mer au cours de la dernière décennie, selon l’OIM. Il est précisé que plus de 12 000 de ces victimes ont disparu en mer après avoir quitté la Libye, déchirée par la guerre, depuis 2011. D’innombrables infortunés ont péri en traversant le désert. United, un réseau de plus de 560 associations européennes, soutenant les migrants et réfugiés, évoque des raisons complémentaires : ‘’ D’autres sont morts dans des centres de détention à cause des conditions de vie extrêmes …. Ils se sont suicidés ou sont décédés de maladies attrapées sur le chemin de l’exil. Certains se sont déshydratés à la suite de diarrhées très graves. D’autres encore ont été tués par la police aux frontières’’.
De nombreux facteurs alimentent ou encouragent ces migrations. Au Sahel, on peut citer, entre autres, de fortes croissances démographiques, des économies nationales incapables de fournir assez d’emplois aux jeunes, le terrorisme, le changement climatique. Près de 33 pc des sahéliens vivent dans les capitales nationales à la recherche de sécurité et d’emplois ou fuyant la dégradation continue de l’environnement (sécheresses, inondations). Pour les plus déterminés : ‘’plutôt la misère dans les capitales, ou au-delà des mers, que parmi les siens’’. En Europe, la baisse démographique s’enracine, alors que des secteurs vitaux crient leurs besoins de recrutements : bâtiment, voierie, agriculture (Italie et Espagne). Enfin, la migration constitue un énorme business pour divers acteurs informels, voire mafieux européens et africains, qui l’encourage. Les souverainismes européens anti migrations ne peuvent ignorer tout cela. Pour barrer la route à ces milliers de candidats à l’Europe ou à la mort, l’EU a passé des accords avec des pays sahéliens. De ce fait, les politiques de gestion de la migration au Sahel sont l’émanation de l’Union européenne. Le Niger et la Mauritanie en sont des exemples illustratifs.
Niger, longtemps pays gendarme.
Le 26 mai 2015, le Niger adopta la loi 2015-36 criminalisant la migration. Une sorte d’approche sécuritaire initiée avec le concours de l’Union européenne afin de freiner la migration irrégulière vers l’Europe. De 2016 au 25 novembre 2023, le Niger aurait bloqué environ 95 200 migrants, en particulier à Assamaka, petite ville désert, région d’Agadez, à proximité de la frontière algérienne. Au lendemain du sommet euro-africain de La Valette, Malte, (11 et 12 novembre 2015), et alors que l’UE traversait une grave crise migratoire, Niamey reçut d’importants financements pour contrôler les flux et réduire le nombre de migrants irréguliers. La collaboration se déroulait si bien que les deux partenaires décidèrent de ‘’ passer à la vitesse supérieure’’, en signant un partenariat opérationnel pour combattre le trafic, le 18 juillet 2022. Ce nouvel acte devait permettre au Niger d’améliorer l’impact de l’équipe d’enquête conjointe établie dans le cadre de la mission civile européenne (EUCAP) Sahel-Niger. Cette belle entente vola en éclats avec le coup d’État militaire du 26 juillet 2023. Suite à cet événement, le chef de la diplomatie européenne d’alors, Josep Borell, annonça la suspension totale des activités et des programmes mis en place avec les autorités nigériennes, y compris celles liées au contrôle des frontières. L’UE a décidé d’autres sanctions dont certaines ciblant les auteurs et co-auteurs du putsch. En réaction, les nouvelles autorités abrogent la loi anti-passeurs, le 26 novembre 2023, ouvrant la voie au retour des migrations irrégulières. Le Niger a cessé d’être la frontière sud de l’Europe. La migration irrégulière au Niger cesse d’y être un crime. Conséquence : en application de ladite loi, les passeurs qui se trouvent derrière les barreaux, retrouvent la liberté et leur emprisonnement ne sera pas notifié dans leur casier judiciaire, comme si la loi n’avait jamais existé. Il ne prendra plus de dispositions pour interdire aux migrants, en transit sur son territoire, de converger vers l’Europe, via la Libye ou l’Algérie.
La Mauritanie, pays de transit majeur.
La Mauritanie est un pays de transit majeur pour les migrants ouest-africains se rendant en Europe via les Canaries, la route Atlantique. Selon les autorités espagnoles, jusqu’à 83 % des migrants qui y débarquent transitent par la Mauritanie. Pour les Nations-Unies les migrants en provenance du Sahel sont passés de 57 000, en 2019, à plus de 112 000 en 2023 ! La traversée est loin d’être un long fleuve tranquille. En effet, certains candidats à l’Europe peuvent passer plusieurs années en Mauritanie, avant de traverser vers l’Espagne. La plupart de ces téméraires partent de Nouadhibou, Mauritanie. Depuis la réactivation de la route des Canaries, en 2021, cette ville est devenue un point de passage important pour les migrants, soit 30 000 pour une population de 140 000 habitants, soit 25%. La Mauritanie se déclara ‘’totalement engagée’’ aux côtés de l’Espagne et de l’UE, pour combattre les flux migratoires irréguliers. Elle dit devoir faire de gros efforts pour garantir la sécurité des migrants, contrôler ses frontières, mobiliser ses forces de sécurité et renforcer les services de base. En septembre 2024, le ministère de l’Intérieur publiait les premiers résultats de cette politique. Sur les huit premiers mois de 2024, le pays a expulsé 10 753 migrants, soit une augmentation de 14%, par rapport à 2023. L’organisation mondiale de défense des droits de l’homme, Amnesty International, notèrent que : ‘’ Cette politique d’arrestations et de renvois collectifs de la part des autorités mauritaniennes fait suite aux pressions intenses exercées sur ce pays par l’Union européenne et notamment l’Espagne qui cherchent à impliquer certains pays africains dans leur lutte contre les migrations irrégulières vers l’Europe’’. Cette politique résulte d’un partenariat signé entre la Mauritanie et l’UE le 04 mars 2024 à Nouakchott et prévoyant 210 millions d’euros pour ce pays. Fin octobre 2024, le ministre de la Défense de la Mauritanie tirait sur la sonnette d’alarme : l’afflux de migrants, fuyant l’insécurité au Sahel, ‘’ a atteint un seuil critique.’’ Cette situation ‘’ entraîne une intensification du flux de migrants irréguliers traversant la Mauritanie’’ vers les Canaries, d’où des records de traversées irrégulières. Cet afflux ‘’constitue une forte pression économique, sociale et sécuritaire sur les régions d’accueil’’, a encore déploré le ministre. Le pays ‘’souhaite renforcer ses programmes de coopération avec l’Espagne et l’Europe en général, en matière de migration sûre, ordonnée et régulière en particulier’’.
Le futur incertain.
L’UE adopta, en avril 2024, le Pacte européen sur la migration et l’asile, visant à gérer les migrations et à établir un régime d’asile commun en son sein. En outre, il soutient les États membres confrontés à des pressions migratoires, tout en garantissant la sécurité des frontières extérieures. Le Pacte est enrobé des valeurs européennes. Son objectif majeur est de créer un système de migration plus juste et plus efficace, apportant des résultats concrets sur le terrain. La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, informa les dirigeants européens que le Pacte ne sera pleinement déployé qu’en juin 2026. Dans l’intervalle, la Commission a publié un règlement, censé accélérer les retours aux pays d’origine. Elle a aussi débloqué 3 milliards d’euros pour la mise en œuvre du Pacte, pour la période 2025 – 2027. S’y ajoutent 1,6 milliards d’euros, issus de la révision, à mi-parcours, du réexamen des différents programmes nationaux. Comme trophée de l’efficacité des nouvelles politiques européennes, la présidente arbore une baisse de 38% des franchissements des frontières, en 2024. En particulier, la Méditerranée centrale affiche une chute spectaculaire de 59%, sur 66 800 détections, avec un record de 80% depuis la Tunisie. Toutefois, en Europe l’offre d’emplois pour certains travaux est une réalité et l’autre réalité est que l’offre de main d’œuvre reste très déficitaire !