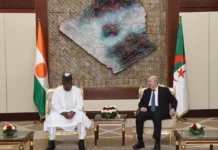Les groupes jihadistes ont l’ambition d’étendre leur influence au-delà des pays sahéliens et de s’implanter dans le nord des pays côtiers. La Côte d’Ivoire est dans leur viseur, mais aussi le Ghana, le Togo et le Bénin, où ils peuvent jouer sur le sentiment d’injustice partagé par de nombreux Peuls pour recruter des combattants.
David Poteaux

Abidjan est en alerte. Ce qui, il y a un an encore, constituait une menace possible, est devenue, aujourd’hui, une évidence : les jihadistes sahéliens ont un projet dans le nord de la Côte d’Ivoire. Ces trois derniers mois, quatre attaques ont été menées contre des positions des forces de sécurité le long de la frontière avec le Burkina, dans les environs de Kafolo. Elles ont coûté la vie à au moins six militaires ivoiriens. Il y a un an, dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, Kafolo avait déjà été le théâtre d’une attaque contre l’armée, au cours de laquelle 14 soldats avaient été tués. Il s’agissait de la première offensive jihadiste menée sur le sol ivoirien depuis l’attentat de Grand-Bassam, en mars 2016 (22 morts, dont 15 civils). Dans un rapport publié le 15 juin, l’Institut d’études de sécurité (ISS) estime que « ces incidents témoignent de l’expansion du spectre de l’extrémisme violent qui plane sur le pays ».
Pour les autorités ivoiriennes, cela ne fait en effet aucun doute : ces attaques sont l’oeuvre d’un groupe de combattants jihadistes liés à la katiba Macina, active au centre du Mali et affiliée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) (lire le troisième épisode de notre série). « Plusieurs renseignements recueillis sur place et après l’arrestation de certains assaillants convergent vers cette thèse », indique un responsable des services de renseignements ivoiriens.

Après la première attaque de Kafolo en 2020, les forces de sécurité avaient arrêté plusieurs dizaines de combattants et de complices présumés, parmi lesquels un des « cerveaux » de l’opération, Ali Sidibé, un Peul, également appelé « Sofiane ». Certains d’entre eux sont passés à table. Ils ont notamment permis d’identifier le chef de la katiba en formation à la frontière entre le Burkina et la Côte d’Ivoire – il s’agit d’un certain Abdramani Sidibé, un Peul lui aussi – et de confirmer ses liens avec la katiba Macina dirigée par Hamadoun Kouffa. Ils ont également alerté les autorités sur le risque de voir une partie des habitants de cette zone verser dans le jihadisme, dont des Peuls.
« C’est une grosse crainte. Cette communauté est déjà infiltrée par les jihadistes. Les chefs de cette katiba sont des Peuls. Nous craignons de voir le même schéma que ceux observés au centre du Mali ou au nord du Burkina se reproduire », poursuit notre source. Les services de sécurité ont en effet découvert que les assaillants avaient bénéficié de la complicité de certains habitants, dont une grande partie sont issus de la communauté peule. « Dans cette zone, il y a toujours beaucoup de mouvements, surtout chez les Peuls, qui passent d’une frontière à l’autre avec leurs troupeaux. Il est très difficile de contrôler ce qu’il s’y passe, d’autant que les Peuls se sont toujours méfiés des autorités », continue notre source.

Cibles privilégiées des recruteurs jihadites
Dans un rapport confidentiel consacré à l’expansion de la menace jihadiste au sud du Burkina Faso, une ONG française généralement bien informée dans la zone, l’ISS alerte : « Les groupes extrémistes exploitent les vulnérabilités telles que les conflits locaux, les déficits de gouvernance, les défaillances des systèmes de sécurité et les activités illicites, au bénéfice de leurs stratégies d’implantation, de recrutement et de financement. […] Le nord de la Côte d’Ivoire n’est pas exempt de ces vulnérabilités ». L’ISS évoque notamment « les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs autour de l’accès aux pâturages et à l’eau ». Il existe également d’autres groupes vulnérables : orpailleurs, anciens combattants, bandits de grands chemins – tous très nombreux dans le septentrion ivoirien.
Il est vrai que les éleveurs issus de la communauté peule, ici comme dans de nombreux autres pays, sont souvent victimes de clichés racistes. Ils sont considérés comme des « étrangers » – y compris lorsqu’ils y vivent depuis plusieurs générations, ainsi que nous l’ont raconté de nombreux Peuls vivant dans la région de Korhogo – et comme sources de problèmes lors de la saison des récoltes. Ils constituent donc une cible privilégiée pour les groupes armés. Un grand nombre de pistes de transhumances sont aujourd’hui occupées par les agriculteurs, ce qui suscite des tensions, et parfois des conflits meurtriers, que les djihadistes savent instrumentaliser pour recruter. Depuis une bonne dizaine d’années, les griefs se sont multipliés. En mars 2016, au moins 33 personnes avaient été tuées lors d’affrontements inter-communautaires entre Lobi et Peuls à Bouna, au nord-est de la Côte d’Ivoire, suite à un litige dû à la divagation de bœufs.
Un élu local rappelle que des relations familiales existent entre les éleveurs peuls du nord de la Côte d’Ivoire et ceux vivant au Burkina et au Mali, dans les zones aujourd’hui en partie contrôlées par les groupes jihadistes : de nombreux éleveurs peuls du nord du Burkina et du centre du Mali ont en effet été poussés à migrer vers le sud, notamment dans la zone frontalière avec la Côte d’Ivoire, après les sécheresses des années 1970 et 1980 – et ils n’ont jamais rompu les liens avec leur région d’origine.
Victimes de l’insécurité et de l’injustice
« Le risque de voir une partie de cette communauté rejoindre les jihadistes est grand », reconnaît un notable peul du nord de la Côte d’Ivoire, même s’il refuse la stigmatisation dont sont déjà victimes les membres de son ethnie, rappelant que « les actes de quelques-uns ne doivent pas être attribués à l’ensemble d’une communauté ». Les raisons sont évidentes selon lui : routes de transhumance obstruées par l’avancée du front agricole, racket des forces de sécurité, vols de bétail… « Comme ailleurs, les éleveurs sont de plus en plus confrontés à l’insécurité, ils doivent se défendre et pour cela, ils pourraient être tentés de rejoindre les groupes armés existants », déplore-t-il.

Ce risque ne s’arrête pas aux frontières de la Côte d’Ivoire. Il menace l’ensemble des pays côtiers : le Ghana, le Togo, le Bénin… Dans le nord de ces pays, comme en Côte d’Ivoire, on a vu arriver de nombreux éleveurs ces dernières décennies. Certains, chassés de chez eux pour de multiples raisons, sont venues pour s’y installer. D’autres en ont fait une terre de transhumance. Dans un contexte de concurrence de plus en plus accrue pour l’accès aux ressources naturelles et de pression foncière galopante, cet afflux a généré des tensions entre sédentaire et nomades ou semi-nomades, et, par conséquent, des ressentiments. De nombreux Peuls se disent victimes d’un rejet dont ils ne comprennent pas les ressorts, et ne cachent pas leur désarroi, voire, pour certains, leur colère et leur volonté d’en découdre.
Déjà, dans le sud du Burkina, d’ouest en est, nombre de cellules jihadistes en formation ont recruté parmi ces éleveurs. Pour ce faire, elles recyclent les mêmes discours que ceux développés au Mali ou au nord du Burkina ces dernières années, en rappelant aux bergers les injustices dont ils sont victimes, et en leur promettant d’y remédier. Ils peuvent pour cela citer l’exemple de l’est du Burkina.
Les jihadistes – dont certains sont liés au GSIM, d’autres à l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) – se sont implantés dans cette zone à partir de début 2018. Ils ont mené une série d’attaques contre les forces de sécurité et les agents des Eaux et forêts, qui leur ont permis de « libérer » l’espace – ces derniers préférant se réfugier dans les villes plutôt que de se faire tuer dans une embuscade ou de sauter sur une mine -, et d’en prendre le contrôle. Aujourd’hui, ils sont notamment les maîtres des parcs naturels et des forêts classées, très nombreux dans cette région. Or qu’ont-ils fait lorsqu’ils en ont chassé les forces de sécurité ? Ils ont fait savoir aux populations locales, qui en étaient jusqu’alors interdites, qu’elles avaient le droit d’y retourner et d’y exploiter les ressources. Désormais, il est possible d’y chasser, d’y pêcher, d’y faire paître son bétail, d’y cultiver, et même d’y chercher de l’or. Autant d’activités qui étaient interdites par les autorités étatiques au nom de la préservation de l’environnement.
L’est du Burkina hors de contrôle
Depuis deux ans, la plupart des forêts de l’est du Burkina sont ainsi occupées par des orpailleurs, des braconniers, des coupeurs de bois, des cultivateurs et surtout des éleveurs qui sont venus avec leurs troupeaux. « C’est impossible à chiffrer, mais l’on sait qu’on y trouve des milliers de têtes de bétail qui viennent de partout : du Niger, du Mali, du Ghana, même du Nigeria », indique un responsable régional du service des Eaux et forêts. Selon un élu local qui a requis l’anonymat pour des raisons de sécurité (il a été contraint de quitter sa commune et de se réfugier dans une grande ville pour échapper aux jihadistes), « les bergers savent qu’avec les jihadistes, ils pourront profiter de la forêt et qu’ils n’exigeront d’eux qu’une taxe, la zakat, dont ils estiment que c’est le prix à payer ». Selon lui, toutes ces personnes qui profitent de la présence des jihadistes sont autant de recrues potentielles. Et ces derniers le savent : « Quand ils sont arrivés, ils ont fait passer le message suivant : ‘Cette terre n’appartient qu’à Dieu, vous pouvez l’exploiter’. Ce discours plaît, car les populations locales n’ont jamais compris pourquoi on leur interdisait de faire ce que leurs aïeux faisaient. De leur point de vue, ils se sont fait confisquer leur terre. C’est comme ça que les jihadistes ont gagné des partisans ».
Les associations d’éleveurs basées dans l’est du Burkina ont d’ailleurs constaté que de nombreux jeunes bergers étaient partis dans les forêts contrôlées par les jihadistes, parfois sans avertir leur famille. Elles rappellent que depuis plusieurs années, il était devenu de plus en plus difficile de se déplacer avec le bétail, et que les périodes de transhumance occasionnaient de plus en plus de conflits. Dans un rapport publié en 2009, le Réseau de communication sur le pastoralisme (Recopa) évoquait ces difficultés : « Les couloirs de transhumance ainsi que les couloirs d’accès sont obstrués soudainement par l’agriculteur d’une saison agricole à l’autre sans que le pasteur venant d’un pays ou d’une autre localité qui se retrouve brusquement dans une sorte de « voie sans issue » n’en soit tenu informé. (…) Ainsi le pasteur dans l’impossibilité de contourner cet espace et qui voit ses animaux y commettre un dégât est d’office fautif. Il doit par conséquent payer des dommages et intérêts. En cas de résistance à cette obligation, il est soit agressé physiquement soit dépouillé de son bétail ». Or depuis que les jihadistes sont arrivés dans la zone, plusieurs responsables peuls constatent que les bergers se déplacent plus facilement. Mais cette nouvelle donne a un revers : désormais, les bergers sont considérés, tant par les forces de sécurité que par leurs supplétifs civils, les Volontaires de la défense de la patrie (VDP), comme des complices, voire des jihadistes en puissance. De nombreux Peuls ont ainsi été tués ou arbitrairement arrêtés et emprisonnés alors qu’ils n’avaient rien à voir avec les jihadistes.
Lien rompu
Ce qu’il se passe dans l’est du Burkina inquiète les autorités des pays du Golfe de Guinée, bien conscientes des frustrations au sein de la communauté peule. Pour l’heure, le Bénin n’a jamais été attaqué – pas plus que le Ghana ou le Togo. Les jihadistes n’y disposent d’aucune base pérenne. Mais de nombreux mouvements suspects y ont été observés ces deux dernières années. En mai 2019, deux touristes français avaient été enlevés et leur guide béninois tué dans le parc de la Pendjari, à la frontière avec le Burkina – les deux Français avaient été libérés quelques jours plus tard à l’issue d’une intervention de l’armée française dans le nord du Burkina. En juin 2020, des jihadistes venus du Burkina et souhaitant se rendre au Nigeria ont été suivis à la trace par les autorités, avant d’être interceptés par l’armée nigériane. Une source au sein des services de sécurité béninois estime que les jihadistes disposent déjà de cellules dormantes dans les environs de Malanville, une ville située à la frontière avec le Niger.
« On craint la contagion », souligne un responsable des services de renseignements béninois. En effet, les éleveurs du nord du Bénin dressent le même constat que ceux de l’est du Burkina : pistes obstruées, couloirs de transhumance non respectés par les agriculteurs, racket des autorités, impossibilité de faire paître leurs animaux dans les parcs de la Pendjari et du W, qui occupent d’immenses espaces… Au fil des ans, les Peuls du Bénin ont eux aussi développé un sentiment d’injustice. Nombre d’entre eux jugent qu’ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone, voire comme des étrangers. Certains parlent de « nettoyage ethnique » en cours. « C’est vrai que beaucoup de Peuls sont tombés dans la criminalité, mais ce n’est pas une raison pour en faire une généralité », dénonce un dirigeant d’une association peule active au nord du Bénin. « Le lien est rompu entre l’État et cette communauté », estime un élu (issu de la communauté peule) du département de l’Alibori.
C’est d’autant plus inquiétant, vu de Cotonou, que les transhumants qui arrivent dans le nord du Bénin viennent pour la plupart de pays en proie aux insurrections jihadistes (Nigeria, Niger, Burkina, Mali) et que des combattantes pourraient en profiter pour venir, sous couvert de transhumance, monter des cellules. Ce n’est pas pour cette raison que le Bénin a interdit la transhumance transfrontalière en 2020 (les raisons avancées étaient liées à l’insécurité et aux conflits que la transhumance engendrerait), mais c’est un scenario qui a été pris en compte lors de la prise de décision. Or cette interdiction a été mal comprise par une partie de la communauté peule, qui y voit une nouvelle preuve de la répression dont nombre de ses membres se disent victimes.
Un représentant des éleveurs de la ville de Tanguieta, située près de la frontière avec le Burkina et le Togo, a en tête l’histoire d’un éleveur burkinabé qu’il avait reçu chez lui. Cet homme avait été pris avec son bétail dans le parc de la Pendjari. Il avait été envoyé en prison – car il n’avait pas le droit de s’y trouver – et son bétail avait été vendu. « Quand il est rentré chez lui, au Burkina, il n’avait plus rien. Que pensez-vous qu’il a fait ? Si j’avais été lui, peut-être que j’aurais rejoint les jihadistes pour me venger ».
Laurent Gbagbo veut rentrer en Côte d’Ivoire en rassembleur