En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, nombreux sont les jeunes Peuls à avoir rejoint des groupes armés, qu’ils soient jihadistes ou pas. L’ensemble de la communauté est aujourd’hui victime d’un grave amalgame qui, à tort, fait de chaque Peul un possible complice des mouvements considérés comme terroristes.
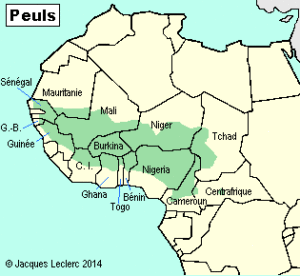
Voici le premier article, signé David Poteaux d’un dossier consacré à la question peule en Afrique
Depuis quelques années, ce peuple majoritairement musulman qui vit dans une bonne quinzaine de pays d’Afrique, est au centre de toutes les interrogations, voire de tous les fantasmes aussi. Dans la rue, dans les grin ou les maquis, mais aussi dans certains cabinets ministériels et états-majors ouest-africains, les Peuls sont catalogués comme « jihadistes » – et donc des ennemis.

Sur les réseaux sociaux, les messages de haine et les amalgames se multiplient à leur encontre. Et sur le terrain, loin des capitales, dans les zones abandonnées depuis longtemps par les pouvoirs publics et aujourd’hui en partie contrôlées par les groupes jihadistes, on les massacre. On ne compte plus les villages martyrs : Koulogon en janvier 2019 au Mali (au moins 39 morts), Yirgou à la même époque au Burkina (au moins 210 morts), Kain et Banh en février 2019 au Burkina (au moins 146 morts), Ogossagou en mars 2019 au Mali (au moins 157 morts), Sobane -Dah en juin 2019 au Mali (au moins 101 morts), les villages des environs d’Ayorou en mars 2020 au Niger (au moins 102 morts), Djibo en avril 2020 au Burkina (au moins 31 morts)…
Dans ces localités, ce sont des civils qui ont été attaqués – par des milices d’auto-défense ou par les forces armées régulières – et qui ont été massacrés, y compris les vieillards et les enfants, au prétexte qu’ils étaient forcément complices des jihadistes, puisque Peuls. Ces derniers ne sont pas les seuls à être exécutés pour leur appartenance communautaire supposée. En outre, des milices constituées de Peuls ont également commis des tueries de masse, au Mali notamment. Mais ils sont probablement ceux qui en payent le plus lourd tribut. Et encore, cette liste est loin d’être exhaustive : elle ne prend pas en compte les tueries quotidiennes – deux ou trois personnes assassinées sur un bord de route ou dans un champ -, ni les menaces sur les villages qui obligent leurs habitants à fuir.
Confrontées à cet amalgame dévastateur qui fait d’un Peul un terroriste en puissance, des associations peules, parmi lesquelles Tabital Pulaaku, présente dans plusieurs pays, ou Kisal, active au Mali notamment, tentent d’alerter les opinions nationales et la communauté internationale, tout en documentant les violences jour après jour. Nombre de Peuls ont le sentiment d’être les victimes expiatoires d’une guerre qui n’est pas plus la leur que celle des autres communautés vivant au Sahel. Face à la litanie des tueries, certains perdent le sens des mots, parlent de « nettoyage ethnique », voire de « génocide », et comparent la situation des Peuls d’Afrique de l’Ouest à celle des Tutsis au Rwanda en 1994, à l’aube du dernier génocide du XXème siècle.
« Il n’y a pas de question peule »
Peut-on parler d’une « question peule » ? Ce simple énoncé fait bondir les principaux intéressés. Un militant associatif malien, très actif dans la communauté peule, s’en offusque : « Il n’y a pas de question peule, soutient-il, sous couvert d’anonymat. Les Peuls de Guinée vivent différemment des Peuls de Centrafrique. Les Peuls du Macina au Mali ne partagent pas grand-chose avec ceux du lac Tchad au Niger. On ne peut pas englober tout le monde dans le même sac. Et les jihadistes recrutent dans toutes les communautés. »
Mais pour de nombreux responsables politiques ouest-africains, cette « question », longtemps ignorée, est aujourd’hui considérée comme cruciale. « On constate qu’un peu partout aujourd’hui, de nombreux Peuls prennent les armes, indiquait il y a quelques mois (en off) un ministre malien. Il ne s’agit pas de dire que tous sont des jihadistes. Mais à l’évidence, il y a un problème. Pourquoi prennent-ils les armes ? Et que peut-on faire pour y remédier ? »
Du Mali à la Centrafrique, en passant par le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria et le Cameroun (et peut-être d’autres pays demain : la Côte d’Ivoire, le Bénin, la Guinée ?), nombre de Peuls – des bergers pour la plupart – se sont armés ces dernières années, et ont rejoint des groupes insurgés : pour se protéger la plupart du temps, et pouvoir continuer à vivre de leur activité, mais aussi parfois pour revendiquer des droits, pour renverser l’ordre social, pour se venger d’une injustice ou d’un massacre, pour imposer sa loi ou tout simplement pour gagner sa croûte. Toutefois, un chercheur français qui arpente la zone depuis plusieurs années et qui a lui aussi requis l’anonymat note que « s’ils prennent les armes, ce n’est pas en tant que Peuls, mais en tant que ruraux qui sont depuis longtemps les grands oubliés des politiques publiques, et pour un grand nombre d’entre eux, en tant que bergers ». Pour lui, la crise du pastoralisme, couplée à la montée de l’islam radical et à la faillite des États issus des indépendances, explique en grande partie l’explosion de violences qui ensanglante le Sahel depuis une décennie.
Les conflits opposant des éleveurs pratiquant la transhumance et des cultivateurs sont récurrents sur le continent, et notamment en Afrique de l’Ouest. Ils ne datent ni d’hier, ni d’avant-hier. « C’est une réalité depuis que des pasteurs côtoient des agriculteurs », indique un Peul du centre du Mali qui officie en tant que médiateur pour une ONG internationale. Historiquement, en Afrique de l’Ouest, la grande majorité des bergers sont des Peuls – d’où l’amalgame effectué par la plupart des gens : un berger = un Peul. Ces derniers sont régulièrement considérés par les populations sédentaires pratiquant l’agriculture comme une source de problèmes, en raison des saccages provoqués par leurs bêtes durant les périodes de récoltes et de la concurrence pour l’accès aux ressources naturelles.
Fréquentes, les disputes entre berger et cultivateur se sont parfois transformées en conflits entre communautés villageoises, qui ont laissé des traces. Mais les affrontements ont longtemps été confinés à une localité – ils ne duraient tout au plus que quelques jours à l’issue desquels chaque camp comptait ses morts, quand il y en avait. Ces dernières années, ce type de conflits a toutefois pris une toute autre ampleur. Plus nombreux, ils sont aussi plus meurtriers.
Vivre en milieu hostile
Poussés par les grandes sécheresses des années 1970 et 1980 à migrer toujours plus au sud (dans les pays du Golfe de Guinée, mais aussi en Centrafrique et en République démocratique du Congo), soumis à des pressions foncières, fragilisés par les politiques publiques qui privilégient l’agriculture extensive et marginalisent les populations nomades, ballottés enfin par les conflits armés du Sahel, les bergers sont aujourd’hui condamnés à vivre dans des milieux hostiles. Et donc parfois en rejoignant des groupes jihadistes dont ils n’épousent pas toujours le dogme. Loin d’une « course à l’armement » et d’un quelconque projet d’imposer la domination politique des Peuls. « Cette idée relève du complotisme. Hélas, elle séduit beaucoup de monde sur les réseaux sociaux », s’alarme le militant malien cité plus haut.
Le spectre d’un « jihad peul » tire sa source de plusieurs insurrections jihadistes en grande partie composées de bergers peuls, et parfois dirigées par des Peuls : la katiba Macina au centre du Mali, l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) dans la région des trois frontières (Mali, Niger, Burkina), Ansaroul islam au nord du Burkina Faso.

La Katiba Macina, un vivier jihadistes
La katiba Macina a vu le jour en 2015 au centre du Mali, une région fréquentée par les bergers pratiquant la transhumance. C’est là que les Peuls ont fondé un empire théocratique au XIXème siècle (l’empire du Macina). Cette katiba liée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et qui agit sous la bannière d’Al Qaeda, compte dans ses rangs des centaines de combattants. La plupart d’entre eux sont des Peuls; leur chef, Hamadoun Koufa, s’exprime en peul et les audios de ce dernier, abondamment partagés sur Whats’app, appellent les Peuls de la sous-région à se soulever contre les autorités qui les oppriment.
Pourtant ce mouvement n’a pas d’agenda ethnique. Il recrute parmi toutes les communautés et s’aligne sur la stratégie du GSIM, qui vise à transcender les appartenances communautaires. Avant de rejoindre le jihad, Kouffa s’était d’ailleurs fait connaître pour ses prêches dans lesquels il dénonçait les notables peuls de sa région, la corruption des autorités locales et les privilèges des familles maraboutiques. De fait, la plupart des chercheurs qui se sont rendus sur place s’accordent à dire qu’il s’agit avant tout d’une révolte sociale sur laquelle sont venus se greffer les groupes jihadistes (nous y reviendrons dans un prochain article).
On pourrait en dire autant d’Ansaroul islam au Burkina. Ce groupe armé fondé en 2016, lié au GSIM et essentiellement composé de combattants peuls, « est avant tout un mouvement de contestation de l’ordre social qui prévaut dans la province du Soum », indiquait International crisis group en octobre 2017. Son fondateur, Ibrahim Malam Dicko, un Peul du Soum, a un profil similaire à celui de Kouffa : comme lui, il s’était fait connaître grâce à ses prêches dans lesquels il prônait l’égalité entre les classes sociales et dénonçait les privilèges des grandes familles.
Quant aux Peuls, nombreux, qui se battent au sein de l’EIGS aux confins du Niger, du Mali et du Burkina, sous les ordres d’Adnane Abu Walid al-Sahraoui, venu du Sahara Occidental, nous verrons dans le prochain article de cette série comment ils sont tombés dans le piège du jihad en voulant se protéger des attaques des milices touarègues et du vol de leur bétail. « Ils n’avaient rien de fous de Dieu, indique un ancien milicien peul qui les a connus avant qu’ils ne rejoignent le jihad armé. Ils n’avaient même pas de projet politique. Ils cherchaient juste à se défendre et à protéger les leurs ».
Mais il n’y a pas que les insurrections jihadistes. Dans d’autres contrées, parfois situées aux confins du Sahel, d’autres Peuls ont eux aussi pris les armes, suscitant la crainte irréaliste d’une alliance de tous ces groupes en un immense front armé unitaire. C’est notamment le cas au Nigeria et en Centrafrique.

Nigeria, la « Middle-Belt » en ébullition
Au Nigeria, les violences se sont multipliées dans ce que l’on appelle la « Middle-Belt », qui marque la frontière symbolique entre le nord du pays, à dominante musulmane, et le sud, majoritairement chrétien, et où se trouvaient au XIXème siècle les limites du califat de Sokoto, un État islamique fondé par un lettré peul, Ousman dan Fodio. Depuis quelques années, cette région fertile a vu affluer de nombreux pasteurs peuls venus du septentrion. Ces derniers ont fui la sécheresse et le surpâturage, mais aussi les exactions de Boko Haram et de l’armée nigériane. Depuis lors, éleveurs (majoritairement musulmans) et cultivateurs (majoritairement chrétiens) se disputent l’accès aux terres. Chaque camp s’arme et procède à des tueries qui sont certes occasionnelles, mais dont le bilan est lourd. Depuis 2018, les États de Benue, Kaduna, Plateau et Nasarawa ont été le théâtre de centaines d’affrontements impliquant des agriculteurs et des éleveurs. Selon le centre de recherches ACAPS, ces affrontements auraient provoqué la mort d’au moins 1.300 personnes rien qu’entre janvier et juin 2018.
Cette escalade alimente la théorie d’un nouveau « jihad peul ». La « Middle Belt » est en effet une zone d’intense compétition religieuse, comme l’ont montré les émeutes de Jos en 2010, au cours desquelles plus de 450 personnes ont été tuées. Les rancœurs contre les musulmans, et notamment les Peuls, y sont anciennes et souvent instrumentalisées. Pourtant, la plupart des spécialistes de cette zone affirment que ces conflits n’ont rien à voir avec le projet politique des groupes jihadistes. D’ailleurs, il n’existe aujourd’hui aucun lien avéré entre ces groupes armés et les mouvements jihadistes sahéliens.
Centrafrique, au coeur de la guerre civile
En Centrafrique, c’est un conflit d’une autre nature dans lequel ont été emportés les Peuls. Même si l’on retrouve des ingrédients similaires tels que la compétition pour l’accès aux terres, l’émergence de mouvements armés majoritairement constitués de Peuls est liée à la guerre civile qui a éclaté en 2013.
À cette époque, les relations sont tendues dans le nord du pays, entre les pasteurs venus du Tchad, et les cultivateurs locaux. « Avant la crise actuelle, les conflits opposant les transhumants tchadiens aux populations locales étaient essentiellement liés aux ressources et les agriculteurs vivaient en relative harmonie avec les éleveurs peul centrafricains », indiquait le centre de recherche « International Crisis Group » en 2014. Les temps ont changé. « L’éclatement des couloirs traditionnels, poursuivent les chercheurs, la modification des itinéraires de transhumance, l’évolution de l’armement de certains transhumants et l’amplification du phénomène des coupeurs de route […] ont favorisé l’émergence de conflits violents. Depuis 2008, la violence a pris des proportions alarmantes et entraîné l’exode de nombreux Centrafricains qui ont fui leurs villages et trouvé refuge dans des camps de déplacés après que leurs villages ont été brûlés. »

Dans cet État failli, chaque communauté se défend comme elle peut. Pour ce faire, les bergers ont fini par s’armer dans les années 2000 – non plus de machettes ou de vieux fusils, mais de kalachnikovs. Baba Laddé, un ancien gendarme tchadien entré en rébellion dans son pays et qui a fondé le Front populaire pour le redressement (FPR) à la fin des années 1990, prétendait alors les représenter et les défendre – tout en leur imposant des taxes et en s’adonnant au vol de bétail.
Contraint de se rendre aux autorités tchadiennes en 2012, il a vu certains de ses combattants poursuivre leurs actes de prédation, puis rejoindre, en 2013, les rangs de l’ex-rébellion de la Seleka (musulmans), en guerre contre les milices anti-balaka (chrétiens).
Désormais, c’est Ali Darassa, un ancien lieutenant de Baba Laddé qui a fondé l’Union pour la paix en Centrafrique (UPC) en 2015, qui prétend défendre les éleveurs peuls. Son groupe a été accusé (notamment par Human rights watch) de commettre de nombreuses exactions : villages incendiés et pillés, civils tués de manière indiscriminée. S’il a signé l’accord de paix en février 2019, l’UPC continue de contrôler une partie du territoire centrafricain (même s’il a perdu du terrain depuis le début de l’année) et mène toujours des attaques sanglantes. Ces massacres ont exacerbé les hostilités à l’égard de l’ensemble des Peuls, et ont à leur tour suscité la crainte, peu probable, de les voir s’allier avec des groupes jihadistes. Dans un article publié en 2014, Peter Bouckaert, le directeur de la division Urgences de Human rights watch (HRW), écrivait à propos de la RCA : « Il est courant d’entendre des chrétiens et d’autres communautés dire que « les musulmans devraient retourner chez eux ».

La crise du pastoralisme
Bien que chaque situation soit différente selon les pays, ces insurrections ont un point commun : elles recrutent parmi les éleveurs, dont la grande majorité sont peuls. Ces derniers vivent une crise sans précédent qui les rend extrêmement vulnérables, comme l’a documenté une étude de Mathieu Pellerin publiée en juin par le Réseau Billital Maroobé et ses partenaires, intitulée « Entendre la voix des éleveurs au Sahel et en Afrique de l’Ouest : quel avenir pour le pastoralisme face à l’insécurité et ses impacts ? »
Dans ce rapport, construit à partir du recueil de la perception de plus de 1.700 éleveurs dans 23 régions de 7 pays du Sahel Central (Mali, Burkina Faso, Niger) et de son voisinage immédiat (Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Nigéria), Pellerin rappelle une triste réalité : « Les populations rurales sont à la fois actrices et victimes de cette situation : actrices parce qu’une minorité d’entre elles constitue le moteur de ces groupes armés, victimes parce que la majorité d’entre elles subit ses impacts ».
Selon lui, « la crise actuelle est l’expression d’une crise globale de la gouvernance des espaces ruraux, dont la crise du pastoralisme n’est qu’une des manifestations. Elle offre un terreau propice aux groupes armés pour recruter parmi les éleveurs. Si une infime minorité s’est laissée séduire, cela a suffi pour ethniciser une partie des esprits au Sahel. La question du pastoralisme est de plus en plus abordée sous un angle ethnique qui façonne et déforme les représentations que chacun se fait de la crise actuelle. Parmi d’autres conséquences, cela fait oublier que la majorité des éleveurs est avant tout doublement victime de la crise du pastoralisme et de la crise sécuritaire, la seconde aggravant la première. » Cette étude rappelle que « les injustices découlant de cette crise pastorale sont récupérées et exploitées aujourd’hui par les groupes jihadistes », car « loin d’être un modèle de justice, ils incarnent pourtant souvent aux yeux de leurs recrues un tel idéal, en leur offrant les moyens de se protéger, de se venger, de se faire justice ou de prendre le pouvoir. » Cela a débouché sur « l’idée selon laquelle les violences armées seraient l’œuvre de nomades – en particulier Peulhs », qui a « progressivement gagné les esprits de décideurs sahéliens et ouest-africains ».
Dès 1990, le géographe Edmond Bernus alertait, dans un article consacré aux pasteurs nomades africains, sur « la saturation de l’espace sahélo-soudanien » et sur le fait que cette évolution rendait déjà « très étroite la marge de manœuvre des éleveurs nomades ». Il ajoutait : « On peut se demander, même sans le recul qui convient, si nous n’assistons pas à une rupture, à une discontinuité : les sociétés pastorales ne peuvent plus «rebondir » comme par le passé et elles doivent s’inscrire dans des projets qui ne sont pas souvent les leurs ».
Dans un prochain article, David Poteaux décrira comment les éleveurs peuls de la zone dite des trois frontières ont été pris au piège du Jihad armé

































