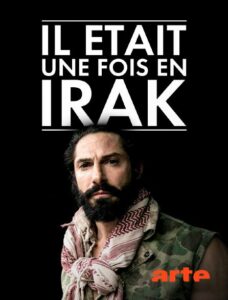Un récit choral en trois parties retrace, à hauteur d’hommes, le désastre irakien depuis l’invasion américaine à la reconquête des territoires conquis par Daech. Vertigineux.
Une chronique d’Olivier Toscer
« Les dirigeants politiques se sont exprimés. A présent, c’est au tour des civils, des journalistes et des militaires de prendre la parole pour nous raconter leur guerre d’Irak » : la voix off qui ouvre la série Il était une fois en Irak, cadre toute l’ambition du documentaire de James Bluemel : raconter une autre histoire d’un conflit dont les ondes de choc ne finissent pas d’influer sur les affaires du monde, encore aujourd’hui. Et, au delà des dates, des batailles et des attentats, de sonder le cœur des hommes et des femmes qui l’ont vécu. « C’est un miracle que je sois encore là pour en parler », dit Omar Mohammed, le militant à l’origine du blog « Mosul Eye » qui a documenté le quotidien de sa ville sous emprise djihadiste à partir de 2014 avant de devoir fuir à l’étranger.
Ce professeur d’histoire trentenaire mais également des reporters de guerre, des soldats des deux camps, une femme d’agriculteur, un chef de tribu ou une famille de Falloujah réfugié aux Etats-Unis avec leur jeune fils grièvement blessé, font résonner, dans le film, la désolation, la peine mais aussi l’instinct de survie et la générosité de ceux qui ont traversé un conflit aussi désastreux que mal préparé.
Rambos protecteurs
Dès l’arrivée des chars américains en mars 2003, le ton est donné. Les Américains se vivent en Rambo protecteur, les Irakiens, privés de repères ressentent eux surtout l’angoisse du vide Certes, Saddam était un dictateur mais « à part de lui, on était protégé de tout », résume un des protagonistes du film.
La première faille est donc déjà là, béante. Car si les opérations militaires avaient été minutieusement mûries dans les états-majors yankee, rien n’avait été prévu pour gérer l’après, le quotidien d’un Etat violemment décapité, d’un pays soudainement déboussolé. Personne n’avait non plus pris la mesure de la profonde méfiance du peuple irakien vis-à-vis de Washington depuis la première guerre du Golfe qui avait vu les Américains se laver les mains face à la répression d’une insurrection chiite qu’ils avaient encouragés avant de s’en désintéresser, une fois leur approvisionnement en pétrole dans la région, sécurisé
Dès leur entrée dans un Bagdad sans électricité, ni eau courante, les pillages se multiplient. Une sorte d’anarchie désespérée se diffuse de rues en rues, sous le regard impavide des GI’s, à qui personne n’a demandé de devenir des shérifs en ville mais seulement de protéger un unique bâtiment officiel : le ministère irakien du pétrole… Une sorte d’aveu en quelque sorte sur les tenants et les aboutissants de l’opération Iraki Freedom.
Un ancien colonel de l’armée américaine se souvient pourtant que sa mission, sitôt la vingtaine de jours de combat contre l’armée de Saddam achevée, devait être « la conquête des cœur et des esprits ». Cette bataille-là, les Américains l’ont perdu quasiment dès le premier jour. Les Etats-majors et les néo-cons de Washington ne voulaient pas le voir. Mais à entendre le reporter du New York Times Dexter Filkins ou le photojournaliste anglais Ashley Gilbertson, le désastre était déjà prévisible.
La mécanique du désastre
Pendant près de trois heures, le récit du conflit vu par le prisme d’hommes ordinaires donc exempts de l’hubris des chefs militaires, des diplomates professionnels et des stratèges de la Maison-Blanche, chronique de façon quasi-chirurgicale la mécanique du désastre à l’œuvre en Irak depuis 2003.
Ce sont eux, qui donnent l’épaisseur d’une tragédie humaine à un conflit qui, de loin, pourrait paraître désincarné à tous ceux qui ne l’ont pas vécu dans leurs chairs. A travers leur parole mais aussi leurs silences et leurs digressions, mis en valeur par un montage parfaitement maîtrisé, le réalisateur anglais James Bluemel réussi à faire jaillir des paroles vraies. Il est, il est vrai servi par un casting d’intervenants maîtrisant l’art du récit à la perfection, comme souvent peuvent l’être les Américains rompus à la culture de l’image et de la parole. Petit à petit, au travers de leurs histoires personnelles racontées en contrepoint des communiqués de victoires claironnées, à longueur d’archives par les responsables politiques occidentaux, ces témoins tissent les fils de la grande histoire, qui s’éclaire avec une acuité que n’auront jamais les cours de géopolitique trop souvent livrés aux téléspectateurs sur ce type de sujets.
« Les graines de Daech »
Avec le récit de ces témoins, la façon dont ils ont ressenti les évènements, les lourdes erreurs des premiers mois de l’occupation deviennent évidentes : l’absence de toute administration provisoire favorisant pénurie et chaos, la « débaassisation » du pays, mortifère dans la mesure où elle signifiait le désoeuvrement et la rancœur de dizaines de milliers de fonctionnaires et enfin la dissolution de l’armée régulière, sorte d’incitation pour les concernés à passer avec armes et bagages dans la Résistance qui prendra bientôt la forme de l’organisation terroriste Al Qaïda en Irak puis de l’Etat islamique. « Nous avons semé les graine de Daech dès 2003 », reconnaît le lieutenant-colonel Nate Sassaman, un as de l’US Army plein de bonnes intentions au départ mais qui démissionnera bientôt dégoûté à jamais par la violence qui, peu à peu, l’avait gagné en guerroyant contre une résistance irakienne protéiforme et insaisissable.
Le film illustre bien cette descente aux enfers de l’ancien royaume de Babylone tour à tour cadenassé par Saddam, bousculé par l’armée américaine, fracturé par la résurgence de l’opposition entre sunnistes et chiites. Jusqu’à l’arrivée de l’Etat islamique et son cortège de crimes contre l’humanité. « A côté de Daech, les gens d’Al Qaïda avaient l’air de petits rigolos », grince avec l’ironie masquant le désespoir, Walid Raabia, fixeur irakien pour journalistes étrangers.
Forcé à l’exil au Canada après des menaces islamistes contre sa personne, le jeune homme symbolise cet Irak en miettes.
« Il était une fois en Irak », 3×52 minutes, réalisé par James Bluemel, disponible sur arte.tv jusqu’au 29 mars 2022.