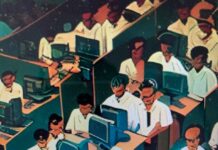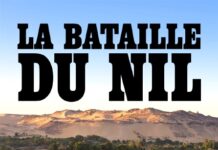Le retour à la Maison Blanche de Donald Trump a été ponctué de plusieurs déclarations annonçant sa volonté de mener des coups de force unilatéraux. Les propos tenus par le président des États-Unis le 4 février dernier lors d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et réitérés à plusieurs reprises depuis sur une potentielle prise de contrôle de la bande de Gaza pour la transformation en nouvelle Riviera et en expulser les quelque 2 millions de personnes qui y survivent aujourd’hui dans des circonstances épouvantables symbolisent de manière spectaculaire une approche qui consacre la primauté de la force sur le droit.
En adoptant une telle posture, Donald Trump oublie simplement la menace existentielle qu’une telle proposition représente pour les principaux alliés des États-Unis dans le monde arabe, en particulier l’Égypte et la Jordanie. Son erreur de jugement place également le prince héritier séoudien, Mohammed ben Salmane (MBS), artisan des Accords d’Abraham dans une situation très inconfortable. Ce qui explique les nombreuses déclarations de dirigeants séoudiens, alliés traditionnels de Washington, contre les propositions de Donald Trump. Bien qu’ils ne soient pas totalement morts, la relance des Accords d’Abraham supposerait en effet une diplomatie américano-israélienne beaucoup moins brutale et plus réaliste.

L’Arabie saoudite, sous la direction du prince héritier Mohammed ben Salmane, a toujours plaidé, surtout après la guerre de Gaza, en faveur d’une normalisation avec Israël qui s’accompagnerait de l’établissement d’un État palestinien indépendant. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a réaffirmé cette position, appelant au respect de l’Initiative de paix arabe et rejetant toute forme de déplacement des Palestiniens.
Le prince Turki Al-Faisal, ancien chef du renseignement saoudien et ambassadeur aux États-Unis, a été un critique virulent de la proposition de Trump, la qualifiant de « plan insensé de nettoyage ethnique » qui aggraverait le conflit et provoquerait un bain de sang. S’adressant directement à Trump, il a déclaré : « Le peuple palestinien n’est pas un immigrant illégal à expulser vers d’autres terres », et a fait valoir que si un déplacement devait avoir lieu, les Palestiniens devraient être autorisés à retourner dans leurs foyers d’origine à Haïfa et Jaffa plutôt que d’être déplacés une fois de plus.
Un indicateur frappant du sentiment saoudien est venu de Yousef bin Trad Al-Saadoun, membre du Conseil de la Choura saoudien, qui a ironiquement suggéré que si le déplacement était la solution, les Israéliens devraient être envoyés au Groenland ou au Canada plutôt que de forcer les Palestiniens à quitter Gaza. Cette rhétorique souligne l’opposition ferme du Royaume à l’initiative de Trump.
Les Séoudiens vent debout
La proposition de Trump menace à la fois les ambitions régionales et la stabilité interne des Séoudiens. Le Royaume cherche toujours à se positionner comme un leader du monde musulman. Le soutien d’un plan rappelant la Nakba minerait sa crédibilité tout en alimentant le sentiment anti-saoudien. De plus, à la suite de la guerre de Gaza, un sentiment pro-palestinien et anti-israélien grandissant parmi la jeunesse saoudienne a encore durci la position du Royaume.
Les projections des Séoudiens pour l’avenir du Moyen Orient présentées dans « Vision 2030 » supposent un Moyen-Orient stable. Le déplacement des Palestiniens saperait directement les efforts de diversification économique saoudiens. Or Riyad semble privilégier ses intérêts stratégiques à long terme par rapport aux relations à court terme avec les États-Unis. Tout accord de normalisation reste conditionné à la création d’un État palestinien mise à mal par l’approche de Trump. En fin de compte, le prince héritier saoudien se retrouve en désaccord avec la politique de « non-concessions » de Netanyahu et la philosophie de la terre brûlée appliquée à Gaza, à la Syrie et au Liban par le Premier ministre israélien. Les dividendes attrayants offerts par les conditions généreuses des Accords d’Abraham initiaux supposent la stabilité des régimes comme l’Égypte, la Jordanie, la nouvelle Syrie, et même un Irak enfin apaisé.
La position ferme de l’Arabie saoudite, si elle réussit à dissuader Trump de poursuivre le déplacement forcé, pourrait renforcer son rôle en tant que négociateur. Mais existe-t-il un dirigeant israélien prêt à négocier sur ces nouvelles bases?
L’afflux des Palestiniens en Égypte: une ligne rouge
Pour l’Égypte dont le gouvernement est resté inactif alors que des enfants palestiniens étaient massacrés, la perspective d’accueillir des Palestiniens déplacés est une ligne rouge. Un afflux de Palestiniens pourrait raviver l’activité djihadiste, menaçant une sécurité nationale déjà fragile ainsi que la sécurité du canal de Suez. Le traité de paix de longue date de l’Égypte avec Israël ferait face à une opposition nationale immense si Le Caire était perçu comme complice d’un déplacement forcé. En outre, le plan de Trump marginalise le rôle traditionnel de médiation de l’Égypte, poussant Le Caire vers une posture plus conflictuelle à l’égard de Washington. L’Égypte a déjà cédé un terrain significatif au Qatar dans le processus de médiation et, de manière générale, a été en deçà des attentes dans les négociations de cessez-le-feu.
Autrefois saluée comme une percée dans les relations arabo-israéliennes et un point d’entrée pour une participation plus large, l’implication de l’Arabie saoudite dans les Accords d’Abraham est désormais en suspens. L’hypothèse de Trump selon laquelle Riyad suivrait les Émirats arabes unis et Bahreïn dans la normalisation s’est effondrée face aux réalités régionales. Cependant, la porte reste légèrement ouverte—sous des conditions beaucoup plus strictes. Avant la guerre de Gaza, il y avait des spéculations selon lesquelles Riyad pourrait accepter des concessions palestiniennes symboliques en échange d’une normalisation. Cependant, l’agression israélienne et l’approbation du déplacement par Trump ont fermé cette voie, à moins qu’Israël ne fasse des compromis significatifs. Le roi Abdallah II a qualifié le déplacement forcé de « déclaration de guerre », tandis que l’Égypte a averti qu’elle romprait ses liens en cas d’expulsions massives. Le Qatar, le Koweït et l’Algérie se sont joints à l’Arabie saoudite et à l’Égypte pour rejeter la normalisation sous ces conditions, s’unissant contre toute tentative américano-israélienne de modifier la situation palestinienne par la force. En outre, certains régimes qui attendaient leur tour pour rejoindre les Accords d’Abraham craignent désormais que les répercussions du projet de Trump pour Gaza ne renforcent encore davantage le Hamas et ne ravivent les réseaux de résistance dans la région.
L’échec de Trump à reconnaître les craintes existentielles que son projet pour Gaza suscite chez ses principaux alliés arabes est une erreur stratégique fondamentale. En ignorant l’insistance de l’Arabie saoudite sur la création d’un État palestinien, il a créé des obstacles insurmontables aux efforts de normalisation dirigés par les États-Unis. Pourtant, les Accords d’Abraham ne sont pas irrémédiablement perdus. Si le rejet ferme de l’Arabie saoudite force Trump à reculer, Riyad pourrait émerger avec un levier de négociation renforcé. La véritable question est de savoir si un dirigeant israélien est prêt—ou politiquement capable—de répondre à ces nouvelles exigences plus strictes. Pour l’instant, les Accords d’Abraham restent dans un coma artificiel, attendant soit leur effondrement final, soit une reconfiguration sous des conditions plus sévères.
Le pari inédit de Donald Trump sur Gaza pourrait, en fin de compte, remodeler la diplomatie du Moyen-Orient d’une manière qu’il n’avait lui même jamais anticipée.
La diplomatie de Donald Trump n’a ni amis, ni ennemis, mais des intérèts