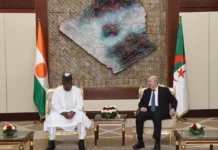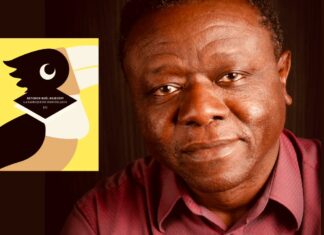L’Algérie a présenté début octobre son projet de loi de finances pour 2026 (PLF 2026), un texte d’une ampleur inédite : plus de 17 600 milliards de dinars, soit environ 135 milliards de dollars au taux officiel. Mais derrière les chiffres officiels d’une économie que le gouvernement assure « en relance », deux institutions concentrent à elles seules une part démesurée du budget : l’armée et la présidence de la République.
Alger, correspondance
Le ministère de la Défense nationale demeure de très loin le premier poste de dépense de l’État. Selon les estimations issues du projet gouvernemental et relayées par la presse algérienne, le budget militaire pour 2026 atteint 3 205 milliards de dinars — l’équivalent de 25 milliards de dollars —, soit près de 20 % du budget total du pays.
L’enveloppe militaire se répartit entre la défense du territoire (908 milliards DA), la logistique et le soutien (861 milliards DA), et une vaste rubrique d’administration générale (1 736 milliards DA) dont le contenu reste flou. Cette dernière, la plus importante, regroupe les dépenses dites de « souveraineté » : acquisitions d’équipements, entretien des bases, infrastructures, et programmes classifiés.
Le budget social sacrifié
En trois ans, le budget militaire algérien a augmenté d’environ 30 %, passant d’environ 18 milliards de dollars en 2024 à 25 milliards en 2026. Une progression qui contraste avec la stagnation des dépenses sociales et éducatives, et qui propulse l’Algérie au rang des premiers budgets de défense d’Afrique, devant l’Égypte et le Maroc, selon les estimations croisées des économistes locaux et de la presse spécialisée.
Pour le pouvoir, cette expansion se justifie par la « conjoncture régionale » et la nécessité de « préserver la souveraineté nationale ». Mais aucun document public n’expose la stratégie militaire, les objectifs de modernisation ni les indicateurs de performance associés à ces montants colossaux.
Aucun contrôle parlementaire effectif n’est prévu : la commission des finances de l’Assemblée populaire nationale n’a ni le droit de modifier, ni même d’auditer, les lignes relevant de la Défense.
La Présidence, une boîte noire budgétaire
Si le budget de ka Défense est chiffrée, la Présidence de la République reste hors champ statistique. Ni le PLF 2026, ni les communiqués officiels, ni même les documents annexes ne mentionnent le montant global des crédits alloués à la Présidence. Les seules traces apparaissent dans le Journal officiel, à travers une série de décrets de transferts de crédits effectués en 2025 vers le budget de la Présidence pour des dépenses de fonctionnement, de communication et de représentation.
En d’autres termes, les crédits présidentiels sont ajustés au fil de l’année, sans plafond ni justification publique. Ce flou budgétaire contraste avec les pratiques exigées par la loi organique algérienne sur les lois de finances (n°18-15), censée garantir la transparence et la lisibilité des dépenses publiques. Mais cette loi reste largement inapplicable dans un système où le président concentre la quasi-totalité du pouvoir exécutif et budgétaire.
Des anomalies structurelles
Au-delà de ces deux institutions, plusieurs anomalies marquent le PLF 2026 :
-
le budget de la Défense dépasse de très loin ceux combinés de l’Éducation nationale, de la Santé et de l’Agriculture ;
-
les recettes hors hydrocarbures stagnent alors que la dépense publique atteint des niveaux record ;
-
le déficit public, estimé à 12,4 % du PIB, repose presque exclusivement sur la rente énergétique ;
-
enfin, la Présidence et les services de sécurité ne sont soumis à aucun audit public, malgré leur poids financier croissant.
En clair, l’État algérien continue de fonctionner comme un appareil politique avant d’être un instrument économique : la dépense militaire et présidentielle sert avant tout à garantir la loyauté des élites et la stabilité du régime.
La logique de redistribution ou d’investissement productif reste secondaire.