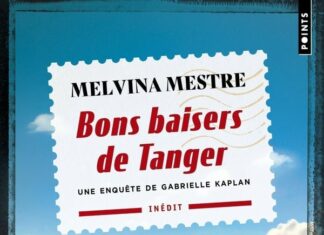La convergence entre paralysie politique, fragilité sécuritaire et colère populaire crée un moment extrêmement dangereux. La conférence Berlin III n’est plus une simple réunion diplomatique, mais une tentative internationale désespérée pour éviter un effondrement total ou une nouvelle guerre. L’assassinat de Ghniwa et les protestations qui ont suivi ne sont que les symptômes d’un système au bord de l’implosion, où les mécanismes internes de résolution ont échoué, rendant une intervention extérieure indispensable pour éviter la catastrophe.
La tenue de la troisième conférence de Berlin s’inscrit dans la continuité du processus lancé en 2020 visant à forger un consensus international et à encadrer une solution à la crise libyenne. Toutefois, sa composition et son agenda – officiel comme officieux – révèlent une évolution dans l’approche internationale, motivée par l’échec des tentatives précédentes.
Berlin 1 (janvier 2020) : Des fondations fragiles et violées
Tenue durant l’offensive du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli, la conférence affichait des objectifs ambitieux : unifier la position internationale, faire respecter l’embargo sur les armes, et lancer un processus politique tripartite.
Si le communiqué final[8] et la création de la Commission 5+5 constituaient des avancées formelles, les violations immédiates des engagements – notamment par les signataires eux-mêmes – vidèrent la conférence de sa substance. Le marginalisation des acteurs libyens sapait par ailleurs le principe de « solution libyenne ».
Berlin 2 (juin 2021) : L’illusion électorale
Convoquée dans un contexte plus favorable (cessez-le-feu, gouvernement d’union nationale), cette édition ciblait les élections de décembre 2021 et le retrait des mercenaires.
Mais l’absence de mécanismes contraignants aboutit au même scénario : report des élections, maintien des forces étrangères. Le député libyen Abdulmonem Al-Arfi résume ce cycle : « Berlin 3 ne différera pas de ses prédécesseurs faute de garantises ».
Le rôle Central de l’ONU
Contrairement à la première conférence de Berlin, où les acteurs libyens avaient été relativement marginalisés[4], cette troisième édition cherche à les impliquer plus activement. Les principaux interlocuteurs libyens restent cependant les dirigeants des institutions rivales :
- Le Gouvernement d’Union Nationale(GUN)
- La Chambre des Représentants(basée à l’Est)
- Le Conseil d’État(à Tripoli)
Leur intransigeance est considérée comme la cause principale de la persistance de la crise.
Sur le plan international, la liste des participants devrait inclure les membres du Processus de Berlin :
- Les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité (États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France)
- Les puissances régionales ayant une influence directe sur le dossier libyen : Turquie, Égypte, Émirats Arabes Unis, Italie, Algérie et Congo.
L’Agenda Officiel (et Officieux)
Officiellement, la conférence devrait poursuivre les trois axes définis depuis le début du processus :
- La Voie Politique (Priorité absolue):
- Briser l’impasse sur la base constitutionnelleet les lois électorales.
- Établir une feuille de route claire et chronométréepour des élections présidentielles et législatives.
- La Voie Sécuritaire:
- Consolider le cessez-le-feude manière permanente.
- Progresser vers l’unification des institutions militaires(en s’appuyant sur le travail du Comité Militaire Commun 5+5).[5]
- Mettre en place un mécanisme exécutablepour le retrait des forces étrangères et des mercenaires.
- La Voie Économique:
- Résorber la division des institutions économiques.
- Garantir une répartition équitable et transparente des revenus pétrolierspour éteindre une source majeure de conflit.
L’Agenda Caché : La Proposition d’un « Comité des 60 »
Au-delà de ces priorités affichées, des rapports concordants évoquent un objectif non déclaré mais central : la création d’un nouvel organe politique, le « Comité des 60 ».
- Ce comité, s’il voit le jour, serait chargé de contourner la Chambre des Représentants et le Conseil d’État, considérés comme dans une impasse.
- Il aurait pour mission :
- Finaliser les lois électorales.
- Sélectionner un nouveau gouvernement transitionnel.
- Superviser l’organisation d’élections dans un délai de 18 à 24 mois.
Un changement stratégique risqué
Cette initiative marque un tournant dans l’approche internationale :
- Elle constitue un aveu implicite que les institutions libyennes actuelles sont devenues l’obstacle principal à la paix.
- Après des années de négociations infructueuses – utilisées par leurs dirigeants pour prolonger leur maintien au pouvoir –, la nouvelle stratégie vise à les contourner plutôt qu’à les réformer.
Berlin III n’est pas une simple réunion de routine, mais une tentative de réinitialisation politique, avec des risques élevés. La proposition du Comité des 60 reflète une perte de patience envers les acteurs libyens, mais son implémentation reste un pari incertain dans un pays déjà fracturé.
Une dynamique nouvelle?
Ce paysage international complexe fait de Berlin bien plus qu’une plateforme de dialogue entre Libyens : c’est aussi une arène de négociations entre puissances étrangères. Les bouleversements globaux (guerre en Ukraine, crise énergétique) ont modifié leurs calculs :
- Les priorités des États-Unis et de l’Allemagne ne sont plus de soutenir un camp contre l’autre, mais de « gérer le chaos »pour éviter une explosion.
- Même des rivaux régionaux comme la Turquie et l’Égypte explorent un rapprochement prudent pour gérer leurs différends libyens.
Le succès de Berlin III dépendra de la capacité à traduire ce fragile consensus sur la « gestion de la stabilité » en une pression unifiée et tangible sur les acteurs libyens. Le risque ? Que les puissances se contentent d’un accord superficiel maintenant le statu quo, gelant le conflit sans le résoudre puisqu’incapable d’établir un mécanisme contraignant de mise en œuvre des décisions