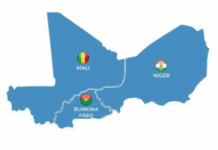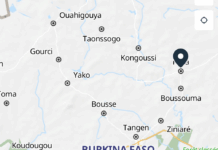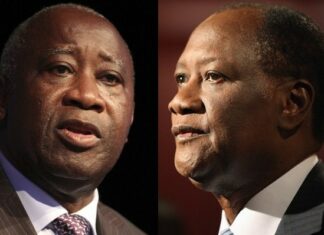La crise malgache a de multiples causes, mais le succès de la mobilisation de la société – avant tout de la jeunesse – tient en grande partie à la place désormais centrale des réseaux sociaux. Ce sont eux qui ont facilité la diffusion des discours hostiles au pouvoir, qui ont permis la coordination des actions de protestation et qui ont offert aux militaires en rupture de ban avec le gouvernement une plateforme pour exprimer leur ralliement à la révolte, qui vient d’aboutir à la proclamation de la destitution du président par l’Assemblée nationale.
Un article du site « The Conversation » qui nous autorise à le reprendre
Le 25 septembre 2025, la capitale de Madagascar a basculé dans une crise socio-politique de grande ampleur. Ce qui avait commencé comme une contestation locale contre les délestages électriques récurrents s’est transformé en mouvement de protestation national porté, entre autres, par une jeunesse massivement connectée et amplifié par les réseaux sociaux.
En quelques jours, les manifestations se sont étendues. Le bilan de la répression, contesté par le gouvernement malgache, s’élèverait à 22 morts et 100 blessés selon le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU. Le gouvernement a été dissous, une unité de l’armée (le Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques, CAPSAT) a rejoint les manifestants pour s’approprier la symbolique place du 13 Mai, symbole de victoire contre le pouvoir en place.
Le président de la République Andry Rajoelina a quitté le pays le 12 octobre, exfiltré par un avion militaire français. Alors qu’il refuse de démissionner et dénonce ce qu’il qualifie de tentative de prise du pouvoir par la force, affirmant par ailleurs avoir été victime d’une tentative d’assassinat, l’Assemblée nationale vient ce 14 octobre de voter sa destitution et une unité de l’armée ralliée aux protestataires a affirmé avoir pris le pouvoir.
Si les suites immédiates des événements actuelles ne sont pas évidentes à prévoir, il est déjà possible d’analyser les mécanismes qui ont permis une mobilisation si rapide et si efficace des contestataires. Il apparaît que l’information – sa circulation, ses cadrages, ses temporalités – est devenue un champ de bataille politique central. À Madagascar comme ailleurs, le pouvoir se joue également dans l’espace public numérique.
Une lecture de cette séquence malgache avec les outils des sciences de l’information et de la communication (SIC) permet de comprendre comment les réseaux sociaux peuvent catalyser une mobilisation, fragiliser des régimes politiques et redéfinir les rapports entre citoyens, médias et institutions.
Commencez votre journée avec des articles basés sur des faits.
Un basculement politique façonné par l’information
Dès les premiers jours, des vidéos montrant les pillages et les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont massivement circulé sur les réseaux sociaux.
Ces images, souvent filmées par des citoyens ordinaires, ont eu un double effet.
D’un côté, en mettant crûment en évidence la perte de contrôle de la part des autorités et leur recours à la violence, elles ont nourri l’indignation collective. De l’autre, elles ont contribué à structurer une narration politique de la crise : celle d’un peuple en résistance face à un pouvoir lui apparaissant comme défaillant.
Cette dynamique repose sur le principe de la puissance de cadrage des images virales. Autrement dit, ce qui compte, ce n’est pas seulement ce qui est montré, mais la manière dont ces contenus circulent, sont commentés et s’agrègent dans des temporalités extrêmement courtes.
Dans un contexte où les médias traditionnels malgaches adoptent, dans le traitement de l’information, une posture prudente – souvent marquée par l’autocensure ou une proximité avec les récits officiels –, les plates-formes numériques s’imposent comme l’arène centrale de production et de légitimation des discours politiques. Cette configuration évoque ce que Bernard Miège (2007) décrit comme « une société conquise par la communication », où les flux informationnels structurent les rapports sociaux plus rapidement que les institutions ne peuvent réagir.
La génération Z, un nouvel acteur politique
La mobilisation malgache a été portée par la génération Z : de jeunes urbains connectés, familiers des codes numériques, souvent critiques à l’égard des élites politiques. Ils ne se sont pas contentés de consommer de l’information. Ils l’ont produite, relayée et scénarisée collectivement.
Des hashtags coordonnés (#RajoelinaDémission, ###May13) ont rythmé la contestation ; des cartes collaboratives signalant des barrages routiers ont été diffusées en temps réel ; des lives Facebook ont transformé chaque moment, chaque événement, en tribune politique.
Ce fonctionnement horizontal, sans leader unique, a dérouté les institutions. C’est l’illustration même de la mutation de l’espace public. En même temps que des organisations structurées (partis, syndicats), des réseaux d’individus connectés produisent et amplifient l’action collective, s’inscrivant dans un espace public numérique agonistique, c’est-à-dire un espace où la confrontation d’opinions, d’émotions et de récits se substitue aux formes traditionnelles de délibération publique. Dans ce contexte, le pouvoir ne repose plus uniquement sur le contenu des messages, mais sur la capacité à connecter et à mobiliser des publics actifs capables d’imposer leur propre rythme au débat politique.
Ingérences et vulnérabilité informationnelles
La crise malgache n’est pas seulement endogène. Des signaux montrent une synchronisation inter-plateformes et la diffusion rapide de hashtags à partir de comptes étrangers potentiellement liés à des réseaux activistes régionaux ou à des acteurs hybrides, dans des dynamiques de cyberactivisme et géopolitique numérique.
Mais dans un pays où l’État ne dispose d’aucune stratégie structurée de veille et de riposte informationnelle comparable à Viginum en France, force est de constater que le terrain est ouvert aux campagnes d’amplification externes, qui exploitent les émotions collectives pour accentuer la polarisation interne.
Cette situation révèle une vulnérabilité communicationnelle structurelle, c’est-à-dire l’incapacité de nombreuses démocraties fragiles à anticiper les dynamiques informationnelles transnationales. Elle pose ainsi la question de la souveraineté informationnelle – un enjeu désormais crucial, au même titre que la sécurité militaire ou énergétique.
L’armée entre dans l’arène numérique
Lorsque les soldats du CAPSAT décident de soutenir les manifestants, la première bataille ne se joue pas dans la rue mais sur les réseaux sociaux. Des vidéos montrent les militaires marchant aux côtés de la foule. Ces images sont diffusées en direct, partagées en boucle et commentées massivement.
Avant même d’entreprendre une action militaire concrète, l’armée agit symboliquement dans l’espace numérique. Cette mise en scène publique a des effets politiques immédiats car elle fragilise l’autorité du président, donne confiance aux manifestants et fait basculer l’équilibre des forces dans l’imaginaire collectif.
En SIC, on parle de performativité communicationnelle. Cela signifie que communiquer devient un acte en soi, capable de produire des effets réels. Les images et les messages des militaires ne sont pas de simples témoignages. Ils transforment directement la situation politique. Dans cette perspective, l’armée ne se contente plus d’être une force armée traditionnelle ; elle devient aussi un acteur médiatique capable d’influencer l’opinion et les rapports de pouvoir à travers le numérique et le symbolique.
C’est cette hybridation entre action militaire et communication en ligne qui caractérise de nombreuses crises politiques contemporaines. Lors du coup d’État au Myanmar en 2021, les militaires ont diffusé en direct leurs prises de contrôle pour imposer une narration de légitimité ; pendant la révolution égyptienne de 2011, l’armée a utilisé Facebook et la télévision pour s’allier symboliquement au peuple ; au Soudan en 2019, des factions militaires ont relayé en ligne leurs positions politiques avant de mener toute action physique, contribuant à la recomposition des rapports de force internes.
Une grille de lecture info-communicationnelle
Pour analyser cette séquence, on peut mobiliser une grille de lecture simple, articulée autour de quatre dimensions :
-
Les acteurs : jeunes, diasporas, autorités, plates-formes numériques ;
-
Les médias : Facebook, TikTok, vidéos citoyennes, hashtags, livestreams ;
-
La temporalité : l’accélération, la simultanéité des actions en ligne et hors ligne ;
-
Les effets politiques : la délégitimation du pouvoir, la fragmentation de l’autorité et la recomposition des alliances.
Cette grille permet de dépasser une lecture purement événementielle pour comprendre les logiques structurelles à l’œuvre. Le cas malgache peut être rapproché d’autres épisodes récents comme le mouvement des jeunes au Sénégal en 2024 ou les récentes mobilisations de la génération Z au Maroc. Tous ont en commun ces caractéristiques : une mobilisation numérique horizontale, une déstabilisation rapide des élites et une hybridation des espaces d’action.
Un laboratoire pour penser les nouveaux espaces publics
La crise malgache agit comme un révélateur en ce sens qu’elle montre comment les réseaux sociaux ne sont pas de simples canaux de communication mais des infrastructures politiques capables d’organiser la contestation, de recomposer des alliances et d’affaiblir voire de défaire des pouvoirs établis. Elle illustre ainsi la nécessité pour les États de développer une gouvernance de l’information articulant communication publique, éducation numérique, dispositifs de veille et médiation démocratique. Sans cela, les sociétés s’installent dans une vulnérabilité aux dynamiques virales incontrôlées et aux manipulations externes.
La crise malgache ne peut donc se comprendre uniquement à travers les prismes politique ou économique. Elle est aussi et surtout informationnelle, dans le sens qu’elle est produite, amplifiée et structurée par des dynamiques communicationnelles. Elle illustre la façon dont, dans des contextes de fragilité institutionnelle, les réseaux sociaux deviennent des instruments puissants capables de remodeler les rapports de pouvoir entre État, société et acteurs hybrides.
Face à ces transformations, les États comme les sociétés civiles doivent apprendre à naviguer dans un espace public devenu profondément numérique, fluide et conflictuel, un enjeu majeur de la gouvernance démocratique du XXIe siècle.