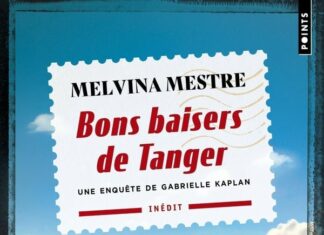Moins de deux mois après la mise en place d’un nouveau gouvernement, des inquiétudes surgissent face à des décisions qualifiées par certains observateurs comme relevant d’une « justice sélective », dirigée à l’encontre d’une catégorie particulière de la population malgache, les Merinas, une ethnie des Hauts plateaux qui fait les frais des arrestations, poursuites et détentions prolongées .
Dans une missive adressée au grand public, Zaza Ramandiambiarison ancien directeur de cabinet de Andry Rajoelina en 2010, partage ses appréhensions devant ce qu’il dénonce comme « une justice à géométrie ethnique », « des libérations arrangées entre gens de la même région », et des dossiers effacés en coulisses. Il déplore que le président de transition qui, au lieu d’apaiser, laisse planer l’idée d’une candidature future. Les statistiques montrent, estime-t-il, que ce sont les Merinas sont les premiers visés par les mesures de répression, tandis que les originaires d’autres régions, accusés de détournements massifs, se promènent librement, ou sont libérés en grande pompe grâce à des « réseaux régionaux, des alliances locales, et des loyautés ethniques ».
Le Journal de l’Ile Rouge (JIR) du 17 novembre confirme d’ailleurs ces faits en notant que Anthelme Raparany, l’ancien ministre en exil accusé de trafic de bois de rose à Singapour, est « rentré au pays sans coup férir ». Il en est de même pour l’ex premier ministre Ravelonarivo, mis en cause dans une des nombreuses affaires d’exactions au sein de la CNAPS (caisse nationale de prévoyance sociale) et qui a pu bénéficier de la protection de personnalités du régime de transition. L’ex-Directeur général de l’ACM (Aviation civile de Madagascar), impliqué dans l’affaire des Boeings livrés frauduleusement à l’Iran, est sorti de la prison sans procès. JIR présente la situation comme « une revanche des côtiers » et ne réfute pas l’existence d’une connotation politique dans la prise de ces différentes dispositions.
Et Zaza Ramandimbiarison de s’alerter : « C’est ainsi que naissent les purges. C’est ainsi qu’on fabrique le terreau du génocide. Et pourtant, aucun responsable socio- politique ne semble vouloir reconnaître la gravité du moment. On joue avec les nerfs du pays comme avec une allumette au-dessus d’un bidon d’essence ».
Madagascar semble donc atteindre, une fois de plus, un point critique. Comme à chaque crise politique majeure que traverse le pays, le spectre du tribalisme et du conflit ethnique ressurgit. L’on se souvient que lors de la révolution de 1972, les Merinas ont été chassés de la ville de Tamatave, le grand port situé sur la Côte est de Madagascar. En 1974, la rébellion des forces de police et des officiers côtiers conduits par le Colonel Bréchard Rajaonarison planifiait « la destruction de la ville de Tananarive », capitale historique du royaume merina et devenu capitale de Madagascar. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, en date du 19 février 2002, Didier Ratsiraka, Président sortant, accusait son rival Marc Ravalomanana de vouloir asseoir la domination de la haute bourgeoisie merina sur la Grand Ile. Il s’en est ensuivi l’érection par Ratsiraka et ses partisans d’un blocus meurtrier contre la capitale. En 2009, la mutinerie ayant conduit à l’éviction du président Marc Ravalomanana fut menée au départ par le C.O.C (« collectif des officiers côtiers »).
C’est dire que le contentieux ethnique Merina-Côtier, bien que basé le plus souvent sur des représentations mentales floues et embrouillées, n’en reste pas moins vivace surtout en période de crise. Il est entretenu par les traditions orales, les coutumes et les fady (tabous), qui parfois se rattachent aux conflits issus de la tentative d’unification du pays par la royauté merina au XIXe siècle. Ainsi, dans le Nord de l’ile, il existe même de nos jours des endroits où les originaires des hauts plateaux ne peuvent visiter.
La dominance historique des Merinas a causé des tensions intérieures au pays, qui ont été plus tard utilisées par la puissance coloniale pour asseoir son emprise dans la grande ile et affaiblir en même temps la résistance. Dans son grand rapport de 1905, le général Gallieni (Gouverneur général de Madagascar) dépeignait ainsi l’une des facettes de la « politique des races » qui caractérisa sa gouvernance : « S’il y a des mœurs et des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu’il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes ». Ainsi naquit la doctrine anti-Merina que les successeurs de Gallieni appliquèrent fidèlement, comme le relevaient Hanotaux et Martineau dans un livre sur l’empire colonial français en 1933 : en ce qui concerne Madagascar, il fut recommandé d’une manière générale aux commandants de cercle de toujours se laisser guider par deux principes, politique des races et destruction de l’hégémonie des Hova (une autre appellation donnée aux originaires des hauts-plateaux).
A l’indépendance, diverses politiques ont été mises en œuvre pour atténuer la dominance de Tananarive et combler le retard des provinces côtières. Sous la deuxième république, l’Etat a ainsi créé des centres universitaires régionaux dans tout Madagascar. Afin de réduire le déficit en personnels d’encadrement, faute de jeunes provinciaux en formation supérieure, le baccalauréat est octroyé, dans les provinces côtières au début des années 1980, à 8/20. A la même époque, à Tananarive il n’est obtenu qu’à partir de 12/20. Dans la même foulée, des quotas réservés aux cadres côtiers sont établis dans les différents concours administratifs et dans l’accession aux emplois publics (fonctionnariat et sociétés d’Etat).
En ce troisième millénaire, les mentalités commencent à changer et l’entente nationale est plus ou moins effective dans les relations au quotidien entre Malgaches. Mais dans de nombreux cas, l’instrumentalisation des tensions historiques peuvent provoquer aujourd’hui encore des dissonances sociales. Les clichés sont tenaces, à un point tel que dans certains milieux, les Merinas sont toujours dépeints négativement comme des individus « malins, rusés, indignes de confiance, lisses de cheveux mais aussi glissant d’esprit » ! Certains Côtiers reprochent par ailleurs aux Merinas d’exploiter les provinces périphériques par le truchement de la centralisation administrative à outrance. Mais force est de constater que la revendication de la décentralisation est devenue un simple slogan politique pour les élites régionales qui, une fois arrivées au pouvoir central se coupent de leurs bases et deviennent des centralisateurs invétérés. Devant cet état de fait, de plus en plus de voix réclament l’instauration du fédéralisme pour briser ce qu’ils estiment être un « comportement prédateur des tananariviens ». De leur côté, les Merinas adhèrent de plus en plus ouvertement à l’idée du fédéralisme, considéré comme le gage d’une plus grande liberté de manœuvre politique et économique pour la province de Tananarive. Il faut en effet savoir qu’à elle seule, la région d’Analamanga (la commune urbaine de Tananarive et les districts qui lui sont adjoints) produit les 48% du PIB national malgache : en d’autres termes, c’est Tananarive qui fait vivre bon nombre de régions périphériques et non l’inverse !
La menace de l’anarchie est latente, surtout en cette période de transition où les rivalités politiques et ethniques prennent le pas sur les considérations d’intérêt général. Zaza Ramandimbiarison veut ainsi tirer la sonnette d’alarme, et insiste sur l’urgence de la mise en branle d’une transition équitable, apaisée et réellement nationale. Aujourd’hui plus que jamais, Madagascar a besoin, affirme-t-il, d’une justice indépendante, d’une transition strictement limitée à son mandat, d’une société civile lucide et ferme, et d’un discours politique qui rassemble plutôt que de diviser.