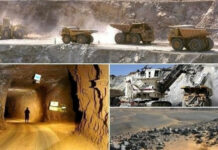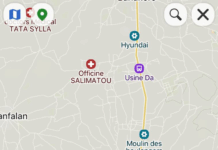Contesté depuis sa réélection en 2023, le président malgache est actuellement confronté à un vaste mouvement de fronde, porté par la jeunesse très connectée du pays, et déclenché par des coupures d’eau et d’électricité dues à une gouvernance défaillante. Un article du site « The conversation »
Le 25 septembre 2025, Antananarivo a basculé dans la violence. Ce qui avait commencé comme une manifestation de la « Génération Z » contre les coupures répétées d’eau et d’électricité s’est rapidement transformé en émeutes qui se sont soldées par des pillages de supermarchés, des incendies de résidences parlementaires et l’instauration d’un couvre-feu dans la capitale.
Le bilan, contesté entre l’ONU et la présidence malgache, est lourd. On compte au moins cinq morts et une dizaine de blessés. Les répercussions politiques immédiates sont également frappantes puisqu’on assiste dans un premier temps au limogeage du ministre de l’énergie puis quelques jours après à la démission du gouvernement.
Ces événements révèlent un phénomène majeur : à l’ère numérique, une panne d’infrastructure vitale n’est plus seulement technique. Elle devient le catalyseur d’un mécontentement social amplifié par les réseaux sociaux qui accélèrent la diffusion de la colère, lui donnent une dimension émotionnelle et en étendent la portée.
La crise malgache offre ainsi un cas d’école pour analyser ce que l’on peut appeler des vulnérabilités communicationnelles à l’intersection de la sûreté, des infrastructures et de la gouvernance.
L’électricité et l’eau sont les piliers de la sécurité humaine telle que définie par les Nations unies. Leur absence ne se traduit pas seulement par un inconfort mais par une mise en péril de la dignité et de la survie quotidienne. À Madagascar, où la pauvreté rend la population particulièrement vulnérable, les délestages répétés affectent la conservation des denrées, la sécurité des foyers et la continuité des activités économiques.jLa colère qui s’exprime dépasse donc la simple question technique mais traduit plutôt un déficit de confiance dans la capacité de l’État à remplir sa mission fondamentale. Ce phénomène n’est pas unique. En Afrique du Sud, les coupures d’électricité appelées « loadshedding » ont fragilisé le gouvernement et provoqué de multiples protestations. Au Nigéria, ce sont les pénuries de carburant qui déclenchent régulièrement des flambées sociales. Dans bien des cas, les carences des infrastructures vitales deviennent des points de bascule politique.
Les réseaux sociaux, caisses de résonance
Les mobilisations contemporaines se jouent désormais dans l’espace numérique. Comme l’a montré Manuel Castells, « la communication est le mouvement ». À Antanarivo comme dans d’autres régions touchées par les manifestations, Facebook, WhatsApp et TikTok ont servi de vecteur de mobilisation rapide. Des hashtags comme #LéoDélestage se sont imposés comme slogans partagés permettant à une génération connectée de donner une forme à son indignation.
Les réseaux sociaux ont rempli trois fonctions majeures :
Tout d’abord, ils sont permis de rassembler en quelques heures des milliers de personnes au centre-ville.
Ensuite, les images d’Antanarivo ont circulé dans des régions comme Antsirabe et Toasina, déclenchant un effet d’entraînement.
Enfin, les vidéos de pillages et d’incendies ont produit un effet ambivalent. Leur diffusion massive a, d’une part, suscité peur et indignation en renforçant la perception d’une perte de contrôle étatique ; d’autre part, leur viralité a donné une visibilité inédite au mouvement, tout en reconfigurant son image publique. Ces scènes ont simultanément servi de catalyseur de mobilisation pour certains et de facteur de dissuasion pour d’autres, façonnant la narration collective de la crise bien au-delà des événements factuels.
Cette logique de viralité, décrite par Dominique Cardon, repose sur la visibilité des émotions plus que sur la véracité des faits. Les réseaux sociaux transforment donc une revendication sociale en phénomène national, avec une rapidité et une intensité inédite.
La crise a mis en évidence ce que Louise Merzeau nomme la « mémoire – trace ». Chaque vidéo, chaque image partagée devient une archive immédiate inscrivant l’événement dans une temporalité irréversible. Mais cette mémoire est instable et extraite de son contexte, elle se recompose au fil des partages, nourrissant parfois la rumeur.
On identifie trois formes de vulnérabilités communicationnelles :
La première s’inscrit dans le registre de la confusion informationnelle.
Les contenus, qu’ils soient vérifiés, manipulés ou « étrangers » (c’est-à-dire produits en dehors du contexte local, par des acteurs internationaux ou par des comptes sans lien direct avec les événements), circulent simultanément, créant un bruit informationnel qui brouille la compréhension globale de la situation.
La seconde s’inscrit dans le silence institutionnel dans la mesure où l’État a tardé à communiquer, laissant les réseaux sociaux imposer leur propre récit. Comme le rappelle Yves Jeanneret, l’information est un dispositif social et l’absence de discours officiel crée un vide qui se comble ailleurs.
Enfin, les citoyens investissent massivement les plates-formes numériques comme un nouvel espace public de délibération et de mobilisation, réduisant encore la portée et la légitimité de la parole institutionnelle. La communication verticale de l’État se retrouve ainsi concurrencée par une horizontalité participative et émotionnelle.
La réponse par le couvre-feu illustre ce que Didier Bigo appelle la banalisation de l’exception sécuritaire. Ainsi, l’urgence justifie la restriction des libertés mais ne résout pas la cause structurelle, le déficit d’infrastructure et de confiance.
De la panne technique à la crise politique
Ces événements ne surgissent pas dans un vide politique. Depuis sa réélection en 2023, contestée, le président Andry Rajoelina fait face à une opposition qui dénonce à la fois la fragilité des infrastructures et la mauvaise gouvernance. La population malgache reste marquée par un cycle de crises politiques récurrentes où chaque dysfonctionnement devient un terrain d’affrontement entre pouvoir et opposition.
La crise des délestages a rapidement pris une dimension politique. Certains médias rapportent que des représentants de l’opposition ont pointé leur présence dans les manifestations, conférant au mouvement une coloration politique. Le sénat, de son côté, a dénoncé une « tentative de coup d’État ». Une rhétorique qui témoigne de la forte polarisation de la vie politique malgache.
Ce contexte accentue la défiance dans la mesure où les citoyens perçoivent moins les délestages comme des accidents techniques que comme le signe d’une incapacité structurelle de l’État. L’absence de réponse rapide et transparente a amplifié le déficit de confiance et a donné à la colère sociale une dimension directement politique.
À court terme, plusieurs scénarios demeurent ouverts :
La reprise des violences nocturnes à Antanarivo notamment dans les zones commerciales et périphériques.
L’extension régionale de la crise avec des mouvement qui ont déjà été signalés à Antsirabe et à Tamatave (mobilisation étudiante). Les grandes villes secondaires sont exposées par contagion.
La politisation accrue car la présence visible de députés d’opposition lors des manifestations montre une récupération progressive du mouvement.
Ces scénarios combinent un risque de désordre public, de perturbation économique et de crise politique.
La crise malgache illustre un nouveau paradigme. La sûreté à l’ère numérique ne se limite pas à la prévention de la violence physique mais implique la gestion d’un système plus complexe articulant trois types de vulnérabilités :
Les vulnérabilités matérielles caractérisées par les infrastructures vitales (énergie, eau, transport), les vulnérabilités symboliques caractérisées par la communication numérique (réseaux sociaux, viralité) et les vulnérabilités institutionnelles c’est-à-dire la gouvernance (légitimité, capacité de médiation)
C’est dans l’interaction de ces trois dimensions que naissent les crises. Comme l’écrivait Castells « le pouvoir est désormais dans le code et le flux ». Celui qui contrôle les infrastructures et les récits contrôle la stabilité sociale.
Un simple épisode de colère populaire ?
Les événements du 25 septembre à Madagascar ne sont pas un simple épisode de colère populaire. Ils constituent un cas paradigmatique de la façon dont, à l’ère numérique, une panne technique, bien qu’elle soit façonnée par un cadre culturel spécifique, peut devenir une crise sécuritaire amplifiée par les réseaux sociaux et révélatrice des fragilités de la gouvernance.
La sûreté contemporaine se joue autant dans la robustesse des infrastructures que dans la capacité à communiquer et à maintenir la confiance. En ce sens, Madagascar est un avertissement. La prochaine crise sécuritaire pourrait naître non pas d’un attentat ou d’un conflit, mais d’une coupure d’électricité partagée en direct sur les réseaux sociaux.