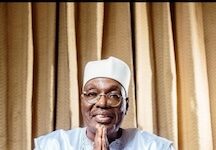Moins de vingt-quatre heures après la prise de pouvoir par les militaires à Madagascar, l’Union africaine (UA) annonçait la suspension immédiate du pays de toutes ses instances, dénonçant une “rupture de l’ordre constitutionnel”. Une réaction fulgurante, quasi-automatique, mais surtout incohérente au regard des précédents récents sur le continent.
Nivoary RANARISOA, membre de l’Association Observatoire de la Vie publique de Madagascar (AOVPM) et consultant en sécurité et gouvernance, spécialiste des questions institutionnelles et de souveraineté en Afrique.
Derrière les communiqués officiels, cette décision soulève une question essentielle : pourquoi l’UA se montre-t-elle si prompte à sanctionner certains États, tandis qu’elle ferme les yeux sur des dérives autrement plus graves dans d’autres pays ?
Cette inconstance fragilise la légitimité même de l’organisation continentale et révèle un malaise plus profond : le principe d’égalité entre nations africaines est devenu variable selon les intérêts géopolitiques du moment.
Chronique d’une crise politique annoncée
Depuis des mois, le climat social à Madagascar s’était dégradé : hausse du coût de la vie, coupures d’eau et d’électricité, corruption endémique, et fatigue démocratique.
Fin septembre, la contestation populaire s’étend à plusieurs villes du pays.
Face à cette crise, les forces armées refusent la répression. Le 12 octobre, une unité de la CAPSAT (Corps d’Administration et de Soutien de l’Armée de Terre) prend position pour éviter un bain de sang.
Le président Andry Rajoelina, de plus en plus contesté, quitte discrètement le territoire — exfiltré par un avion militaire français, selon plusieurs sources diplomatiques.
Pour l’Union africaine, le diagnostic est immédiat : “rupture de l’ordre constitutionnel”.
Mais pour une partie des Malgaches, c’est tout l’inverse : une tentative de restaurer une légitimité politique perdue depuis longtemps.
Deux poids, deux mesures
La suspension de Madagascar n’est pas un acte isolé : elle s’inscrit dans une longue tradition de sélectivité politique de l’Union africaine.
Lorsqu’un régime “allié” ou “utile” tombe, la réaction est immédiate. Mais quand la violation de la Constitution émane d’un pouvoir soutenu par des partenaires étrangers, le silence est d’or.
La Tunisie (2021) : Le président Kaïs Saïed dissout le Parlement, suspend la Constitution et gouverne par décret pendant plus d’un an. Aucune sanction.
La Côte d’Ivoire (2020) : Alassane Ouattara modifie la Constitution pour briguer un troisième mandat. L’UA se tait.
La Guinée (2020) : Alpha Condé fait adopter une nouvelle Constitution pour se maintenir au pouvoir. Réaction timide, jusqu’à sa chute.
La Tchad (2021) : À la mort d’Idriss Déby Itno, son fils Mahamat Déby prend le pouvoir par un coup d’État militaire, suspend la Constitution et installe un conseil militaire. Aucune sanction, mais un soutien diplomatique au nom de la “stabilité régionale”.
Et pourtant, à Madagascar, la réaction tombe en moins de 24 heures. Ce contraste est criant : ce n’est pas le principe qui guide l’Union africaine, mais la géopolitique.
La fin d’une imposture ?
Parler de “rupture de l’ordre constitutionnel” suppose qu’il existait encore un ordre crédible.
Or, le régime Rajoelina a multiplié les entorses à la démocratie : élections contestées, institution électorale politisée, concentration du pouvoir exécutif, érosion du contre-pouvoir judiciaire, et, pour couronner le tout, une controverse persistante sur sa nationalité française, révélée par le Journal officiel de la République française.
Cette révélation, bien que secondaire dans la crise actuelle, a fini de délégitimer un président déjà affaibli.
Elle pose une question de fond : comment l’Union africaine peut-elle défendre “la légalité constitutionnelle” d’un chef d’État dont la légitimité nationale est elle-même juridiquement contestable
L’Union africaine, entre dépendance et incohérence
L’UA agit souvent sous la pression des partenaires extérieurs. La France, l’Union européenne ou les États-Unis influencent directement ses positions, notamment au sein du Conseil de paix et de sécurité.
Ainsi, certains régimes sont “protégés” car ils garantissent une stabilité favorable aux intérêts géostratégiques ou économiques.
Mais cette logique affaiblit la crédibilité de l’Union africaine. En multipliant les décisions incohérentes, elle donne l’image d’une organisation plus soucieuse de préserver des équilibres politiques que de défendre les principes démocratiques.
Résultat : les peuples africains n’y voient plus une voix du continent, mais une chambre d’écho de la diplomatie occidentale.
La suspension du pays aura des conséquences.
–Diplomatiques: Madagascar est privé de représentation et de droit de vote au sein de l’UA et risque d’être écarté de la SADC.
–Économiques: les financements liés à des programmes continentaux peuvent être gelés.
–Symboliques: l’image d’un pays instable se renforce à l’international.
Mais cette crise offre aussi une opportunité historique : celle de refonder le système politique malgache sur des bases claires, équitables et réellement souveraines.
Madagascar peut devenir un cas d’école africain, démontrant qu’une transition ordonnée, sans tutelle étrangère, peut aboutir à un renouveau démocratique authentique.
La suspension de Madagascar révèle moins une crise institutionnelle qu’une crise morale de l’Union africaine. On ne peut pas prêcher la démocratie à Antananarivo et la taire à N’Djamena. On ne peut pas parler d’ordre constitutionnel quand certains chefs d’État s’éternisent au pouvoir en violant leurs propres Constitutions.
L’Afrique a besoin d’une Union crédible, équitable et indépendante — non d’une institution à géométrie variable.
Madagascar, malgré la tourmente, a l’occasion de montrer qu’il est encore possible de choisir la souveraineté sur la soumission, la cohérence sur la complaisance.
Le continent tout entier a les yeux tournés vers elle : non pas pour savoir si elle reviendra dans le giron de l’Union africaine, mais pour savoir si, enfin, un pays africain osera redéfinir le sens de la dignité et de la légitimité.
Madagascar refuse une économie basée sur la rente