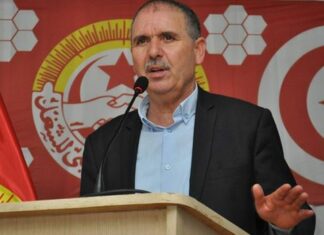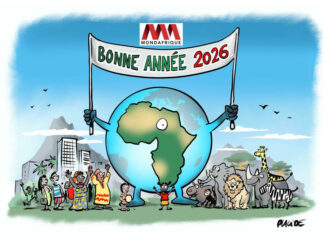Les indo-Pakistanais, dont les parents ont été de simples auxiliaires au service de la colonisation, sont devenus aujourd’hui des acteurs indispensables de la vie économique et des leviers essentiels au sein de la classe politique malgache. Sur l’image ci dessus, on découvre Ylias Akbaraly, Hassanein Hiridjee et Hasnaine Yavarhoussen, trois hommes d’affaires malgaches d’origine indo-pakistanaise et qui sont cités parmi les plus grandes fortunes d’Afrique francophone par le très respectable magazine « Forbes ». L’influence de ces oligarques est telle que malgré le changement de régime, la gendarmerie malgache qui avait montré cet automne une brutalité particulière face aux manidestations du camp démocrate, a interpellé ces jours ci un jeune influenceur français Dylan Silva , qu avait mis en cause cette oligarchie indo pakistanaise et qui n’a pù sortir de détention que grâce à la mobilisation massive de ses amis sur place (GenZ, etc.)
Daniel Saine Roche
La puissance économique de la minorité indo-pakistanaise est désormais telle qu’elle peut étaler sans complexe ses influences politiques. Si jusqu’à une certaine époque, la neutralité était de règle au sein de la communauté, tout a changé avec le coup d’Etat sanglant de 2009 lors duquel des personnalités indo-pakistanaises ont agi directement sur la scène politique malgache. Selon la déclaration d’un des principaux auteurs du coup, le Colonel Charles Andrianasoavina (propos recueillis par Philippe Divay et publiés dans le Club de Mediapart en 2012 et 2013), des hommes d’affaires indiens ont apporté un financement substantiel au « double coup d’Etat commandité par Andry Rajoelina ». Ont été ainsi cités des quincaillers en la personne de MM Said et Galib, mais aussi des patrons de grandes entreprises comme Ylias Akbaraly du Groupe SIPROMAD et Amir Rajabali du Groupe Rajabali.
Par ailleurs, la saga de la crise énergétique a Madagascar constitue aussi une illustration de cette influence politique. Fidèle Razarapiera, Vice-président de l’Assemblée nationale, clame que le problème auquel est confronté aujourd’hui la société nationale d’eau et électricité (Jirama) est dû à la dépendance de cette entreprise aux Groupes Filatex de Hasnaine Yavarhoussen et à la Jovena de Hassanein Hiridjee. Selon lui, ces deux entités ont pu mettre en place un réseau occulte permettant de protéger leurs intérêts, capable de dicter les décisions de la JIRAMA, de l’État malgache, et même de son partenaire international, la Banque mondiale.
Hassanein Hiridjee, propriétaire du groupe Axian et Jovena contrôle en effet l’énergie qui alimente la JIRAMA (le gazole, le fioul, le fioul lourd) tandis que Hasnaine Yavarhoussen (Filatex) contrôle la fourniture des groupes photovoltaïque et thermique, ainsi que la production énergétique, rendant l’État totalement dépendant de lui. La dépendance commence dès la phase de production, et s’étend sur les infrastructures logistiques, les stocks de carburant, les systèmes de maintenance. Et ce sont ces mêmes groupes qui bénéficient des marchés de construction, des garanties de paiement, et d’un cadre fiscal peu contraignant. Le contrôle étatique est difficile à mettre en œuvre car celui qui vend du carburant à l’État lui-même incapable de payer, qui construit ses centrales, qui impose ses clauses contractuelles, peut imposer sa propre règle du jeu. Dans cet optique, le vice-président de l’assemblée nationale affirme que Hassanein Hiridjee et Hasnaine Yavarhoussen ont des hommes de main dans l’administration malgache, au sein des Institutions, et dans les différents syndicats. Le nouveau Premier ministre est par exemple l’ancien Président d’une banque appartenant à la famille Hiridjee, et des ministres nouvellement nommés ont été avant leur nomination au gouvernement des cadres dirigeants d’entreprises locales du groupe Filatex de Yavarhoussen ou du Groupe Basan de la famille Barday.
Un autre fait qui distingue la minorité indo-pakistanaise à Madagascar se trouve dans sa réputation d’ « accapareur » de terrains. Le placement immobilier effectué par cette communauté témoigne de son intelligence dans la pratique des affaires, quand bien même les méthodes utilisées suscitent l’animosité du public. Ainsi, à Morondava (Sud-Ouest), 90% des maisons appartiennent à des indiens. A Majunga (Ouest), ils seraient en possession de près de 50% des immeubles en dur. A Diégo-Suarez (Nord), une bonne partie des locaux leur appartiendrait. Enfin à Tananarive, il est de notoriété publique que des groupes comme Filatex disposent d’un important patrimoine immobilier (200 000 m2 bâtis) accumulé au fil des ans. Amir Rajabali, président d’un autre groupe familial, est présenté par une certaine presse comme un « richissime industriel accapareur de terrains fonciers », bénéficiant de la « complicité des responsables fonciers dans l’acquisition douteuse et abusive de nombreux terrains ».
Une intégration sociale difficile
Il existe un sentiment de méfiance réciproque entre la communauté indo-pakistanaise et les Malgaches. Le premier et principal motif de suspicion réside dans la domination économique d’une partie importante du groupe, qui compte parmi les principaux hommes d’affaires et investisseurs du pays. On dit que leur richesse et leur réussite suscitent jalousie et convoitise, et que le reproche principal qui leur est adressé, c’est leur « réussite dans les affaires ». C’est dire que les indo-pakistanais constituent facilement des boucs émissaires qui cristallisent le mécontentement populaire, souvent sur l’instigation de politiciens populistes.
D’un autre côté, les observateurs même les moins avertis notent qu’il ne s’agit aucunement d’une jalousie gratuite, mais d’un ressentiment alimenté au fil des générations par un sentiment d’injustice. Dès le départ, la communauté indo-pakistanaise a été favorisée par les colons et l’administration française, puis par les différents régimes qui se sont succédés à Madagascar. Au sein de la population, il est très fréquent d’entendre que les Indiens sont fourbes, malhonnêtes, intolérants, fermés sur eux-mêmes, méprisants envers les Malgaches, et qu’ils s’enrichissent à leur détriment. Cette dernière assertion part de la simple constatation du fait que les Malgaches figurent parmi les trois populations les plus pauvres de la planète, alors que certains hommes d’affaires indo-pakistanais ayant démarré leurs activités depuis la Grande ile sont devenus parmi les hommes les plus riches d’Afrique francophone.
Il est vrai que les indopakistanais ne sont pas responsables de la pauvreté des Malgaches. Mais on ne peut pas nier qu’ils ont toujours mis à profit l’existence de dysfonctionnement et de mauvaise gouvernance politique pour s’enrichir encore plus grâce à de multiples subterfuges : corruption étatique, alimentation du circuit des économies informelles pour pouvoir effectuer des évasions fiscales, etc…Il est a noter que plusieurs noms indo-pakistanais très connus ont été cités dans le scandale du « panama papers ».
Quel futur pour la communauté indopakistanaise ?
En définitive, le principal frein à l’intégration sociale de la communauté indo-pakistanaise tient à son attachement au particularisme dans un contexte où même la construction d’un Etat-nation malgache n’est pas en elle-même achevée. La Constitution garantit pour les citoyens malgaches un traitement égal sans considération de races ni de religions. En théorie, les « Karana » de nationalité malgache ne devraient donc rencontrer aucun problème. Mais il ne faut pas passer sous silence le fait que la politique de l’Etat en matière de minorités consiste à « sauvegarder la substance nationale ». Cette politique a amené l’Etat à porter un coup d’arrêt aux immigrations nouvelles, et à restreindre l’attribution de la nationalité malgache. Cette politique de restriction favorise l’apatridie au sein de la Communauté indo-pakistanaise.
Les plus riches Karana sont de nationalité française, ou au moins ont la double nationalité franco-malgache. A leur égard, la question se pose de savoir si l’atmosphère délétère qui prévaut à Madagascar ne les acculerait pas à terme à partir. Ils suivraient en cela l’exemple de nombreux Indiens qui ont en 1973 et 1975 plié bagages pour des horizons plus propices à leurs affaires comme La Réunion, l’ile Maurice, la France ou le Canada. D’autre part, les riches familles qui ont envoyé leurs enfants étudier en Europe ou ailleurs sont déçus par le fait que de nombreux jeunes ont pour la plupart épousé des étrangers et n’envisagent plus de retourner à Madagascar. Cette situation justifie l’angoisse des parents qui risquent ainsi de finir leurs jours sans héritiers.
D’autres membres de la communauté ont d’ores et déjà adopté une position intermédiaire, avec la psychose du kidnapping qui a envahi les riches hommes d’affaires indo-pakistanais ces dernières années. Ils dirigent leurs entreprises depuis l’extérieur, comme Sameer Rajabali du groupe éponyme (BTP, immobilier, hôtellerie) installé à Maurice ou Mathias Ismaïl et Gauthier Ismaïl du groupe Socota (textile, crevettes, immobilier) qui résident respectivement à Paris et à Maurice. Il en est de même des deux enfants d’Iqbal Rahim, le président fondateur de Galana (produits pétroliers), Rizwan Rahim et sa sœur Naila Shirazee née Rahim, qui vivent, comme leur père, à Dubaï.
On peut aussi s’attendre à des transferts de l’actif de leurs patrimoines à l’étranger. L’internalisation des activités de ces groupes constitue une prémisse a ce mouvement. C’est ainsi que nombre de ces entreprises sont tournées vers l’Europe ou les Etats-Unis pour leurs ventes (cas de la vanille de Trimeta ou les haricots verts de Basan), la recherche de partenaires ou l’importation de biens d’équipements (le groupe Rajabali en France). Certains sont devenus des multinationales qui ont essaimé à l’étranger, tel Axian qui est aujourd’hui présent dans les secteurs des télécoms, de l’énergie, de l’immobilier et des services financiers en Tanzanie, au Togo, au Sénégal, en Zambie. De même pour Filatex qui se positionne sur des pays comme le Ghana, la Guinée et la Cote -d’Ivoire depuis 2020. La société Galana est bien arrimée à Maurice, au Mozambique, en Afrique du Sud, et au Kenya, tandis que Socota de la famille Ismail développent leurs activités immobilières à Maurice, et la branche « produits de la mer » en France, Ou encore Ylias Akbaraly, avec sa holding Redland, qui est présent dans de nombreux pays dont les États-Unis, la France, en Inde et au Moyen-Orient.
La véritable problématique invoquée par la faiblesse de l’intégration sociale de la communauté indo-pakistanaise se pose donc d’une façon plus cruciale pour les apatrides et les membres dont les conditions sociales sont moyennes, et qui ne peuvent envisager un avenir autre qu’à Madagascar. Un mouvement à double sens est souhaitable pour parvenir à des relations saines et apaisées : d’une part, l’évolution des mentalités des Malgaches qui doivent désormais appréhender le concept de la « malgachitude » dans une acception plus large, non limitée aux seuls éléments austronésiens et africains qui ont caractérisé jusqu’ici la « substance nationale » malgache. D’autre part est requis de la part de la minorité indopakistanaise un effort vers une volonté d’assimilation, a l’instar de la minorité d’origine chinoise a qui le Malgache confère sans problème la qualité de « sinoa gasy » (chinois-malgache)