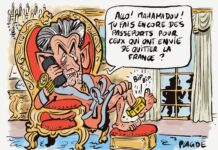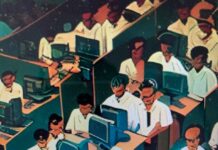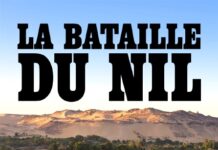Dans de nombreux pays africains, la volonté de se servir du pouvoir d’Etat « pour manger » a discrédité les pratiques des hommes politique et desservi l’idéal démocratique. Entre trahisons et reniements, « la politique du ventre » est devenue une vraie menace contre la démocratie.
L’éditorial de Seidik Abba, Rédacteur en Chef de Mondafrique
C’est une scène pourtant bien triste qui s’est répétée plusieurs fois ces dernières années en Afrique : au Niger, à peine le coup d’Etat contre le président Mohamed Bazoum venait-il d’être consommé que des ministres et non des moindres du régime renversé ont rallié les nouveaux maîtres du pays. Non qu’ils aient la volonté de continuer à servir l’intérêt public, mais par souci de continuer à « manger », au crochet de l’Etat. On aura vu la même chose au Mali voisin au lendemain du renversement de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita en août 2020 ainsi qu’au Burkina Faso après le coup d’Etat de janvier 2022 qui a emporté le régime Roch Marc Christian Kaboré.
Etre dans le partage du gâteau
Il n’y a pas qu’après les coups d’Etat que se produisent ces ralliements spectaculaires. On les observe après des élections démocratiques aussi. Certains hommes politiques sont en effet incapables de rester dans l’opposition. Ils mouraient en effet de faim sans les prébendes de l’Etat. Leur seul métier, c’est la politique, mais surtout être dans le parti ou la majorité au pouvoir. Sur l’autel de cette « politique du ventre », ils sont prêts à toute sorte de reniement, à toute sorte de renoncement, à toute sorte de compromission. Derrière l’engagement politique, il n’y a, en fait, que la volonté de se servir et non celle se servir. Résultat, les partis politiques sont ainsi devenus des « boutiques pour faire » du business. Naturellement, chacun cherche à créer le sien. Le Niger compte plus de 160 partis politiques ; la République démocratique du Congo en affiche plus de 400 ; le Sénégal recense au moins 330 partis politiques alors que le Tchad en compte pas moins de 150. S’il y avait autant d’offres politiques que de partis, personne n’aurait trouvé à redire. Dans la pratique, on crée son parti pour rallier la large majorité au pouvoir et être « dans le partage », obtenir son maroquin en tant que chef de parti et quelques postes pour certains militants.
Grave recul
Au-delà du sort bien triste de leurs auteurs, le nomadisme politique, « les zig-zag » , pour parler comme à Abidjan, ont nui à l’image de la politique et des hommes politiques dans de nombreux pays africains. La politique n’est plus perçue comme un engagement, mais une stratégie de carrière pour s’offrir un confort qu’on n’aurait jamais pu obtenir par ses études ou son métier.
Et pourtant, il fut un temps où on s’engageait en politique partout en Afrique par conviction et par idéalisme. On était « militant à vie » du parti sawaba de Djibo Bakary au Niger, on s’engageait à vie au Cameroun à l’Union des populations du Cameroun (UPC) ; on ne cédait jamais à aucune tentation pour quitter le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) et rallier une autre formation.
Hélas, tout cela est derrière nous. Il y a désormais plus de personnes qui s’engagent en politique « pour manger », se servir que pour défendre un idéal, des idées et des convictions. L’Afrique n’est certes pas seule région du monde confrontée à cette dérive, mais parce qu’elle poursuit, avec des hauts et des bas, sa trajectoire démocratique, il est important de revenir aux fondamentaux laissés par les pères-fondateurs des indépendances : faire de la politique pour servir et non pour se servir.