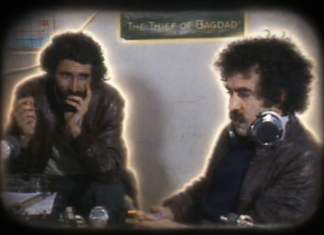Ceinturés par des pays qui ont subi récemment des attaques terroristes, le Sénégal n’est pas épargné par le phénomène. Selon une étude devant être présentée ce mardi 29 avril 2025, par Timbuktu Institute, le pays pourrait subir des attaques de djihadistes du Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimîn (JNIM), dirigé par Iyad Ag Ghali. À ces menaces, trois raisons: la porosité des frontières, la situation économique de certaines localités et la montée du salafisme.
Ibrahima Dieng (correspondance)
Les magnifiques paysages des régions frontalières Mali/Sénégal
Le Sénégal est il menacé par les djihadistes du Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimîn (JNIM) ? Dans un rapport devant être rendu public ce mardi 29 avril 2025, Timbuktu Institute tente d’apporter des éclairages. Selon son étude, ce mouvement basé dans le sud-ouest du Mali indique qu’il cherche à infiltrer la Mauritanie et le Sénégal.
Car, explique l’institut dirigé par le chercheur sénégalais, Bakary Samb, le JNIM a augmenté de façon exponentielle ses activités à Kayes, région frontalière du Mali avec la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal (voir la carte ci dessus). Ces activités comprennent ainsi des attaques complexes contre les forces de sécurité, la coercition des civils et l’économie criminelle.
Des frontières très poreuses
Bien que le Sénégal n’ait pas connu le même niveau de radicalisation que d’autres pays du Sahel, il existe des facteurs de risque qui pourraient le rendre vulnérable à la stratégie d’expansion du JNIM. L’un d’eux est la porosité des frontières. Pour le rapport, la porosité des frontières nationales permet l’infiltration économique actuelle du JNIM, ce qui constitue l’un des problèmes les plus urgents à résoudre pour la Mauritanie et le Sénégal.

Qu ‘il s’agisse des zones les plus désertiques de la frontière mauritanienne ou des zones les plus boisées de la frontière sénégalaise, de nombreux espaces restent difficiles à sécuriser. Le JNIM utilise déjà les zones désertiques de la Mauritanie pour commercer avec les communautés et organiser des points de regroupement », soutient le rapport.
En outre, ce travail très instructif mentionne que la Mauritanie accueille des centaines de milliers de réfugiés du Mali, du Niger et du Burkina Faso à sa frontière avec le Mali suite à la détérioration continue de la situation sécuritaire dans les pays de l’AES (Alliance des États du Sahel). Timbuktu Institute considère également que l’insécurité aux frontières a contribué au développement d’activités illicites, en particulier dans les zones d’extraction de l’or. Un phénomène qui favorise la circulation d’ armes et d’hommes armés en provenance et à destination du Mali et de la Guinée est difficile à contrôler ». Ainsi, selon un habitant de Saraya, dans la région de Kédougou, « il y a des trafics de toutes sortes. Il y a aussi des braquages, notamment par des individus non identifiés qui entrent au Sénégal par Bembou, à la frontière avec le Mali ». Avec cette situation, les assaillants commettent leurs actes et retournent au Mali.
Les populations locales inconscientes
La vulnérabilité aux frontières pourrait être aggravée par le fait que les populations sénégalaises ne sont pas assez conscientes de la menace que représente le JNIM. Car d’après Timbuktu Institute, environ la moitié des habitants de la région de Kédougou ne sont pas au courant des activités du JNIM au Mali. Ainsi, selon une enquête interne du Timbuktu Institute réalisée en 2024, un tiers des habitants des régions de Kédougou, Matam et Tambacounda ne sont pas conscients de la menace que représente la radicalisation potentielle au Sénégal.
Cela signifie que les populations n’ont pas conscience de l’impact que l’expansion du JNIM en Mauritanie et au Sénégal et qui pourrait avoir des conséquences. Par conséquent, le JNIM pourrait, selon certains indices à travers des prêches, filtrer son message destiné aux communautés des trois frontières afin d’influer sur leurs perceptions de manière favorable. Plutôt que de propager ses convictions idéologiques radicales, qui ne sont pas très populaires au Sénégal, le JNIM, selon la tendance actuelle, n’hésiterait pas à se présenter comme protecteur des groupes marginalisés. Fort de cela, le déficit de
sensibilisation des populations est dû à des années de déni politique de la menace qui a eu ses effets sur les différentes approches adoptées malgré les efforts intensifiés depuis 2015 et les mesures sécuritaires de plus en plus renforcées.
Une vulnérabilité économique problématique
Le JNIM pourrait faire de nouvelles percées au Sénégal et en Mauritanie et recruter au sein de l’importante population juvénile désillusionnée par
sa situation économique. C’est une certitude selon Timbuktu Institute. À l’en croire, une enquête interne du Timbuktu Institute réalisée en 2024, montre que 85% des habitants des régions de Kédougou, Matam et Tambacounda citent le chômage comme raison pour laquelle une personne rejoindrait un groupe extrémiste violent ; ce qui en fait de loin, la raison la plus fréquente, loin devant l’idéologie et la criminalité qui semble retenir l’attention notamment à propos de l’orpaillage. En outre, des sociétés étrangères contrôlent l’exploitation de l’ or, une industrie-clé dans la région de Kédougou, qu’une grande partie de la population locale considère comme une exploitation. Interrogé par Timbuktu Institute, un habitant de Saraya, « les orpailleurs creusent partout pour trouver de l’ or et laissent ensuite la terre en l’état, sans aucun réaménagement. Ainsi, les agriculteurs n’ont presque plus d’ espace à cultiver. Cette situation économique peut rendre facile le recrutement d’éléments. « Des espaces sont réservés ou vendus aux compagnies minières, ce qui frustre les agriculteurs. Les agriculteurs ont des difficultés à obtenir l’accès à la terre auprès des autorités locales. Les gens ont l’impression que leurs terres sont maintenant attribuées à des étrangers pour l’ exploitation minière, au détriment de leurs activités agricoles », mentionne le document.
La montée du Salafisme
Meme si l’idéologie salafiste est loin d’être prédominante au Sénégal, elle pose un certain défi par ses positions politico-religieuses dénigrant les soufis et les autres chefs religieux comme un islam hétérodoxe. Le phénomène est stimulé par un financement transnational provenant d’individus et d’organisations étrangères, elle est devenue plus répandue à l’aide d’une offensive prédicative dans les mosquées, les daaras et surtout les plateformes en ligne.
Ainsi, les prédicateurs salafistes utilisent des moyens de communication en ligne et des enseignements accessibles pour s’opposer directement et indirectement aux chefs soufis traditionnels. Cela leur a permis d’ atteindre de jeunes désillusionnés par leur situation socio-économique, en particulier dans les banlieues de Dakar et les grands centres urbains comme Thiès et Louga. Selon Timbuktu Institute, des prédicateurs radicaux locaux et étrangers créent leurs propres mosquées et dénigrent les chefs religieux plus modérés. Des prêches qui pourraient amener les jeunes à se radicaliser.