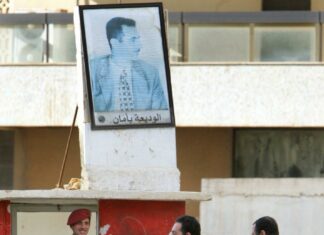En Algérie, l’accès aux monnaies étrangères comme l’euro ou le dollar est strictement encadré par l’État. Les banques ne fournissent que de faibles quantités de devises à des taux administrés très éloignés du prix réel. Cette rareté a fait émerger depuis des décennies un marché parallèle, visible et toléré, où les devises s’échangent à des taux nettement plus élevés.
Ce marché est devenu la principale source de devises pour les particuliers et une part importante des opérateurs économiques, au point d’influencer directement les prix, les comportements d’achat et l’équilibre global de l’économie.
Square Port Said : la vraie référence
À l’automne 2025, l’euro s’échange autour de 280 dinars au marché noir (283,5 dinars le 24 novembre 2025), contre près de 150 dinars au taux officiel. L’écart dépasse 80 %. La presse économique décrit une hausse continue depuis un an et une prime parmi les plus élevées de la région. Les taux du marché informel, notamment à Alger, sont devenus la référence réelle des importateurs, des voyageurs, des étudiants et des familles de malades. Le système bancaire, incapable d’alimenter suffisamment le marché officiel, laisse ainsi le marché noir dicter la valeur du dinar dans la vie quotidienne.
La montée du dollar et de l’euro ne reflète pas un choc ponctuel mais un blocage profond. L’allocation touristique annoncée comme revalorisée tarde à être appliquée, maintenant les voyageurs dans la dépendance du marché informel. Le taux officiel du dinar reste très éloigné de sa valeur de marché, ce qui permet à divers acteurs d’arbitrer entre les deux segments.
Les dernières recommandations du FMI insistent sur ce point : le Fonds appelle à rapprocher progressivement les deux taux de change, à accroître l’offre légale de devises pour les particuliers et à réduire une prime informelle jugée « excessive » et source de rentes, de distorsions et de fuite de capitaux.
Défiance bancaire et domination de l’informel
La confiance envers les banques demeure faible. La lourdeur administrative, l’absence de produits attractifs en devises et la crainte de la traçabilité découragent les ménages comme les commerçants. Les transferts familiaux évitent largement les circuits officiels, tandis que le commerce informel alimenté par les restrictions à l’importation s’approvisionne en devises sur le marché noir, consolidant son rôle central.
Les réseaux de change informels réalisent des marges élevées, mais ils ne sont que la surface visible d’un système beaucoup plus large. Les véritables absorbeurs de devises appartiennent à plusieurs secteurs d’importation : téléphonie et électronique, textile et chaussures, électroménager, pièces détachées automobiles, véhicules importés en conteneurs, produits pharmaceutiques non remboursés, ainsi que le commerce de détail lié au « cabas ». Ces filières, fortement dépendantes des fournisseurs étrangers, achètent leurs devises quasiment exclusivement sur le marché noir. Elles fixent ensuite leurs prix en Algérie directement selon le taux informel, pérennisant la demande et renforçant la prime sur la devise.
À ces importateurs s’ajoutent des opérateurs disposant d’un accès privilégié au taux officiel. Plusieurs analyses de presse et rapports d’institutions internationales décrivent ce mécanisme : un accès subventionné à la devise permet à certains acteurs de financer des opérations à un coût artificiellement bas, générant des rentes importantes grâce à la revente, à la surfacturation ou à des opérations d’arbitrage. Le FMI souligne que ce dédoublement du taux de change alimente la corruption et encourage le blanchiment.
La diaspora constitue un autre pilier de l’approvisionnement en devises. Une grande partie des flux transite par des circuits informels organisés. L’un des systèmes les plus répandus fonctionne via des officines en Europe, taxiphones, épiceries, restaurants, agences de voyages, où un membre de la diaspora dépose des euros, quelques heures plus tard, sa famille reçoit en Algérie l’équivalent en dinars au taux du marché noir. Le transfert s’effectue dans l’autre sens de la même manière : un commerçant algérien remet des dinars à un intermédiaire local et l’argent en euros est versé à un proche résidant en Europe. Le tout sans transporter physiquement de devises et en contournant totalement les banques. Des canaux encore plus opaques sont mentionnés par la presse internationale, comme l’utilisation de valises diplomatiques ou de circuits protégés facilitant le transfert discret de devises et alimentant indirectement le marché parallèle.
Ce système à plusieurs étages, cambistes, importateurs, détenteurs de privilèges, diaspora, forme une économie parallèle complète, qui s’autoalimente et se stabilise car elle répond à des besoins réels et offre des marges très élevées.
Des effets lourds sur les prix et la stabilité
La majorité des biens importés — électronique, médicaments, pièces détachées, électroménager ou véhicules — sont désormais évalués sur la base du taux parallèle, aggravant l’inflation. Le salaire minimum, équivalant à moins de 75 euros sur le marché noir, illustre la chute du pouvoir d’achat.
La presse économique souligne la perte de recettes fiscales, l’affaiblissement des réserves officielles, le frein à l’investissement étranger et l’enracinement structurel de l’informel. À cela s’ajoutent les risques réputationnels liés à la surveillance internationale des flux suspects, dans un contexte où le pays reste sous observation renforcée en matière de lutte contre le blanchiment.
Des mesures officielles sans effet
Les autorités annoncent régulièrement des réformes : réglementation des bureaux de change, revalorisation de l’allocation touristique, plafonnement des sorties de devises, mesures fiscales anti-informel.
Mais leur mise en œuvre reste limitée. Les bureaux de change n’ouvrent pas, l’allocation revalorisée n’est pas accessible à la majorité des voyageurs, et le taux officiel demeure trop éloigné du taux parallèle pour assécher la rente.
Sans un rapprochement du taux officiel et du taux réel — comme le recommande le FMI — et sans une réforme profonde du système bancaire, ces mesures ne peuvent modifier une réalité enracinée depuis des années.
Un déséquilibre devenu structurel
Le marché noir de la devise n’est plus un dysfonctionnement périphérique, mais l’expression d’un déséquilibre installé au cœur du système économique. Il révèle la rupture entre un cadre monétaire rigide et une économie réelle qui contourne les institutions pour créer ses propres mécanismes.
Tant que le pays maintiendra un taux officiel déconnecté, un accès restreint aux devises et un appareil bancaire incapable d’absorber la demande, le marché parallèle restera la véritable référence.
Ce phénomène dépasse la simple question de change : il traduit l’effritement des capacités de régulation, l’érosion de la confiance collective et la perte progressive de contrôle de l’État sur des flux vitaux. Dans un pays dépendant des importations et exposé aux tensions globales, cette dérive structurelle constitue un risque majeur.
Lorsqu’une monnaie cesse de refléter la réalité, c’est toute l’architecture économique et sociale qui commence à vaciller.
Le marché noir des devises plombe l’économie algérienne