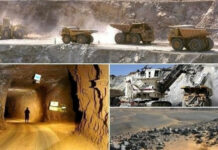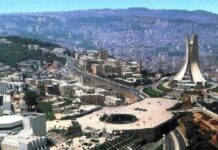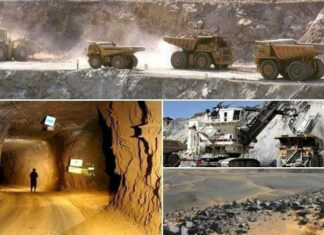Alors que la tension entre Paris et Bamako atteint son paroxysme, la France expulse deux diplomates maliens et suspend sa coopération antiterroriste, en représailles à l’arrestation controversée d’un agent français à Bamako. Cette crise ouvre une période d’incertitude et fait basculer l’équilibre sécuritaire au Sahel.
Une chronique d’Adama Dramé, directeur du jurnal « le Sphinx » »
Les relations diplomatiques entre la France et le Mali connaissent une détérioration sans précédent. Le 17 septembre 2025, Paris a annoncé l’expulsion de deux diplomates maliens en poste dans la capitale française, en réponse directe à l’arrestation, un mois plus tôt à Bamako, d’un agent diplomatique français accusé d’espionnage.
Dans le même temps, la France a décidé de suspendre sa coopération antiterroriste avec les autorités maliennes, un choix lourd de conséquences dans une région déjà déstabilisée par la présence de groupes armés djihadistes.
Les diplomates maliens dans le viseur
La France a déclaré « persona non grata » deux représentants maliens. Batné Ould Bouh Coulibaly, contrôleur général de police, attaché de défense auprès de l’ambassade du Mali en France depuis 2021. Ce haut fonctionnaire, qui a occupé divers postes sous la transition dirigée par le général Assimi Goïta, assurait la coordination des relations militaires et sécuritaires avec Paris. Ousmane Houmani Camara, lieutenant-colonel de gendarmerie et conseiller consulaire au Consulat général du Mali à Paris depuis 2017. Ancien directeur du Renseignement intérieur au Mali, il est considéré comme un rouage essentiel de l’appareil sécuritaire malien.
Selon les autorités françaises, ces deux diplomates étaient en réalité des agents de renseignement opérant sous couverture, ce qui a motivé leur expulsion.
L’arrestation d’un diplomate français à Bamako
Cette décision s’inscrit en réaction à l’interpellation, le 14 août 2025, de Yann Vezilier, deuxième secrétaire de l’ambassade de France au Mali et officier de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure). Officier supérieur de l’armée de l’air avec près de trente ans de service, il était officiellement accrédité auprès des autorités maliennes.
Arrêté dans les rues de Bamako par la Sécurité d’État, il est accusé de « conspiration contre le gouvernement ». Selon le ministre malien de la Sécurité, Daoud Aly Mohammedine, son arrestation s’inscrit dans le cadre d’un complot présumé impliquant plusieurs officiers supérieurs maliens. Parmi eux figurent les généraux Abass Dembélé et Néma Sagara, présentés comme les cerveaux d’une tentative de déstabilisation.
Pour Paris, il s’agit d’un abus manifeste : l’officier français bénéficie de l’immunité diplomatique en vertu de la Convention de Vienne de 1961, ratifiée par le Mali en 1968. Cette convention stipule que les agents diplomatiques sont inviolables et ne peuvent être ni arrêtés ni détenus.
Bras de fer diplomatique
Dès le 15 août, les autorités françaises ont saisi Bamako pour obtenir la libération de leur agent. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a assuré que le dossier relevait de la Sécurité d’État. Une rencontre entre services de renseignement français et maliens a eu lieu, permettant de réaffirmer « le respect réciproque » et l’attachement à la coopération sécuritaire. Paris s’est dit prêt à dialoguer, mais uniquement après la libération du diplomate.
Constatant l’absence de progrès, la diplomatie française a multiplié les pressions. Le 4 septembre, le chargé d’affaires malien à Paris, Bakary Dembélé, a été convoqué et averti que la France prendrait des mesures de rétorsion dès le 8 septembre si Bamako ne se conformait pas à ses obligations internationales. Ces mesures incluent : la suspension de la coopération technique sécuritaire et consulaire, la mobilisation de l’Union européenne en faveur de sanctions ciblées, une éventuelle révision de la présence diplomatique française à Bamako, et, en dernier recours, une saisine de la Cour pénale internationale.
Le 10 septembre 2025, le chargé d’affaires malien à Paris, Bakary Dembélé, a été contacté par l’ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner. Ce dernier a rappelé le caractère illégal de la détention de Yann Vezilier au regard du droit international. Il a suggéré aux autorités maliennes de privilégier l’apaisement en procédant à l’expulsion du diplomate français ou en le déclarant persona non grata, plutôt que de le maintenir en détention. Selon lui, une telle décision permettrait d’éviter une escalade diplomatique jugée inutile entre Bamako et Paris, qui pourrait entraîner le soutien actif des alliés de la France.
Une rhétorique antifrançaise ravivée
Cette affaire intervient dans un contexte où le discours antifrançais connaît un regain de vigueur au Mali. Depuis le coup d’État de 2020, la junte au pouvoir a progressivement durci sa ligne, multipliant les accusations contre des militaires soupçonnés de collusion avec des puissances étrangères.
Relayée par certains médias locaux et amplifiée par des réseaux prorusses, cette rhétorique vise à renforcer la légitimité des autorités de transition tout en consolidant leurs alliances stratégiques, notamment avec la Russie, qui a remplacé le groupe Wagner par ses forces d’Africa Corps.
Une rupture historique
Malgré les tensions et l’expulsion de l’ambassadeur français en 2022, Paris et Bamako avaient jusqu’ici maintenu une coopération sécuritaire minimale, centrée sur l’échange d’informations dans la lutte antiterroriste. La suspension annoncée marque donc une rupture sans précédent, susceptible de modifier durablement l’équilibre sécuritaire dans la région.
Quelles conséquences pour le Mali et la région ? La crise actuelle pourrait avoir des effets en chaîne. La suspension de la coopération fragilisera la lutte contre les groupes armés djihadistes affiliés au JNIM et à l’État islamique.
Le Mali risque un isolement accru vis-à-vis de l’Union européenne et de ses partenaires occidentaux. Une baisse des investissements étrangers, des restrictions de mobilité et un durcissement des conditions pour les ressortissants maliens en France sont à prévoir. La crise pourrait accentuer le retrait des partenaires occidentaux du Sahel et ouvrir davantage la voie à l’influence de la Russie et de la Chine.
Une instabilité accrue
Au-delà du bras de fer bilatéral, cette crise illustre la fragilité de l’architecture sécuritaire au Sahel. Dans un pays où plus de 14 000 personnes ont péri depuis 2020 selon l’ONG Acled, et où les violences s’étendent vers le sud, la suspension de la coopération avec la France risque d’aggraver l’instabilité et d’isoler encore davantage le Mali sur la scène internationale.Et c’est dommage !