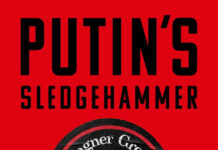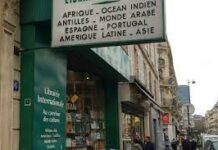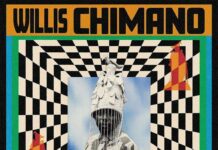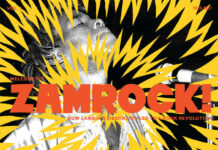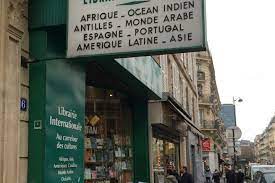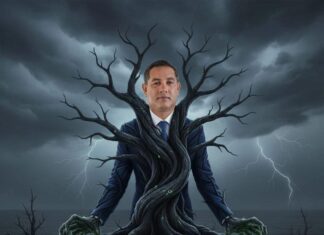Le silence des pays de la CEMAC face à ce qui se joue aujourd’hui au Cameroun est suicidaire. Les incertitudes qui planent sur ce pays menacent la stabilité de la région et son avenir immédiat engage celui de toute l’Afrique centrale.
Par Johnny Vianney Bissakonou: https://www.linkedin.com/in/
Une déstabilisations du Cameroun aurait des conséquences régionales dramatiques. La Centrafrique et le Tchad, pays enclavés, dépendent du port de Douala pour leurs approvisionnements. Le Gabon importe une partie significative de ses produits agricoles du Cameroun, tandis que des milliers d’étudiants venus de toute la sous-région y poursuivent leurs études faute de moyen pour aller étudier en Europe, en Afrique de l’Ouest ou au Maghreb. Aux frontières, la menace persistante de Boko Haram et des groupes armés dans les zones limitrophes du Tchad, de la RCA et du Soudan rend le contexte encore plus volatile.
Dans un environnement déjà marqué par l’instabilité du Sahel, un effondrement du Cameroun provoquerait une onde de choc dont les répercussions dépasseraient celles observées après la chute du régime libyen.
Entre espoir et désillusions
Le Cameroun, comme nombre de pays africains, voit émerger une jeunesse avide de changement, d’alternance démocratique et de justice sociale. Cette aspiration est légitime. Mais elle se heurte à une réalité politique verrouillée, dominée depuis plus de quatre décennies par un pouvoir vieillissant. Faut-il préserver la stabilité à tout prix, au risque d’étouffer les espoirs ? Ou précipiter le changement, avec les incertitudes qu’il charrie ?
L’histoire du continent invite à la prudence. De nombreux mouvements de « libération » portés par des militaires se sont transformés en régimes autoritaires, souvent plus répressifs encore que ceux qu’ils prétendaient renverser.
Le vent de révolte et de lutte contre le néocolonialisme qui souffle aujourd’hui sur l’Afrique francophone n’a rien de nouveau. Ce nouvel élan patriotique a, hélas, quelque chose de vicié. Et quand on essaie de tirer la sonnette d’alarme, de dire « attention, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark », on est aussitôt accusé de rouler pour l’ennemi, d’être un suppôt de la France ou de l’Occident. La vindicte populaire n’est jamais loin.
De Tananarive aux capitales de l’AES, en passant par l’Afrique centrale, il est presque impossible d’avoir un débat apaisé avec cette jeunesse qui, animée d’un espoir légitime de jouir enfin des richesses de son pays, veut en découdre, tout renverser et encourage les militaires à prendre les choses en main, souvent avec l’appui d’un nouvel allié présenté comme « partenaire de libération dépourvu de la volonté de s’immiscer dans nos affaires et qui ne nous impose pas ses idéaux pseudo-démocratiques ».
Le mirage des libérateurs
Des générations avant celle-ci ont cru, elles aussi, à la promesse d’un renouveau porté par des militaires. Rien qu’en Centrafrique, Bokassa dès la fin 1966, Kolingba en 1981, Bozizé et ses « libérateurs » en 2003, puis la Séléka… Combien de « comités pour le redressement national », de « gouvernements d’union nationale », de « libérations du peuple » avons-nous connus ? La promesse d’un renouveau militaire a plusieurs fois séduit les peuples africains, mais rares sont les expériences qui ont débouché sur une véritable refondation politique.
Les années ont passé. Nos pays sont restés dépendants de l’aide extérieure, les mêmes noms se succèdent au sommet de l’État depuis les indépendances, et le peuple demeure pauvre et affamé.
Les militaires arrivés au pouvoir par la force se croient souvent investis d’une mission quasi divine. Ils tolèrent mal la contradiction, étouffent les contre-pouvoirs et trouvent toujours, dans leur pays, quelques juristes ou intellectuels prêts à légitimer leur prise de pouvoir. L’opposition et une partie de la société civile les accompagnent, convaincus d’agir pour le bien commun. Puis, très vite, le pouvoir se referme sur lui-même, promeut le culte du Chef visionnaire, les voix discordantes sont réduites au silence, et l’histoire recommence : un autre coup d’État finit par chasser les précédents. Un éternel recommencement.
Un choix décisif pour l’Afrique centrale
À la croisée des chemins.
Doit-il céder à la tentation du chaos, en pensant qu’il ne peut être pire que le statu quo ? Ou saura-t-il inventer une voie propre, pacifique, enracinée dans sa riche diversité et son sens de l’unité nationale ?
Ce choix dépasse le seul Cameroun. C’est celui de toute l’Afrique centrale, encore fragile, encore dépendante, encore marquée par les désillusions successives de ses révolutions et de ses transitions.
Ce choix est historique, non seulement pour le Cameroun, mais pour toute l’Afrique centrale. Les transitions brutales, les ruptures imposées par la force, n’ont jamais apporté la liberté véritable. Celle-ci se construit dans la patience, la lucidité et la capacité à repenser le pouvoir, à rebâtir la confiance entre dirigeants et citoyens.
Une voie camerounaise du changement
Le Cameroun possède les atouts pour relever ce défi : une population instruite, une économie diversifiée, et une tradition politique plus institutionnalisée que dans bien des pays de la région. L’heure n’est pas à la résignation ni à la violence, mais à l’invention d’une alternance démocratique maîtrisée, portée par la société civile, les intellectuels, les forces politiques et la jeunesse.
Le destin du Cameroun ne concerne pas que les Camerounais. Il engage l’équilibre de toute l’Afrique centrale.
Puissent les acteurs politiques et la jeunesse camerounaise faire le choix de la raison, de la paix et de la construction patiente, et non celui de l’embrasement.