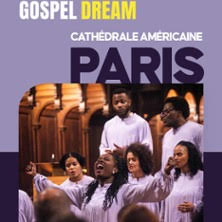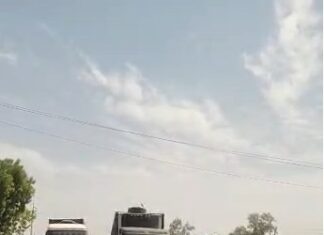Pendant la nuit du 24 au 25 août 2025, des dizaines de combattants, à moto, déferlaient sur le village de Difita, un hameau de paysans agriculteurs du département de Téhini, situé à 2 km de la frontière avec le Burkina Faso. Ils ne déclamaient pas de messages extrémistes et ne diffusaient pas d’avantage de mises en garde islamistes à l’inverse des pratiques des volontaires du Jihad.
D’où les interrogations sur l’origine de ces attaques qui sont considérées jusqu’au sein même du régime ivoirien comme une volonté d’une partie de l’appareil sécuritaire de déstabiliser le Président Ouattara deux mois avant le scrutin présidentiel d’octobre.
Une analyse de « Veille sahélienne », un site partenaire de Mondafriquei
Quatre personnes tuées, une portée disparue, une femme brûlée, des cases incendiées, un vol de bétail ovin, une spoliation ou destruction de véhicules, en majorité à deux roues: tel est le bilan provisoire, selon le communiqué officiel de l’armée. Les renforts arrivèrent trop tard, les agresseurs s’étant évanouis dans la savane, à la faveur de l’obscurité. Le 29 août, près d’un bourg attenant, 2 corps criblés de balles, sont découverts. Le total des décès atteint 6. Les victimes n’ont pas été préalablement identifiées, avant leur exécution.
Face à des civils désarmés et pris au dépourvu, les assaillants de Difita n’ont pas rencontré de résistance en semant le chaos et la sidération, sans rencontrer d’intervention des forces armées et de sécurité (Fds) de la Côte d’Ivoire. Celles-ci, équipées et entraînées, grâce aux effets de la loi de programmation militaire et à un rajeunissement des effectifs, marquent généralement une présence dissuasive dans la zone. La question se pse de leur non intervention face à l’attaque du 29 aôut
La piste peu concluante du Jihad
Les djihadistes, en vertu d’un modus operandi constant, prêchent des bonnes paroles habituellement pendant leurs attaques à l’aide de haut-parleurs portatifs. La veille de l’assaut, ils submergent la population d’ultimatums. Or cette fois, aucun des marqueurs habituels à leurs opérations terroristes n’a été constaté.
Lors d’une récente oraison en avril 2025, Jafar Dicko, l’un des porte-voix de la katiba Ansarou Al-Islam, filiale burkinabée d’Al Qaïda, appelait au renversement de régimes impies dans le Golfe de Guinée et au Sahel. Il menaçait, nommément, le Togo, le Bénin, la Guinée et le Sénégal, mais s’abstenait de citer la Côte d’Ivoire. Maints observateurs y pressentirent, alors, un changement des priorités de la coalition du « Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans » (Gsim-Alqaïda), désormais concentrée sur les espaces où la guerre semble gagnable, quand une masse critique de civils Peulhs y subit des fortes discriminations.
Nombreux sont les djihadistes réfugiés en Côte d’Ivoire. Ils y bénéficient de l’asile et de l’assistance matérielle, au sein de sites d’accueil des réfugiés, construits et administrés sur le budget de l’Etat, autour de Doropo, Bouna, Ouangolodougou…Leur chiffre ne cesse d’augmenter, même si les structures sommaires hébergent, surtout, des dizaines de milliers de femmes et d’enfants, quelquefois accompagnés de leurs zébus, reconnaissables à la taille insolite des cornes.
Des populations étrangères mal acceptées
Dès après l’attentat de Grand Bassam en mars 2016, le gouvernement, convaincu de la nécessité de gagner les cœurs pour contenir la belligérance asymétrique, accélérait, à l’extrême nord, particulièrement au Bounkani, la réalisation de projets de développement communautaire, d’emploi des jeunes et de construction des infrastructures de base. Le déploiement militaire couvrait toute la frontière avec le Burkina Faso et le Mali, membres de l’Alliance des Etats du Sahel (Aes).
Ouvertement hostiles au pouvoir du président Alassane Ouattara, ces pays achètent, néanmoins, le surplus ivoirien d’électricité, au travers de l’interconnexion, sans toujours payer la facture. D’ailleurs, chacun des deux pays compte, en Côte d’Ivoire, des millions de ressortissants immigrés qui finissent par se fondre dans une nation multiconfessionnelle où la tolérance et l’hospitalité reprennent leurs droits, après les excès sanglants de la xénophobie « ivoiritaire », de 2002 à 2011. Mais beaucoup d’autochtones restent excédés par ce qu’ils ressentent comme une invasion venue du Sahel. Et le grief n’est plus uniquement audible chez les chrétiens du centre, de l’ouest et du sud. Il gagne, dorénavant, une partie de l’électorat du Nord, acquis au Président sortant, candidat à sa propre succession.
L’exploitation des forêts, l’agriculture, le commerce, les pâturages et la mise en valeur des mines d’or nourrissent une sourde compétition autour du foncier rural. Allogènes et locaux s’affrontent, régulièrement, à cause des velléités de contrôle de la ressource. Parfois, il suffit d’une rixe au marché et le quartier s’enflamme.
Malgré les efforts du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp-majorité présidentielle), le Bounkani demeure le théâtre d’une instabilité structurelle. S’y croisent les orpailleurs clandestins, les jihadistes du Gsim et la milice burkinabé dite Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp). Cette diversité d’acteurs en concurrence exponentielle évolue dans un écosystème de rivalités communautaires, à fleur de peau. L’on se souvient des heurts sanglants de 2016 qui opposaient, à Bouna, chef-lieu de la région et dans sa périphérie, éleveurs Peulhs et agriculteurs Lobi. Le conflit sera vite résorbé grâce à l’interposition énergique de l’Etat mais la défiance mutuelle persiste.
Des Lobis, fiers et jaloux de leurs traditions animistes, s’arment, en guise de résistance anticipée à la vague de prosélytisme salafi. Ils en attribuent la nuisance aux Peulhs, ici perçus comme des envahisseurs et des entrepreneurs de violence religieuse.
Un calendrier à risque
C’est plutôt à la lumière de l’élection du 25 octobre 2025 et de la rivalité avec l’Aes – en particulier la junte « révolutionnaire » du Burkina Faso – qu’il convient de lire le soudain accès de violence au Bounkani et ses avatars à venir.
Le Président Alassane Ouattara brigue quasiment seul, un 4ème quinquennat à la tête d’une Côte d’Ivoire qu’il a su relever de son délitement. De Koudou Laurent Gbagbo à Tidjane Thiam, ses concurrents de premier plan sont éliminés du jeu, d’où leur alliance objective. En dessous, se profile l’image sulfureuse de l’ancien chef rebelle et ex-Premier ministre, Guillaume Kigbafori Soro, l’exilé insaisissable qui parle beaucoup moins et agit dans l’ombre, à partir du Burkina Faso. C’est de là, ironie de l’histoire, qu’il concevait son insurrection, en 2002, avec l’appui du Président d’alors, Blaise Compaoré. Aujourd’hui, Soro se retrouve allié du capitaine Ibrahim Traoré (Ib), champion du panafricanisme rhétorique, contempteur de la démocratie pluraliste et partisan d’une éradication du terrorisme, par les armes.
Veille sahélienne a pu consulter un échange de notes attribuées aux services de sécurité ivoiriens, dont le compte X de Serge Daniel résume la teneur. Il y est question de la naissance d’un mouvement politico-militaire d’opposition à Ouattara, qui s’apprête à lancer d’autres actes insurrectionnels, sans doute en vue de tester les capacités de défense de la Côte d’Ivoire, éprouver son dispositif de veille, épuiser le moral des décideurs à Abidjan et, in fine, empêcher la tenue du vote.
L’une des correspondances confidentielles évoque – sans précision – les rôles respectifs de Soro, du capitaine Ibrahim Traoré (Ib) et de ses collaborateurs, parmi lesquels le chef d’état-major particulier et, toujours d’après le document, “un responsable du renseignement burkinabé », certainement une allusion au Commandant Oumarou Yabré, meneur de l’Agence nationale éponyme. L’organe de surveillance et de répression des dissidents s’enracine au centre du second Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (Mpsr), la dénomination du pouvoir de « transition ». Depuis le renversement du lieutenant–colonel Henri Sandaogo Damiba, le 30 septembre 2022, Ouagadougou accuse, Abidjan, de chercher à le déstabiliser et, en retour, ne manque pas l’ occasion de susciter des campagnes de désinformation contre le voisin du sud. Des arrestations, de part et d’autre, ponctuent le dissentiment fratricide, entre 2 peuples que lient, histoire, les intérêts et le peuplement, par-delà les frontières. Le 24 juillet 2025, Alino Faso, un influenceur burkinabé que les autorités ivoiriennes soupçonnaient d’entretenir un réseau de subversion au service de Ouagadougou, décède des suites d’un suicide par pendaison, pendant un interrogatoire de quelques semaines, à l’Ecole de gendarmerie d’Abidjan. Son corps, restitué à la famille, recevra, au bercail, les honneurs posthumes d’un héros de la révolution. Les Brigades d’intervention rapide (Bir) de la communication, contingent électronique de la junte, crient à l’assassinat et promettent une vengeance.
L’émergence d’acteurs inconnus
Au nombre des encadreurs burkinabés, l’un des bulletins d’information mentionne le Commandant Abdul Aziz Ouattara, très actif auprès de la diaspora en Côte d’Ivoire. Il aurait formé les unités de choc dans la forêt de Toussiana, en prélude à l’assaut de Difita. Selon notre source, Ali Konaté, homme d’affaires de la confrérie des chasseurs-sorciers Dozo, pourvoit aux frais de l’entreprise et procède à la préparation mystique des assaillants, afin de leur insuffler du courage et de les prémunir des tirs. La conduite effective de l’opération revient à Ali Koulbali, ex-rebelle ivoirien des Forces nouvelles (Fn), entité totalement dissoute dans l’armée régulière, au lendemain de l’éviction de Gbagbo, en mai 2011.
Les documents relus par Veille sahélienne s’accordent à envisager de futurs actes de provocation-diversion le long de la frontière du Burkina Faso, voire des initiatives de sabotages plus en profondeur du territoire ivoirien, à mesure qu’approchera l’échéance du scrutin présidentiel.
Incursions de bandes armées, contrebande, enlèvements en contrepartie de rançon, infiltrations des Vdp et de l’armée burkinabé, allant jusqu’à la capture de soldats et de fonctionnaires ivoiriens, le périmètre du Bounkani révèle une fragilité spécifique où le contrat social butte sur le défi persistant de l’ethnicité. La précarité d’un tel substrat favorise un climat de confusion sur quoi l’Etat de Côte d’Ivoire, en dépit de ses moyens substantiels, n’a pas encore assez de prise.
Si l’hypothèse d’un embryon insurrectionnel se confirme, elle se manifesterait, plus à l’Ouest, comme en 2002-2011, vers les forêts denses à la lisière du Liberia. Ici, la nature offre, à d’éventuels séditieux, une base arrière et un terrain d’entraînement, hors de portée d’une offensive de pacification.
L’influence croissante de la Russie, le retrait du contingent français, les tensions électorales et l’agressivité d’une AES en sursis constituent autant de facteurs d’incertitude quant à la capacité des Ivoiriens de surmonter un tel cumul d’épreuves. Fort à rebours des précédents de 2011 et 2020 qui permirent, au pouvoir, de capitaliser sur la sympathie de l’Occident, les bouleversements actuels de la géopolitique leur intiment de ne compter que sur eux-mêmes. Il n’y aura pas d’intervention extérieure pour sauver le pays des convoitises de l’étranger ni des soubresauts internes.