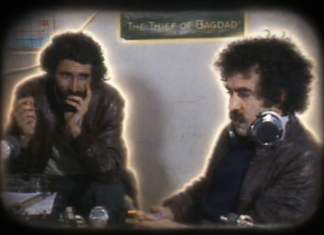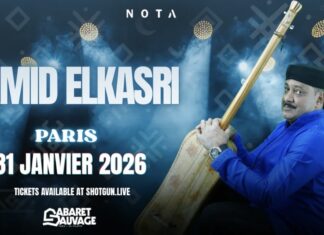L’écrivain franco-algérien Kamel Daoud, lauréat du prix Goncourt 2024 pour Houris, fait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux émis par la justice algérienne. En cause, un roman controversé et des accusations d’atteinte à la mémoire nationale.
Jacques-Marie Bourget : « Kamel Daoud le menteur »
La tension entre l’écrivain Kamel Daoud et les autorités algériennes atteint un nouveau sommet. Mardi 6 mai, la diplomatie française a confirmé que deux mandats d’arrêt internationaux avaient été émis par Alger à l’encontre du romancier. Le premier, transmis via Interpol Algérie en mars, aurait été suivi d’un second début mai. Ces mesures judiciaires ne tombent pas du ciel, elles interviennent dans un climat déjà marqué par des années de défiance entre Daoud et les cercles de pouvoir algériens, mais aussi par une hostilité grandissante de certains secteurs de la société à l’égard de sa posture publique.
Si Kamel Daoud jouit d’une reconnaissance littéraire indéniable en France et dans plusieurs pays francophones, son image en Algérie est beaucoup plus ambivalente. Certains le considèrent comme un écrivain éloigné des réalités de son pays d’origine, volontiers provocateur, souvent accusé d’entretenir un discours perçu comme condescendant ou moralisateur envers la société algérienne. Son style direct, sa posture d’intellectuel critique et ses prises de position répétées sur des sujets sensibles, religion, sexualité, mémoire nationale, lui ont valu une réputation de figure polémique.
Loin de se contenter de la fiction, Daoud a souvent mêlé journalisme et littérature. Dans ses chroniques, comme dans ses romans, il critique ouvertement ce qu’il appelle les hypocrisies sociales, le poids du religieux ou encore le tabou autour de la guerre civile des années 1990. Pour certains de ses compatriotes, ce regard est perçu comme une mise en accusation permanente, à la fois de l’État et de la société. À cela s’ajoute sa double nationalité et sa résidence principale en France, qui nourrissent le soupçon, celui d’un écrivain qui parlerait de l’Algérie « de l’extérieur », sans en assumer les risques concrets.
« Houris », une ligne rouge franchie
Le roman Houris, couronné du prix Goncourt en 2024, cristallise ces tensions. Il retrace le parcours d’une survivante de la décennie noire, cette guerre civile larvée qui a ensanglanté l’Algérie dans les années 1990. Le récit, qui aborde des massacres et des zones grises de l’histoire récente, est perçu par les autorités comme une atteinte au processus de réconciliation engagé en 2005 sous la présidence de Bouteflika. Une loi dite de « réconciliation nationale » interdit en effet toute remise en cause publique de l’armée ou des institutions, ainsi que toute évocation susceptible de « ternir l’image de l’Algérie ».
C’est sur cette base qu’un tribunal d’Oran a été saisi, donnant lieu à une plainte formelle et, selon la diplomatie française, à l’émission d’un premier mandat d’arrêt. Pour Alger, Houris est une œuvre perçue comme politiquement subversive, car elle remet en question l’effort officiel de tourner la page sur les années de guerre. L’écrivain est donc accusé non seulement d’ébranler l’unité nationale par ses mots, mais aussi de défier les garde-fous posés autour de la mémoire collective.
Accusations de nature personnelle
En parallèle, une autre plainte a été déposée fin 2024 par une femme affirmant que Kamel Daoud se serait inspiré de son histoire personnelle pour écrire le roman, sans son consentement. Elle invoque une violation du secret médical et une atteinte à la vie privée. Ces accusations, de nature civile mais potentiellement graves, élargissent le champ des reproches adressés à l’auteur. Si les poursuites politiques suscitent un débat international, cette plainte ajoute une dimension plus intime et juridiquement délicate à l’affaire.
Elle relance aussi une interrogation souvent soulevée dans les milieux littéraires. Jusqu’où un écrivain peut-il puiser dans des récits réels ? Dans ce cas précis, la plaignante estime que les détails présents dans le livre ne relèvent pas de la fiction mais d’un vol narratif. Le tribunal de Paris a d’ailleurs examiné ce mercredi 7 mai ce volet de l’affaire.
Le différend entre Kamel Daoud et les autorités algériennes ne date pas d’hier. Dès 2014, avec Meursault, contre-enquête, Daoud avait attiré les foudres de plusieurs figures conservatrices pour son appropriation libre du roman L’Étranger de Camus et ses propos sur l’islam. Des déclarations dans la presse française, où il qualifiait parfois la société algérienne de « malade du religieux », avaient provoqué des réactions violentes, allant jusqu’à des menaces de mort et une fatwa prononcée par un imam salafiste.
Ces épisodes ont contribué à créer une ligne de fracture durable entre l’auteur et une partie de l’opinion algérienne. Même parmi ses lecteurs, certains regrettent une forme d’essentialisation ou une tendance à alimenter des stéréotypes sur son propre pays, notamment dans les médias occidentaux. D’autres lui reprochent son silence sur des sujets brûlants, comme les luttes sociales contemporaines en Algérie ou la répression de certains mouvements contestataires.
Une instrumentalisation judiciaire ?
Du point de vue des critiques du régime, ces mandats d’arrêt seraient avant tout une manœuvre destinée à intimider un intellectuel dissident. Mais du point de vue des autorités, il s’agit de faire respecter la loi et de sanctionner des propos jugés diffamatoires ou attentatoires à la cohésion nationale. L’État algérien, depuis plusieurs années, tente de resserrer le contrôle sur les récits historiques, particulièrement ceux qui concernent la guerre civile ou les années post-indépendance. Dans ce cadre, la littérature devient un terrain de bataille idéologique.
L’affaire Daoud met en évidence les tensions entre liberté d’expression et préservation de l’ordre public. En Algérie, comme dans d’autres États confrontés à un passé violent non digéré, les récits qui sortent du cadre officiel sont souvent perçus comme dangereux. Le débat dépasse donc le simple cas Daoud, il pose la question de la légitimité des représentations alternatives, et du rôle que peut jouer la fiction dans la construction, ou la contestation, d’une mémoire nationale.
Interpol devra statuer sur la validité des mandats dans les semaines à venir. La France, de son côté, affirme surveiller la situation « avec attention ». Quant à Kamel Daoud, il ne s’est pas exprimé publiquement depuis l’annonce des mandats. S’il reste protégé sur le territoire français, ses déplacements à l’étranger pourraient désormais être limités, selon l’issue du recours engagé devant la commission de contrôle d’Interpol.
L’affaire pourrait durer. Elle ne manquera pas de nourrir les débats sur la liberté littéraire, les frontières de la fiction, et la difficile articulation entre mémoire, justice et expression individuelle dans les sociétés post-conflit.
Kamel Daoud continue à jouer au martyre