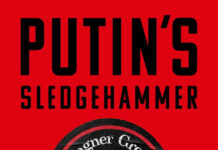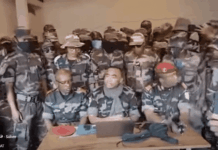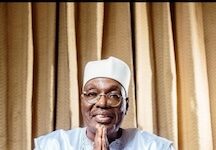Gabès est le théâtre depuis une semaine d’une mobilisation contre la pollution émanant du complexe chimique après une série de fuites toxiques. Le fruit de déceptions accumulées depuis dix ans. Des milliers d’habitants sont descendus dans la rue le 15 octobre pour réclamer la fermeture d’une usine chimique très polluante.
Selim Jaziri
Depuis plus d’une semaine, les manifestations se succèdent à Gabès, ville côtière du sud tunisien (120 000 habitants), pour réclamer la fermeture des installations polluantes du Groupe chimique tunisien. Le 15 octobre, une marche en direction du complexe industriel a été noyée sous les gaz lacrymogènes. La protestation a débuté le soir du 10 octobre, environ deux cents manifestants avaient envahi l’enceinte du site avant d’être délogés par l’armée dans la journée de samedi. Depuis, l’agitation ne retombe pas. Depuis dimanche, des manifestants dressent des barricades et brûlent des pneus dans la ville. Des heurts entre jeunes et forces de l’ordre rythment les soirées. La police a procédé à une centaine d’arrestations. L’union régionale du syndicat UGTT a lancé un appel à la grève générale pour le mardi 21 octobre.
Cette protestation fait suite à une série de fuites de gaz qui ont provoqué ces dernières semaines des dizaines de cas d’intoxication dans les quartiers environnants. Le 10 octobre, une trentaine de collégiens ont été hospitalisés, dont certains gardent des séquelles neurologiques, et 120 personnes encore le 14 octobre, provoquant une pénurie d’oxygène à l’hôpital régional. Au total, environ 300 personnes ont dû être hospitalisées depuis le 9 septembre.
Du paradis au cauchemar
Le site de Gabès avait été choisi en 1972 pour y installer les usines de transformation du phosphate extrait dans le bassin minier de Gafsa, en produits exportables (de l’acide phosphorique, des engrais phosphatés, de l’ammonitrate). Leur fabrication nécessite de l’acide sulfurique et rejette dans l’air des gaz tels tels que des oxydes de soufre ou du fluorure d’hydrogène. Lors du redémarrage de certaines unités, en principe opéré de nuit sous certaines conditions atmosphériques, la purge des installations lâche des excédents de gaz parfois rabattus sur les quartiers avoisinants. Régulièrement, du dioxyde d’azote, reconnaissable à sa fumée orange, s’échappe accidentellement. À cela s’ajoute le rejet dans la baie, au mépris des normes internationales, de 12 000 à 15 000 tonnes d’eaux utilisées pour laver le phosphate, qui déposent chaque jour au fond de la mer des tonnes de phosphogypse, une boue noire chargée de métaux lourds.
L’implantation de l’usine avait été accueillie comme une chance pour cette ville du sud. Le groupe chimique amenait la modernité et du travail. Mais ce rêve a vite tourné au cauchemar. L’oasis de Chenini, jouxtant la ville de Gabès, est l’une des rares oasis maritimes au monde. La pêche était miraculeuse, près de deux cents sources irriguaient les cultures de la palmeraie… Les habitants les plus âgés se souviennent d’un petit paradis.
Aujourd’hui, les sources sont taries par les pompages du groupe chimique et les forages anarchiques, les feuillages des palmiers sont grisâtres, il n’y a plus moyen de faire sécher du linge dehors sans qu’il ne soit recouvert de poussière noire, la palmeraie a perdu 93% de sa biodiversité, les fonds marins sont recouverts de phosphogypse sur des kilomètres, les poissons se font rares, alors que le Golfe de Gabès est l’un des principaux sites de reproduction halieutique en Méditerranée. Une espèce de crabe bleu sans prédateur, arrivée dans le ballast des navires qui viennent pour transporter le phosphate, a tellement dévasté la faune marine que les pêcheurs de Gabès l’ont baptisé Daesh…
Et bien sûr, les Gabèsiens se plaignent de problèmes de santé chroniques, asthme, fluorose dentaire, cancers… L’État peut d’autant plus facilement rester dans le déni et attribuer ces troubles à une psychose irrationnelle qu’aucune étude épidémiologique n’a jamais été effectuée. Quant aux bénéfices du groupe chimique, la région n’en voit guère la couleur. Elle a l’un les taux de chômage les plus élevés du pays et elle reste l’une des plus mal dotées en infrastructures.
Une patiente mobilisation
En dépit de tous ces troubles, la population a appris à vivre avec ce monstre suintant et éructant, mais dont dépendent environ sept mille familles. « Chacun a deux rêves ici, explique un Gabésien : se réveiller un matin et voir que le Groupe chimique a disparu, et recevoir sa lettre d’embauche pour y travailler ». De toutes façons, sous Ben Ali, il était impossible d’évoquer la pollution.
La mobilisation qui culmine aujourd’hui a été l’une des premières à naître à la faveur de la liberté acquise en 2011. Après une marche sur Tunis en avril 2011, elle s’est structurée à partir de 2012 autour du collectif « Stop Pollution », animé par quelques jeunes militants – un militant écologiste du quartier le plus proche du complexe, un ancien opposant à Ben Ali investi dans la Ligue des droits de l’homme, Khayreddine Debaya, devenu le visage du mouvement…
Ils parviennent à organiser une grande marche en 2013 qui va imposer le problème dans l’agenda politique national. Mais dans le climat ultra-polarisé de l’époque, son succès s’explique par des motifs plus politiques. Ennahdha, majoritaire à Gabès, la voit comme un foyer d’opposition et préfère utiliser l’emploi au Groupe chimique comme un levier clientéliste.
La mobilisation se concentre alors sur un travail d’expertise pour faire reconnaître le problème aux autorités et sur la sensibilisation de la population. Sous la pression, le gouvernement propose de déplacer le rejet du phosphogypse sur un terril à quelques kilomètres de Gabès, à Ouedref, dont la population rejette. Puis envisage de le recycler dans des matériaux de construction. L’expertise mobilisée par Stop Pollution parvient à convaincre les autorités que cette solution ne règle pas les problèmes de rejets aériens et que la décontamination du phosphogypse pour le rendre confirme aux normes coûterait beaucoup trop cher. Une seule solution demeure alors : le démantèlement du site et la relocalisation d’un complexe modernisé dans un site à l’écart d’une zone habitée. Même l’UGTT, dont la priorité est l’emploi, se rallie à cette option.
En juin 2017, Stop Pollution organise une grande manifestation et obtient de l’État l’engagement à démanteler les installations polluantes et à rebâtir un autre site loin de Gabès, au terme d’un plan d’action de huit ans.
Victoire en trompe-l’œil cependant. Les coûts du démantèlement et de la reconstruction des usines, des voies ferrées pour transporter la production jusqu’au port et les travailleurs depuis Gabès, ne sont pas budgétisés. Une estimation circule autour de plus de 4 milliards de dinars, près du dixième du budget de l’État alors. La perspective de l’installation d’un complexe industriel réveille des tensions sociales dans les sites pressentis pour accueillir les nouvelles installations. Le projet s’enlise.
La déception face à Kaïs Saïed
Beaucoup des jeunes mobilisés dans « Stop Pollution » s’impliquent en 2019 dans la campagne présidentielle de Kaïs Saïed, dont ils attendent qu’il secoue une administration corrompue et dominée par les élites du nord, et donne plus de pouvoirs aux échelons locaux grâce à sa « nouvelle construction » institutionnelle, censée « inverser la pyramide du pouvoir ».
Mais la déception s’installe vite. En fait de redistribution du pouvoir, le nouveau président décide seul. La surveillance policière se resserre sur les militants. Et le groupe chimique continue à empoisonner l’air et l’eau.
Le 5 mars dernier, au lieu du démantèlement promis, Kaïs Saïed annonce la construction d’un site de production d’hydrogène « vert » (c’est-à-dire produit sans pétrole) mais très gourmand en eau, et perçu comme un cheval de Troie de la recolonisation économique (le projet est porté par la France et par l’Allemagne), ainsi que le déclassement du phosphogypse de la liste des substances dangereuses en vue de promouvoir son recyclage.
Les fuites des dernières semaines ont cristallisé les mécontentements accumulés. L’ampleur des manifestations est inédite. L’UGTT soutient, le syndicat étudiant aussi, les supporters de foot se sont joints au mouvement lui apportant des troupes nombreuses et actives. La mobilisation appelle à relancer le projet de démantèlement et à revenir sur les décisions du 5 mars. Mais l’État est dans une équation impossible.
L’équation impossible
L’urgence financière est à la relance des exportations pour faire entrer des devises. L’augmentation de l’extraction de phosphate pour retrouver les niveaux d’avant 2011 (soit environ 10 millions de tonnes, contre environ la moitié actuellement), et donc de sa transformation pour l’exportation, est une priorité pour l’État afin de profiter de la hausse des cours mondiaux et regagner le terrain conquis par le concurrent marocain sur le marché.
Par ailleurs, l’État n’offre pas les garanties suffisantes pour financer le coûteux projet de démantèlement. De plus, selon Khayreddine Debaya, un petit groupe de hauts fonctionnaires au Ministère de l’Industrie, liés aux investisseurs étrangers, a la main sur la décision.
Mais la mobilisation concentre toutes les déceptions de la décennie. L’annonce par la présidence d’un appel à la Chine pour réhabiliter le complexe et traiter en urgence les problèmes à l’origine des fuites de ces dernières semaines ne calme pas la colère.
Pour le moment, elle est focalisée sur la question de la pollution. Il reste à surveiller une possible mutation vers des mots d’ordre politiques plus larges.
Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique