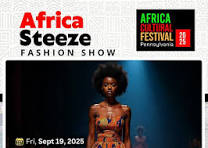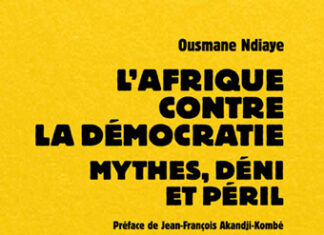Selon les agences de notation, la situation financière de la Tunisie est sortie de la zone de danger où elle se trouvait en 2023. Mais si les solutions adoptées permettent d’acheter du temps, les obstacles structurels demeurent.
Par Selim Jaziri
Le 12 septembre dernier, l’agence de notation financière Fitch a relevé la note souveraine de la Tunisie, évaluant sa capacité à rembourser sa dette publique à long terme, de CCC+, à B-. En termes plus clairs, les créances détenues sur l’État tunisien de risquées, sont jugées désormais de qualité moyenne, avec néanmoins une perspective négative. En août dernier, l’agence japonaise R&I avait également relevé la note tunisienne de « négative » à « stable ».
Des perpectives bien meilleures qu’en avril 2023, lorsque Kaïs Saïed avait refusé de se soumettre aux conditions du FMI pour obtenir un prêt de 1,9 milliard de dollars. La note Fitch était alors abaissée à CCC-, dernière marche avant l’enfer du défaut de paiement. Josep Borrell, le commissaire européen aux affaires extérieures, s’alarmait d’un pays « au bord du gouffre ». Finalement, ni défaut, ni gouffre, la situation de l’économie tunisienne semble rester à flot et s’éloigner de la tempête. Une évaluation qui contraste avec l’impression de marasme et le pessimisme de la majorité des Tunisiens. Quels indicateurs justifient ce verdict relativement optimiste ?
Des indicateurs bien orientés
La Tunisie a honoré ses dernières échéances sur les marchés financiers. Une fois un prêt de 700 millions de dollars en eurobonds remboursé en juillet 2026, il ne restera plus que des prêts bilatéraux à rembourser.
Les réserves de change de la Banque centrale (même si Fitch anticipe une diminution de 4,7 mois en 2024 à 3,9 mois en 2027) seront suffisantes pour faire face aux prochaines échéances. La balance des comptes courants (le solde des transactions avec l’étranger) s’améliore, grâce à la hausse des recettes touristiques, des revenus d’exportation d’huile d’olive pour la saison 2023-2024 (une tendance néanmoins inversée cette saison en raison de la baisse des cours mondiaux) et des remises des Tunisiens à l’étranger (passées de 4 à 6 % du PIB, entre 2018 et 2024).
Le déficit budgétaire tend à diminuer (de 6,3 % en 2024 à 5,3% en 2025, et une anticipation à 4% en 2027) grâce à la légère diminution de masse salariale de l’État, contenue en dessous de 14 % du PIB, à une baisse probable du montant des subventions (sur les produits de première nécessité et l’énergie) suite à la baisse du cours du pétrole.
Les besoins de financement budgétaire sont également orientés à la baisse (de 18% du PIB en 2024 à 13,5 % en 2027, très au-dessus des 9 % dans la période 2015-2019).
Enfin, le secteur bancaire tunisien devrait accroître sa capacité à financer l’État grâce à l’augmentation des dépôts et à la faiblesse de la demande de crédit.
Le tout sur fond d’une légère amélioration du taux de croissance de l’économie, estimée entre 1,5 et 2% du PIB cette année.
L’argent magique
Mais à quel prix ces améliorations ont-elles été possibles ? Kaïs Saïed continue de vanter les mérites du « compter sur soi », selon le mot d’ordre lancé en 2023. En réalité, estime Hamza Meddeb, chercheur au Carnegie Middle East Center, la Tunisie ne peut pas se passer de financement extérieur. Si elle a refusé le prêt de 1,9 milliard du FMI, elle a dû emprunter depuis 1,7 milliard de dollars auprès de la banque africaine d’import-export « Afrixem Bank », à des conditions moins favorables que celles du FMI. Elle a emprunté également 1,2 milliard à l’Algérie et à l’Arabie saoudite. Si bien qu’en fait le pays continue à s’endetter. Le taux d’endettement de l’État est passé de 79 à 84 % du PIB entre 2021 et 2025.
Le recours au système bancaire tunisien pour prêter à l’État, en nette hausse (+ 22 % en un an en juillet 2023, + 24 % en juillet 2024 et + 34 % en juillet 2025), a un double effet pervers : il expose le secteur bancaire au risque souverain (même si ce risque diminue) et diminue la capacité des banques à financer l’économie nationale.
Enfin, une bonne partie de l’amélioration de la situation financière de l’État et sa capacité à honorer ses échéances repose en réalité sur le recours à la « planche à billets » : la Banque centrale a en effet été obligée par deux lois de février et décembre 2024 de prêter à l’État 7 milliards de dinars (environ 2 milliards d’euros), à taux zéro. Un artifice potentiellement inflationniste qui ne rassure pas sur la capacité de l’économie tunisienne à renflouer ses réserves de devises et à répondre à ses besoins de financement.
L’austérité sans le FMI
Le « compter sur soi » s’est surtout concrétisé par la capacité de l’État à se serrer la ceinture de lui-même. « Kaïs Saïed a fait de l’austérité sans le FMI », relève également Hamza Meddeb.
« La priorité a été donnée au remboursement des dettes dans l’utilisation de ses réserves de devises au prix de restrictions des importations, explique l’économiste. Les dépenses d’importation d’énergie ont été réduites. Quitte à organiser des pénuries de denrées de première nécessité telles que le sucre, le riz, le café, la farine, etc, et à imposer des coupures d’électricité. Sur le plan énergétique, la Tunisie vit sous perfusion de l’Algérie qui fournit du gaz et parfois cède une partie de sa production électrique, au prix d’une dépendance politique. »
La masse salariale a été contenue grâce à un gel des embauches depuis trois ans et à une limitation à 3,5 % de l’augmentation des salaires de la fonction publique, un taux inférieur à l’inflation (revenue à 5,2 % en août 2025, après avoir dépassé 10 % début 2023). Depuis la réforme des chèques, en février dernier, les Tunisiens sont privés de l’accès au crédit à la consommation. Le taux de prélèvements obligatoires n’a cessé d’augmenter depuis 2011 et dépasse les 33%, soit plus du double de la moyenne des pays africains.
Contrairement aux attentes des opposants de Kaïs Saïed, ces conditions difficiles n’ont pas provoqué de troubles sociaux susceptibles de déstabiliser le régime. Pour le moment, observe Hamza Meddeb « les Tunisiens se sont accommodés ». Si les remises des Tunisiens résidents à l’étranger ont augmenté, c’est précisément le signe des difficultés sociales des familles. Cet apport financier n’est pas consacré à des investissements, il permet de faire face aux dépenses courantes.
Par ailleurs, les détenteurs du capital des banques, qui détiennent également les principales sociétés tunisiennes, trouvent leur compte à cette situation, dans le court terme, grâce aux taux d’intérêt élevés servis aux banques privées qui prêtent à l’État et aux profits qu’ils permettent de réaliser.
Des fragilités structurelles
Cet assemblage financier, budgétaire, social et politique qui permet pour l’instant à Kaïs Saïed de réussir son pari, reste fragile.
La Tunisie est à la merci d’un nouveau choc conjoncturel (une hausse des cours du pétrole ou des produits alimentaires, une récession en Europe) qui dégraderait à nouveau la balance des comptes, relancerait la hausse du déficit budgétaire et de l’inflation qui éreinterait les ménages.
L’État n’a aucune marge de manœuvre : 93 % des dépenses publiques sont consacrées aux salaires, au remboursement de la dette et aux subventions. L’État n’a quasiment plus aucune capacité d’investissement. « Même le mur de l’école de Mezzouna dont l’effondrement avait tué trois collégiens en avril dernier, n’a toujours pas été reconstruit », relève Hamza Meddeb. Les services publics continuent de se dégrader.
« Les entreprises publiques ne sont toujours pas restructurées et leurs dettes, qui n’apparaissent pas dans le décompte de la dette de l’État, représentent 20 à 40 % du PIB selon la Banque mondiale », poursuit-il. « La Tunisie n’entretient plus son appareil productif et affaiblit son capital humain », déplore-t-il encore.
Faute de réformes, « les obstacles structurels à la création d’emplois, à la croissance tirée par le secteur privé et par les investissements étrangers demeurent », observait en août dernier l’économiste Hachemi Alaya. Une absence de perspective propice à l’émigration et à la fuite des cerveaux. Plus de mille médecins quittent la Tunisie chaque année (1600 en 2024, selon Nizar Laadhari, secrétaire général du conseil de l’ordre), pour 800 nouveaux diplômés par promotion.
Le spectre du défaut de paiement c’est éloigné, mais « la Tunisie a fait défaut sur son avenir », conclut Hamza Meddeb.