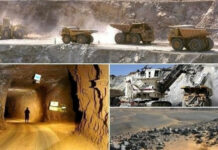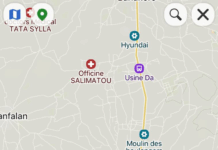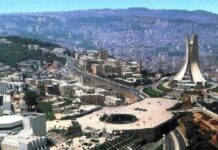Dans une Amérique polarisée et électoralement serrée, même de légers déplacements d’attitude peuvent avoir des effets considérables. La « question israélienne » entre dans une nouvelle phase à Washington.: moins stable, plus pluraliste et de plus en plus façonnée par les transformations politiques internes des grands partis politiques, démcrates et républicains,, autant que par les événements au Moyen-Orient où les monarchies pétrolières juent un role que l’on avait sans doute négligé.
Pour les observateurs étrangers, le basculement est clair. Le soutien américain à Israël ne s’effondre pas, mais il n’est plus automatique
C’est dans ce contexte qu’il faut évaluer le plan de 21 points d’une complexité incroyable que bien de proposer le président Trump en présence du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Ce projet est très en retrait des propositions franco-séoudiennes déposées à l’ONU, mais n’est pas pour autant à la remorque des propositions d’Israël qui ne veulent entendre parler à aucun prix d’une entité palestinienne et du maintien des populations palestiniennes dans l’enclave.
Le réveil des monarchies pétrolières, notamment des Émiratis, après le bombardement de Doha que la Maison Blanche a tenté de rassurer ces derniers jours a pesé lourd sans ce décrochage de Trump face aux oukazes de son allié de toujours, Benjamin Netanyahou comme Mondafrique l’avait expliqué dans une chronique récente.
La presse anglophone croit Trump capable de modérer Netanyahou
Pour autant, le choix d’un Tony Blair pour animer un hypothétique comité de la paix, alors que l’ex Premier ministre anglais est discrédité pour avoir appuyé l’intervention américaine en Irak ne prête guère à l’optimisme. Dans le cas où le Hamas refuse ce nouveau plan, Donald Trump a assuré Benjamin Netanyahou de son soutien total dans leur volonté de « finir leur travail », à savoir d’enterrer définitivement Gaza sous un tapis de bombes.
Pendant plus d’un demi-siècle, la politique américaine à l’égard d’Israël a reposé sur des fondations si solides qu’elles semblaient inébranlables. Un profond réservoir de sympathie populaire était renforcé par un consensus bipartisan à Washington et par des organisations de lobbying puissantes, au premier rang desquelles l’AIPAC, qui évoluait dans une zone d’immunité politique quasi totale.
Ce consensus reposait à la fois sur des piliers matériels et culturels. Matériellement, il s’appuyait sur d’importants flux d’aide militaire américaine, une coopération étroite en matière de renseignement et un alignement stratégique durable. Culturellement, il avait été façonné par la Guerre froide, le sionisme chrétien et des récits moraux forgés dans l’ombre de la Shoah et de la victoire israélienne de 1967.
Au sein du Parti républicain, l’idée d’une civilisation « judéo-chrétienne » commune faisait de la défense d’Israël une composante de l’identité américaine elle-même. Les évangéliques y voyaient l’accomplissement de la prophétie biblique, les néoconservateurs considéraient Israël comme un avant-poste libéral dans une région hostile, et les stratèges de la Guerre froide le percevaient comme un partenaire fiable face au communisme puis à l’islamisme radical. Pendant des décennies, soutenir Israël était considéré comme un test de sérieux politique dans les deux grands partis.
Aujourd’hui, cette architecture est soumise à des pressions venues de deux directions à la fois. Dans le camp démocrate, le défi est moral et générationnel. Dans le camp républicain, il est générationnel, culturel et politique : passage d’un langage civilisationnel à un populisme nationaliste, méfiance accrue envers les institutions étatiques et transformation rapide des écosystèmes médiatiques. Ensemble, ces évolutions érodent progressivement le consensus bipartisan qui a défini les relations américano-israéliennes pendant plus d’un demi-siècle.
Le changement est particulièrement visible chez les démocrates. Pendant des décennies, les sondages ont montré une opinion américaine stable ou croissante en faveur d’Israël. En 2025, le Pew Research Center a révélé pour la première fois que davantage d’Américains exprimaient une opinion défavorable que favorable à l’égard d’Israël. Une majorité de démocrates sympathise désormais davantage avec les Palestiniens qu’avec les Israéliens, tandis que les républicains restent majoritairement favorables. Cette évolution est largement portée par les jeunes générations, dont les expériences formatrices n’ont pas été la Guerre froide ou le processus d’Oslo, mais la guerre d’Irak, la « guerre contre le terrorisme », les échecs des interventions américaines et la diffusion en temps réel, via les réseaux sociaux, des images de la dévastation de Gaza. Leur cadre moral s’est déplacé : Israël n’est plus vu comme une démocratie assiégée, mais comme une puissance militaire exerçant une force écrasante.
Ces changements se traduisent politiquement. Lors de la primaire démocrate de 2024 dans le Michigan, plus de 100 000 électeurs ont voté « non engagé » pour protester contre la politique de Joe Biden à Gaza. Les communautés arabo-musulmanes de villes clés ainsi que les jeunes progressistes ont démontré leur capacité à peser dans des États très disputés. Des évolutions similaires, quoique moins spectaculaires, apparaissent parmi certains électeurs américains d’origine asiatique et parmi les jeunes indépendants, qui voient de plus en plus dans le soutien inconditionnel à Israël un symbole d’une politique étrangère opaque et non responsable. Pour les dirigeants démocrates, maintenir des positions pro-israéliennes traditionnelles devient donc plus risqué, en particulier dans les primaires et dans les grandes zones urbaines.
Les jeunes Républicains radicalisés
Le basculement républicain est plus subtil, mais tout aussi décisif — et lui aussi générationnel. Les républicains plus âgés, formés à l’époque de la Guerre froide et de Ronald Reagan, continuent à voir Israël à travers le prisme de la civilisation judéo-chrétienne et de l’alliance stratégique. Pour eux, soutenir Israël reste un marqueur fondamental de l’identité nationale.
Mais les conservateurs plus jeunes — en particulier ceux radicalisés en ligne — évoluent dans des univers médiatiques différents. Au lieu de suivre Fox News, ils s’informent auprès de figures populistes nationalistes telles que Tucker Carlson, Steve Bannon, Charlie Kirk ou Candace Owens. Leur vision est moins théologique et davantage nationaliste et transactionnelle. Pour eux, Israël est un allié parmi d’autres, à évaluer en fonction des coûts et des intérêts souverains, et non un partenaire sacré.
Des élites jugées illégitimes
Cette mutation idéologique est amplifiée par une profonde méfiance à l’égard de la « bureaucratie permanente », souvent appelée « État profond » dans les cercles MAGA. Là où les conservateurs plus âgés vénéraient les institutions de défense et de renseignement américaines, nombre de jeunes nationalistes les perçoivent comme des élites hostiles et irresponsables. Comme l’alliance américano-israélienne est étroitement liée à ces institutions, les arguments stratégiques qui faisaient jadis autorité sont désormais accueillis avec scepticisme. L’AIPAC elle-même est parfois décrite dans ce milieu comme faisant partie de l’establishment de Washington.
Les critiques nationalistes d’Israël ne traduisent pas une sympathie particulière pour les Palestiniens, mais plutôt une défiance vis-à-vis des engagements étrangers défendus par des élites jugées illégitimes.
Cette évolution crée un dilemme stratégique pour les dirigeants israéliens et leurs alliés américains. Pendant des décennies, l’AIPAC et les gouvernements israéliens successifs se sont appuyés sur une base républicaine unifiée, combinant évangéliques et faucons stratégiques. Cette unité n’existe plus. Les évangéliques restent fidèles, mais l’écosystème médiatique populiste ne peut plus être tenu pour acquis. Benjamin Netanyahou pourrait s’appuyer sur Trump pour maintenir la base MAGA dans le rang, mais cela comporte des risques : la loyauté de Trump est transactionnelle, et dans un second mandat, il pourrait prendre ses distances avec Israël pour affirmer son autonomie vis-à-vis des élites de Washington. Affronter directement le scepticisme nationaliste reviendrait, pour AIPAC et Israël, à défier un mouvement qui prospère en s’opposant aux institutions « globalistes » — une stratégie tout aussi périlleuse.
Dans le même temps, les structures institutionnelles qui soutiennent l’alliance américano-israélienne demeurent puissantes. L’AIPAC a dépensé des dizaines de millions de dollars lors des primaires de 2024 pour battre des critiques progressistes, et les lois anti-BDS adoptées dans de nombreux États constituent des obstacles juridiques à tout changement rapide. Mais des fissures apparaissent. Le soutien d’AIPAC à des républicains ayant rejeté les résultats de l’élection de 2020 a terni son image bipartisane auprès des jeunes démocrates, et des recours judiciaires contre ces lois progressent. Sur les campus, les campements et la mobilisation militante ont donné naissance à une nouvelle génération d’acteurs politiques pour qui la Palestine représente un repère moral comparable au mouvement anti-apartheid des années 1980.
À la place d’un consensus bipartisan stable, plusieurs courants politiques distincts se croisent désormais. Les démocrates affrontent des pressions morales et générationnelles venues de leur base ; les républicains naviguent entre la loyauté évangélique des aînés et le scepticisme nationaliste des jeunes générations. L’AIPAC reste un acteur redoutable, mais dans un environnement plus disputé.