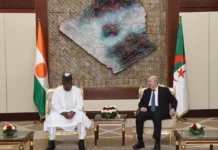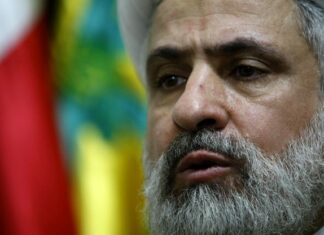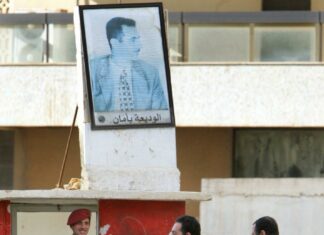Madagascar compte en son sein une importante communauté d’origine indienne, que la population désigne par deux dénominations : « indo-pakistanais » ou « karana ». Bien qu’assez peu nombreux, les Indopakistanais exercent une immense influence au sein de la société malgache grâce au rôle dominant qu’ils jouent dans la vie économique du pays. Leur situation se trouve d’autant plus confortée que les Malgaches ont une faible tradition d’entreprise et une capacité d’organisation peu développée. L’histoire de l’implantation de cette minorité nous aidera à comprendre la mauvaise réputation qu’is ont dans la population.
Daniel Sainte Roche
Dans un classement du magazine Forbes de 2015, sur les quatre plus grosses fortunes professionnelles malgaches figurant parmi les 25 plus importantes en Afrique, trois sont indiennes. Le seul Axian par exemple pèse 2,75 milliards USD de chiffre d’affaires total pour l’exercice clos en 2024, a investi 1 milliard de dollars US dans les opérations, et a généré 1,87 milliard USD de PIB.
Les relations des indo-pakistanais avec la population ne dépassent guère les relations professionnelles : la communauté indo-pakistanaise forme un groupe impénétrable et fortement individualisé, réfractaire à toute forme d’assimilation.
La population semble observer vis à vis de cette composante de la société une attitude méfiante, et cela en dépit des efforts des dirigeants successifs du pays qui ont opté le plus souvent pour une politique conciliante. Ainsi, au lendemain de l’indépendance, un responsable du gouvernement a déclaré, le 17 avril 1964 lors de l’inauguration de la première réunion de l’association Indo-Malgache : « Се pays est le vôtre. Ne craignez ni d’investir, ni de créer des industries. Mais dites à vos compatriotes de ne pas se livrer à des commerces usuraires. » La recommandation du ministre fait référence à l’une des pratiques illicites dont sont coutumiers les commerçants indo-pakistanais, et qui les présente aux yeux de la population comme des capitalistes sans éthique.
L’immigration Indienne à Madagascar
Les commerçants indiens sont venus à Madagascar depuis une époque très reculée, les moussons permettant aux boutres de la côte de Malabar d’atteindre l’Afrique orientale. Cette immigration individuelle et spontanée s’étend du 8 au 19ème siècle, et peut être mis d’une part sur le compte d’un goût prononcé pour l’aventure et d’autre part par l’expansion de la religion islamique (la plupart des Indiens de Madagascar pratiquent cette religion). De plus, l`a Côte de Malabar a joué un rôle de premier plan dans le commerce de l’Océan Indien et en 1873, un voyageur britannique notait déjà qu’à travers tout le circuit de Zanzibar au Mozambique, de Madagascar au Cap de Gardafui, la quasi-totalité des commerçants étaient des Indiens. Etablis dans un premier temps dans l’Ocean indien ou sur la côte est africaine, certains de ces commerçants se sont finalement installés à Majunga, Nosy-Be, Diego-Suarez, Mahajanga, et Ambanja et travaillaient comme intermédiaires entre les Mascareignes (La Réunion, Maurice), l’ Inde, Mascate (capitale portuaire du sultanat d’Oman), et la Grande ile.
La dernière étape qui a couronné l’immigration indienne commence au début du XXe siècle quand Galliéni, gouverneur général de l’époque a recruté près de 100 travailleurs de Pondichéry pour effectuer les travaux de terrassement des chemins de fer de la ligne Tananarive Côte Est.
Bien que l’immigration ait été stoppée très tôt, la communauté indienne de Madagascar s’est développée par l’excédent de ses naissances sur ses décès. Actuellement, la minorité Indo-Pakistanaise de Madagascar compterait près de 20.000 membres (en l’absence de statistiques officielles). La quasi-totalité de ces indiens sont nés dans la grande ile et ne connaissent pas l’Inde. Quoi qu’il en soit, ils continuent d’adopter leur us et coutumes et professent toujours la religion de leurs ancêtres. C’est ainsi que l’on rencontre à Madagascar deux principales communautés indiennes, l’une hindoue et l’autre musulmane (subdivisée elle-même en quatre sectes Khodja, Bohra, Ismaéliens et Sounis).
Première puissance économique à Madagascar
Bien que l’installation des colonies marchandes indiennes dans l’Océan Indien remonte à une époque très ancienne, elle ne connut un véritable essor que pendant la période coloniale. A l’arrivée des cоlonisateurs français, ces commerçants étaient déjà fort bien implantés. Ils accueillirent d’ailleurs fort bien la colonisation qui les favorisait En effet, à la différence des courtiers européens, ils parvenaient à ratisser la brousse. Parlant les dialectes locaux, ils se procuraient des produits spéculatifs qu’ils revendaient à des prix onéreux aux grandes compagnies. Des privilèges ont été octroyés aux commerçants indiens par l’administration coloniale, sous forme de facilitation de la délivrance d’autorisations, ou d’exemption au travail forcé auquel était assujetti les autochtones. Ils ont été explicitement favorisés pour affaiblir les élites et les réseaux marchands malgaches, et ont acquis de ce fait une position d’intermédiaire commercial solide (négociants, collecteurs…).
Les commerçants indo-pakistanais ont connu par la suite un enrichissement rapide, et sont même parvenus à supplanter les Européens dans le grand commerce. Il faut noter au passage que leurs fortunes se sont considérablement accrues grâce à la manipulation du marché noir pendant la deuxième guerre mondiale.
Dès les premières années de l’indépendance, de nombreuses critiques furent formulées à l’endroit de la minorité Indo- Pakistanaise qui se démarquait sensiblement de la majorité des Malgaches par son opulence. Cet état de fait amena les Indiens à amorcer une tentative de reconversion dans des secteurs considérés comme beaucoup plus productifs pour la collectivité et à progressivement s’implanter dans le secteur industriel, sans pour autant abandonner leurs activités traditionnelles dans la quincaillerie, le textile, la bijouterie.
Une grande capacite d’organisation
Le succès de la minorité indo-pakistanaise peut être expliqué par l’efficacité de leurs méthodes de commerce et de leurs organisations commerciales. Si la génération actuelle d’Indo-Pakistanaise pense que la règle d’or dans la pratique commerciale reste l’honnêteté, I ‘histoire de l’ère coloniale nous a enseigné que cette minorité s’est enrichie sur le dos des Malgaches, lesquels ont fait l’objet d’une véritable exploitation. En effet, il est ancré dans l’imagerie populaire que dans les tractations commerciales, les commerçants indo-pakistanais ne manquaient pas de frauder sur le prix, la qualité ou la quantité des marchandises.
Toutes sortes d’exactions étaient effectuées, el le troc lésionnaire réalisé au détriment des paysans dans les zones rurales. Chaque période de crise fut mise à profit par ces commerçants pour organiser et manipuler le marché noir. Ces comportements anti-économiques ont suscité des réactions très vives de la part des Malgaches.
Il faut cependant reconnaitre que les Indiens de Madagascar doivent leur réussite économique a des qualités qui sont spécifiques aux minorités ethniques étrangères établies dans un pays africain, tels les Libanais en Afrique de l’Ouest. Une solidarité communautaire très forte, alliée a un sens des affaires aiguisé au fil des générations et appuyée par des connexions familiales étendues à de nombreux pays leur conférent un atout non négligeable. C’est dans ce contexte que fut créé vers les années 50 la première industrie « Karana », une entreprise de confection et une usine de fabrication de bougies. Ces firmes furent suivies par une multitude de sociétés, axant dans un premier temps leurs activités dans l’industrie textile et la confection pour s’étendre ensuite dans tous les secteurs. Le résultat en est que les firmes indo-pakistanaises constituent actuellement l’essentiel du secteur industriel de Madagascar, d’autant plus qu’elles ont pris en main les entreprises abandonnées par les Européens.
Des solidarités communautaires
L’efficacité de l’organisation des Karana repose surtout sur la solidarité qui existe au sein de cette communauté. Leurs activités professionnelles forment une pyramide ayant à son sommet les diverses entreprises industrielles qui sont en relation directe avec les établissements de gros et de demi-gros. Ces derniers font fonction de distributeurs pour les nombreux magasins de détail dirigés par ies Indo-Pakistanais. Et comme il est fréquent que les membres d’une même famille exercent des activités très diverses, les problèmes de débouchés pour les produits ne se posent jamais. A l’attention de certains de leurs membres dont l’envergure est assez modeste, la solidarité des Indo-Pakistanais se traduit par le recours à une véritable banque occulte, à laquelle peuvent recourir ceux qui ne peuvent obtenir entière satisfaction auprès des institutions financières locales. Cette possibilité de recourir à des sources de financement « souples » procurent a la minorité indo-pakistanaise un avantage sur leurs concurrents malgaches.
90 % des exploitations Indo-Pakistanaises sont des affaires individuelles. Il s’agit généralement de magasins tenus par le chef de famille, assisté de quelques employés malgaches ou des membres de la famille. Mais ce sont les grands groupes à succursales multiples qui défrayent le plus souvent les chroniques. Ces sociétés ont à leurs têtes des cadres émoulus des grandes écoles européennes et américaines. Il est fréquent que les actions sociales soient réparties entre les différents membres d’une même famille. Il en est ainsi de la multinationale Axian dirigée par Hassanein Hiridjee, un ancien de l’École supérieure de commerce de Paris. Au plus haut sommet du groupe trônent les progénitures des 3 frères Hiridjee Bashir, Raza-Aly et Rosanaly. La direction des différentes sociétés du groupe est confiée à des hauts-cadres internationaux, où les cadres malgaches brillent par leur absence : sur une quinzaine de hauts-dirigeants d’Axian, ne figure qu’un employé malgache, au rang de simple « chef des ressources humaines ». Le même schéma se retrouve dans les autres grands groupes indo-pakistanais, pour ne citer que les plus célèbres : Filatex, avec Hasnaine Yavarhoussen et son père Abdoulrassoul Yavarhoussen ; le Groupe Basan avec la famille Barday ; le groupe Redland avec la Famille Akbaraly ; le groupe SOCOTA avec la famille Ismail…
Les Indo-Pakistanais, un poison pour l’indépendance de Madagascar (volet 2)
La Russie de Poutine en embuscade à Madagascar