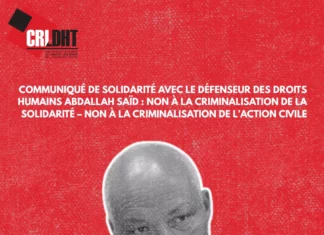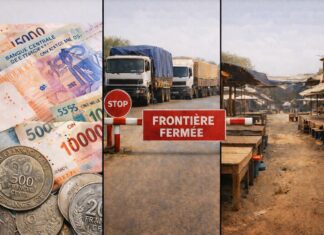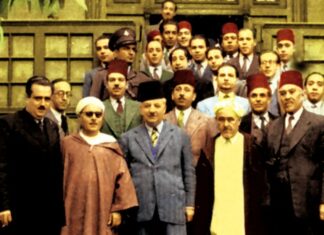Ce 1er Août 2025, l’ancien Premier ministre malien Moussa Mara a été placé sous mandat de dépôt, selon une publication du journaliste Serge Daniel sur le réseau social X. Le motif ? Des publications critiques sur la situation politique du pays, probablement jugées subversives par les autorités actuelles de Bamako.
Mohamed AG Ahmedou
L’événement, en soi, pourrait relever du fait divers politique si la trajectoire de Moussa Mara ne cristallisait pas à elle seule les ambiguïtés et les tragédies d’une génération politique qui, après avoir cru dompter la junte, a fini par se faire avaler par elle.
La sanction d’une parole libre ou le retour de bâton d’un compagnonnage aveugle ?
Moussa Mara n’est pas un opposant classique. Il fut l’un des rares à défendre publiquement la junte militaire malienne à ses débuts, croyant y voir une opportunité de rupture avec le système de prédation installé depuis les années ATT. Technocrate, volontaire, à la fibre panafricaine affichée, Mara incarne cette nouvelle génération d’hommes politiques maliens qui, après avoir tenté d’influencer le pouvoir militaire de l’intérieur, se retrouvent aujourd’hui marginalisés, voire persécutés.
Mais l’arrestation de Mara n’est pas un accident. Elle s’inscrit dans une longue série de purges silencieuses où d’anciens compagnons de route de la transition, à l’image du défunt Soumeylou Boubèye Maïga, d’Issa Kaou Djim, ou de Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath, ont été successivement mis à l’écart, embastillés ou réduits au silence. Le message est limpide : dans le Mali de la junte, aucune loyauté passée ne garantit l’immunité. Toute critique, même modérée, devient trahison.
Le dilemme des intellectuels face au pouvoir
En reconnaissant le statut en qualité des autorités maliennes à la junte militaire malienne en date du 26 juillet 2021, en compagnie de plusieurs figures politiques du Mali, lors de sa
déclaration ce jour là, Moussa Mara a commis une erreur stratégique : celle de croire qu’un pouvoir militaire sans légitimité populaire pouvait se régénérer par l’intelligence technocratique et la bonne volonté politique. Ce malentendu originel est au cœur de la crise actuelle.
déclaration ce jour là, Moussa Mara a commis une erreur stratégique : celle de croire qu’un pouvoir militaire sans légitimité populaire pouvait se régénérer par l’intelligence technocratique et la bonne volonté politique. Ce malentendu originel est au cœur de la crise actuelle.
Dans son discours, Moussa Mara n’a jamais cessé d’appeler à une gouvernance rigoureuse, au respect des institutions et à un retour à la légalité. Mais sa parole s’est progressivement vidée de sa portée, à mesure que la transition malienne dérivait vers un autoritarisme militarisé. Que reste-t-il alors d’un homme d’État quand l’État lui-même est confisqué par des intérêts claniques, des alliances informelles avec des groupes armés et la logique de guerre imposée par des mercenaires étrangers ?
Le populisme militaire contre la pensée politique
Depuis 2020, la junte malienne gouverne à coups de slogans : « restauration de la souveraineté », « rupture avec la France », « refondation ». Mais dans les faits, ce pouvoir a substitué la réflexion à la propagande, le débat à l’invective, la complexité du réel à une posture revancharde. Tout acteur politique, même ancien allié, devient une menace s’il ose interroger la trajectoire du pays.
C’est précisément ce qu’a fait Moussa Mara dans ses publications récentes. En critiquant les dérives de la transition, il n’a fait que reprendre un rôle qui aurait dû être le sien depuis le début : celui d’un homme libre, porteur d’une parole publique, soucieux de l’intérêt général. Mais la junte n’accepte ni les nuances, ni la contradiction. Elle gouverne dans un climat de paranoïa où toute voix indépendante est perçue comme une tentative de déstabilisation.
Une trahison politique… partagée
Les partisans de Mara dénoncent une dérive autoritaire. Ses détracteurs, eux, y voient une juste rétribution : celle d’un homme qui a trahi les idéaux démocratiques en cautionnant un pouvoir de putschistes. Ces critiques ne sont pas sans fondement. En acceptant de dialoguer avec des militaires sans projet politique autre que leur propre maintien au pouvoir, en participant à leur légitimation nationale et internationale, Mara et d’autres figures comme Kaou Djim ont participé à affaiblir les rares contre-pouvoirs encore existants au Mali.
L’arrestation de Moussa Mara marque ainsi une étape dans l’effondrement politique malien. Elle montre qu’il ne suffit pas d’être brillant, loyal ou républicain pour survivre dans un système fondé sur la peur, la suspicion et la confiscation du débat public.
Leçons d’un naufrage
À l’échelle sahélienne, le cas Moussa Mara devrait faire école. Il illustre les risques d’une politique sans colonne vertébrale, d’un engagement dépourvu de lignes rouges claires. Car dans les régimes autoritaires, la complaisance est toujours à sens unique : ceux qui se taisent aujourd’hui seront peut-être les prisonniers de demain.
Le silence de la CEDEAO, de l’Union africaine, et même d’anciens alliés politiques maliens sur l’affaire Mara est tout aussi inquiétant. Il consacre la normalisation de l’arbitraire, l’acceptation tacite d’un Mali régi par les caprices d’un régime militaire qui ne tolère plus aucune critique, même en 280 caractères.