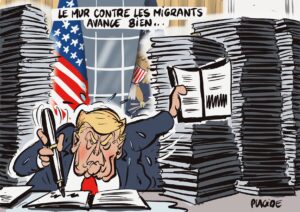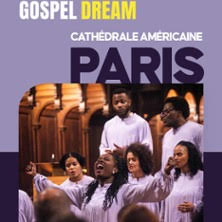Mondafrique, 15 mai. Le Conseil de Sécurité Nationale (NSC) des États-Unis a historiquement fonctionné selon deux principaux modèles de sécurité nationale. Donald Trump est en train d’en inventer un troisième, nettement plus éruptif et en tout cas pragmatique qui laisse les principaux acteurs des relations internationales en état de choc
La vision que Donald Trump affiche sur le fonctionnement souhaitable des relations internationales met l’accent sur une diplomatie transactionnelle et des négociations rapides axées sur des résultats immédiats, au détriment des processus bureaucratiques inter-agences et des engagements multilatéraux à long terme. Cela reflète une évolution plus large de la diplomatie mondiale, où les grandes puissances comme la Chine, la Russie et l’Inde adoptent déjà des stratégies pragmatiques fondées sur leurs intérêts nationaux. Autant dire que l’approche du Président américain est aux antipodes des deux modèles qui ont présidé, ces trente dernières années, aux orientations du Conseil National de Sécurité (CNS).
Le modèle Scowcroft, du nom de Brent Scowcroft, met l’accent sur un processus décisionnel structuré, où le conseiller à la sécurité nationale joue un rôle de coordinateur neutre. Cette approche favorise la collaboration inter-agences, permettant aux départements d’État, de la Défense et à la CIA de contribuer à l’élaboration des politiques. Toutefois, cela peut ralentir la prise de décision, car la recherche de consensus prend souvent le pas sur l’action rapide.
Le modèle Kissinger/Brzezinski, en revanche, est axé sur la stratégie. Des conseillers tels que Henry Kissinger sous Nixon et Zbigniew Brzezinski sous Carter ont adopté une approche interventionniste, façonnant directement la politique étrangère et exerçant un contrôle étroit sur l’apport des agences. Si ce modèle a permis de rationaliser la prise de décisions, il a parfois entraîné des tensions avec d’autres départements, accusés d’être mis à l’écart.
Le modèle Trump : une diplomatie transactionnelle
Le second mandat de Trump pourrait donner la priorité à une diplomatie directe et non conventionnelle, plutôt qu’au consensus multilatéral. Bien que certains aspects du modèle Kissinger, comme le contrôle centralisé, restent présents et pourraient même se renforcer, la stratégie de Trump vise à bypasser l’inertie bureaucratique pour obtenir des résultats rapides. Cela a été évident lors de son premier mandat, avec des réalisations comme les Accords d’Abraham et son engagement direct avec Kim Jong-un en Corée du Nord. Trump a souvent contourné les institutions traditionnelles au profit d’accords bilatéraux.
Dans cette optique, Trump considère les accords multilatéraux – tels que l’Accord de Paris sur le climat et l’Accord nucléaire iranien – comme des contraintes limitant la flexibilité des États-Unis. Il préfère plutôt des accords spécifiques et évolutifs, ajustables en fonction des circonstances – « pas d’amis permanents, pas d’ennemis permanents ». Ses détracteurs craignent que cette approche ne sape la confiance des alliés à long terme, mais ses partisans soutiennent qu’elle permet aux États-Unis de s’adapter rapidement à une carte géopolitique en mutation
Loyauté et efficacité.
Dans sa conception très calquée sur le monde des affaires tel qu’il a connu, Donald Trump mettra un accent particulier sur des émissaires spéciaux qui rendraient compte directement soit au Président, soit à son cercle restreint au sein du NSC. Ces émissaires joueraient un rôle clé dans son appareil diplomatique, court-circuitant les lenteurs bureaucratiques pour garantir une exécution rapide et sans entrave de ses directives.
Pour concrétiser cette vision, Trump pourrait établir une Cellule de Commandement Stratégique et de Contrôle au sein du NSC – une sorte de « Département de l’Efficacité Gouvernementale » (DOGE) hypothétique. Cette entité fournirait des renseignements exploitables et des conseils politiques en temps réel, sans les lenteurs qui entravent habituellement la prise de décisions en politique étrangère. En privilégiant la loyauté et l’efficacité, Trump cherche à instaurer une structure de sécurité nationale réactive, plus alignée sur son style « supprimer les intermédiaires ».
Cette approche rappelle la tentative infructueuse de l’ancien Secrétaire à la Défense Caspar Weinberger, qui voulait transformer l’armée américaine d’une force lourde et rigide en une force légère, rapide et agile, mais qui s’est heurté à la résistance des élites militaires et bureaucratiques.
Réforme Institutionnelle et Résistances
L’expérience de Trump lors de son premier mandat a renforcé sa méfiance à l’égard de la bureaucratie fédérale. Il s’est régulièrement heurté aux fonctionnaires de carrière sur des dossiers comme la politique en Ukraine et le retrait des troupes américaines. Pour Trump, la bureaucratie n’est pas un facilitateur, mais un obstacle à la prise de décisions rapides et stratégiques. Sa réponse a été de consolider son autorité au sein de la Maison-Blanche, en confiant à des conseillers de confiance, comme Robert O’Brien, la mission de faire appliquer ses directives.
Cette méthode présente des avantages clairs. Accélérer la prise de décisions permet d’être plus réactif, notamment dans des situations exigeant une action immédiate. Trump a utilisé cette approche transactionnelle pour forcer ses alliés à accroître leurs dépenses de défense, et pour mettre la pression sur Panama (passage gratuit des navires américains), la Colombie (rapatriement des réfugiés) et le Mexique (répression du trafic de drogue).
Cependant, cette stratégie impose un équilibre délicat entre centralisation du pouvoir et coordination institutionnelle. Un conseiller NSC sous Trump devra arbitrer entre les différents départements et agences pour assurer une cohérence politique tout en préservant la fluidité de l’exécution. Henry Kissinger, par exemple, avait réussi à maintenir un contrôle fort tout en exploitant habilement la bureaucratie.
Des ruptures radicales
Le modèle de Trump pour un second mandat marque une rupture nette avec les cadres traditionnels de Scowcroft et Kissinger. En privilégiant une diplomatie transactionnelle, un contrôle centralisé et des décisions rapides, Trump veut moderniser la politique étrangère américaine pour répondre aux défis d’un monde plus fluide et fondé sur les intérêts.
Cette stratégie rencontrera une forte opposition des élites bureaucratiques et des partisans du multilatéralisme. Cependant, face à une compétition géopolitique accrue, l’agilité et la réactivité deviennent des atouts décisifs. Si Trump parvient à imposer son modèle, il pourrait établir une nouvelle doctrine de la diplomatie américaine, basée sur la force, la flexibilité et le pragmatisme stratégique.
La question demeure : Trump, en « inondant la zone », pourra-t-il réformer et rationaliser la bureaucratie fédérale, tout en imposant un nouveau paradigme de la sécurité nationale en seulement quatre ans ? Le défi est immense, mais s’il y parvient, ce Président clivant pourrait redéfinir la place des États-Unis dans le monde pour les décennies à venir. Pour le meilleur ou pour le pire, telle est la question à laquelle personne ne peut répondre vraiment aujourd’hui.
La nouvelle diplomatie souverainiste de Donald Trump entre en fonction