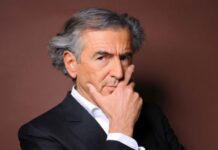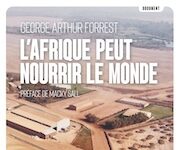Pris entre les pressions d’Israël, les exigences américaines, les ambitions iraniennes et le chaos à Gaza, le Liban vit un printemps 2025 sous haute tension. Tandis que le gouvernement prône le dialogue avec le Hezbollah, les risques d’embrasement régional et d’effondrement intérieur n’ont jamais été aussi élevés.

Le Liban aborde le printemps 2025 dans un climat de tension extrême, pris en étau entre ses défis politiques internes et une escalade sécuritaire régionale. Après une longue de vacance du pouvoir, c’est avec un grand soulagement qu’ont été accueillies l’élection du général Joseph Aoun à la présidence en janvier et la formation, en février, d’un gouvernement d’union dirigé par Nawaf Salam. Mais entre l’élan politique affiché et la mise en œuvre concrète des réformes, le chemin s’annonce semé d’obstacles.
Ce tandem aux commandes de l’État s’est en effet fixé pour mission de redresser un pays en crise et de réaffirmer l’autorité de l’État, notamment face à la puissante milice chiite du Hezbollah. Mais la tâche s’avère redoutable : alors qu’une fragile trêve a mis fin en novembre 2024 à une guerre dévastatrice entre Israël et le Hezbollah, les tensions restent vives sur la frontière sud du Liban, et les pressions internationales s’intensifient pour désarmer le « Parti de Dieu ». Pendant ce temps, Israël multiplie les opérations militaires et la perspective d’une reprise du conflit palestino-israélien à Gaza plane dangereusement sur la région.
D’emblée, le nouveau président Aoun avait affiché son ambition de restaurer le monopole de la force armée aux mains de l’État libanais . Pourtant, la réalité du terrain impose au chef de l’État un exercice d’équilibrisme. Comment désarmer le Hezbollah – fer de lance de la « résistance » contre Israël aux yeux de ses partisans – sans ébranler davantage la stabilité interne du Liban ? Comment faire appliquer les clauses du cessez-le-feu de novembre 2024, qui prévoient le retrait total des troupes israéliennes et le déploiement exclusif de l’armée libanaise au sud du Litani, alors que la méfiance règne entre les belligérants et que chaque camp accuse l’autre de violer la trêve ? Ce dilemme est au cœur de la situation actuelle, plaçant le Liban à la croisée des chemins entre apaisement et embrasement imminent.
Le pari (difficile) du dialogue avec le Hezbollah
L’investiture du président Joseph Aoun et la nomination de Nawaf Salam au poste de Premier ministre ont été perçues comme l’ouverture d’une nouvelle ère politique à Beyrouth, marquée par la volonté de réformes et de souveraineté retrouvée. Le chef de l’État, ancien commandant en chef de l’armée, jouit d’une réputation de neutralité et de fermeté. Conscient que la question des armes du Hezbollah est devenue incontournable après la guerre de 2024, Aoun a engagé prudemment des pourparlers avec le mouvement chiite. « Tout sujet intérieur controversé au Liban ne peut être abordé que par le dialogue conciliant et la communication, sans confrontation. Sinon, nous mènerions le Liban à sa perte », a-t-il déclaré, soulignant que le désarmement du Hezbollah est une affaire “sensible, délicate” devant être traitée avec doigté afin de préserver la paix nationale .
Le président libanais affirme donc rechercher une solution négociée. Dans son discours d’investiture, il a proposé l’élaboration d’une stratégie nationale de défense, dans le cadre de laquelle le Hezbollah serait invité à discuter de l’avenir de son arsenal, étape par étape. Cette approche graduelle se veut rassurante : il ne s’agirait pas d’exiger un abandon brutal des armes, mais d’intégrer progressivement la puissance militaire du Hezbollah au sein d’un plan d’ensemble défensif piloté par l’État. Joseph Aoun a même fixé l’horizon de fin 2025 pour finaliser ce processus – c’est la première fois qu’un dirigeant libanais évoque publiquement un calendrier pour parvenir à cantonner les armes aux seules mains de l’État . Toutefois, le chef de l’État le répète, il n’est pas question de précipiter les choses « dans des circonstances défavorables » alors que l’aviation israélienne continue de frapper le territoire libanais en violation du cessez-le-feu .
Face à cette main tendue mesurée, le Hezbollah affiche pour l’instant une attitude mêlant défiance et pragmatisme. Le gouvernement de Nawaf Salam, de son côté, reste prudent. Plusieurs ministres, issus de partis hostiles à la mainmise du Hezbollah sur les affaires sécuritaires, réclament un calendrier clair de désarmement. Néanmoins, Salam sait qu’il doit composer avec la réalité du rapport de force interne : le Hezbollah demeure une composante influente du Parlement et conserve une base populaire importante. Toute confrontation frontale risquerait de faire vaciller le cabinet et de replonger le pays dans l’impasse institutionnelle. Pour l’heure, le mot d’ordre du pouvoir est donc au dialogue national – un pari délicat pour restaurer l’autorité de l’État sans provoquer de schisme interne.
Le Hezbollah, entre repli stratégique et défi permanent
Affaibli mais loin d’être anéanti, le Hezbollah aborde l’après-guerre en campant sur ses positions. Son Secrétaire Général, Naïm Kassem, qui a succédé a Hassan Nasrallah, a récemment adopté un ton de défi à l’égard des autorités libanaises comme de la communauté internationale. « Nous ne permettrons à personne de désarmer le Hezbollah ou la résistance », a-t-il martelé sur la chaîne affiliée Al-Manar. Réaffirmant que les armes du parti ne sont pas négociables, Kassem a même ajouté qu’il fallait « rayer cette idée de désarmement du dictionnaire ».
Il faut dire que du point de vue du mouvement chiite, la cessation des hostilités fin 2024 reste incomplète et asymétrique. Certes, le cessez-le-feu négocié en novembre sous l’égide de Washington a mis fin à plus d’un an de combats meurtriers, mais Israël n’a pas entièrement honoré ses engagements. Au lieu d’un retrait total, Tsahal maintient des positions sur cinq collines stratégiques du sud du Liban, invoquant des raisons de sécurité. Surtout, l’aviation israélienne continue de survoler et de frapper le territoire libanais presque quotidiennement, visant ce qu’elle présente comme des cibles du Hezbollah.
Un désarmement conditionné à la fin des agressions israéliennes
Pour le Hezbollah, ces « agressions israéliennes quotidiennes » constituent une violation flagrante de la trêve, face à laquelle “l’inaction” du gouvernement libanais est vivement critiquée. Dans un tel contexte, arguent ses chefs, comment envisager de baisser la garde ? Le « Parti de Dieu » souligne en outre qu’il a déjà fait preuve de retenue. Après la guerre, l’organisation n’a pas repris ses attaques contre l’armée israélienne, acceptant de donner une chance aux pourparlers à l’initiative du président Aoun. « Nous restons ouverts à un dialogue sur une stratégie de défense pour le Liban, mais il n’est pas question de discuter d’un désarmement tant que l’occupation et les agressions israéliennes se poursuivent », a expliqué un député du Hezbollah, Hassan Fadlallah . De fait, le mouvement lie explicitement toute évolution de son statut militaire à des gestes préalables d’Israël : retrait des troupes résiduelles, arrêt des survols et frappes, voire échanges de prisonniers. « Ne serait-il pas logique, a lancé un cadre du parti, qu’Israël se retire d’abord et cesse son agression… puis que nous discutions d’une stratégie de défense ? ». Autrement dit, pas de désarmement unilatéral : le Hezbollah se dit prêt à négocier dans le cadre d’un plan global, mais refuse de rendre les armes sous la pression.
Malgré cette rhétorique de défi, la réalité est que le Hezbollah sort considérablement éprouvé de la confrontation de 2024. En un an de guerre, le groupe a perdu nombre de ses cadres militaires et politiques les plus aguerris, y compris son chef historique Hassan Nasrallah, tué dans un raid israélien d’après la presse libanaise . Son arsenal de roquettes et missiles a en grande partie été détruit par l’offensive israélienne, qui a également ravagé ses infrastructures dans la banlieue sud de Beyrouth et au sud du Litani . Par ailleurs, la chute du régime syrien de Bachar el-Assad – renversé l’an dernier par une insurrection soutenue par l’Occident – prive le Hezbollah d’un précieux allié régional et de ses routes d’approvisionnement en armes provenant d’Iran . Ces revers sans précédent placent le mouvement dans une posture défensive. Aux yeux de nombreux observateurs, la question jadis impensable d’un désarmement du Hezbollah n’est plus totalement taboue et pourrait même devenir inéluctable à terme . Conscient de sa fragilité nouvelle, le parti chiite cherche donc avant tout à gagner du temps et à redorer son image de « bouclier du Liban » pour conserver le soutien de sa base. Jusqu’où pourra-t-il s’opposer aux appels au désarmement sans se heurter frontalement à l’État ? C’est toute l’incertitude des mois à venir.
Le Hezbollah au cœur du bras de fer américano-iranien
Dans ce bras de fer larvé entre l’État libanais et le Hezbollah, les États-Unis jouent un rôle déterminant en coulisses. Washington, qui a parrainé l’accord de cessez-le-feu de 2024, entend désormais s’assurer qu’il soit pleinement appliqué. Pour l’administration du président Donald Trump, revenue aux affaires début 2025, le désarmement du Hezbollah est devenu un objectif affiché de sa politique au Liban. En visite à Beyrouth début avril, la diplomate américaine Morgan Ortagus, envoyée spéciale adjointe pour le Moyen-Orient, a multiplié les déclarations fermes. « Il est clair que le Hezbollah doit être désarmé le plus vite possible », a-t-elle insisté dans une interview à la LBCI, ajoutant que l’armée libanaise était tenue de remplir cette mission sans tarder. Ortagus a averti que les États-Unis « continueront de faire pression sur le gouvernement » pour qu’il respecte pleinement la cessation des hostilités, y compris en démantelant toutes les milices armées. Elle a même comparé le Hezbollah à « un cancer » qu’il faudrait extirper du Liban pour permettre au pays de retrouver sa souveraineté et la paix.
Cette fermeté américaine s’accompagne de mesures de pression multiformes. Sur le plan diplomatique, le sujet Hezbollah est désormais central dans les échanges entre Washington et Beyrouth. Sur le plan économique, l’aide financière internationale indispensable au Liban (notamment pour la reconstruction post-conflit) est conditionnée à des réformes, mais aussi à des avancées concrètes sur le contrôle des armes. D’ores et déjà, l’armée libanaise – perçue comme le partenaire légitime pour sécuriser le sud – a reçu un soutien accru en équipements et formations. Parallèlement, les États-Unis maintiennent un régime de sanctions sévères contre le Hezbollah et ses réseaux financiers, cherchant à tarir les sources de financement de la milice. Cette campagne soutenue traduit l’impatience croissante de Washington face à ce qui est perçu comme une stratégie libanaise de temporisation. Chaque jour sans progrès tangible sur le désarmement est vu par certains à Washington comme un jour gagné par le Hezbollah pour se réorganiser.
Dans ce jeu d’influences, l’Iran occupe évidemment une place majeure en arrière-plan. Le Hezbollah, créé et soutenu par Téhéran depuis des décennies, s’aligne en grande partie sur la ligne stratégique iranienne. Or, en ce printemps 2025, les relations entre l’Iran et les États-Unis sont de nouveau à vif autour de la question nucléaire. Des négociations indirectes ont bien repris ces derniers mois – on a même annoncé des pourparlers techniques en cours à Oman en vue d’un éventuel accord – mais le fossé demeure profond entre les exigences de Washington et celles de Téhéran. Le président Trump, qui avait dénoncé l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 lors de son premier mandat, a durci le ton : il menace explicitement d’attaquer l’Iran si aucun nouvel accord empêchant la République islamique d’acquérir l’arme atomique n’est conclu rapidement. Dans ce climat tendu, le discours offensif de Naïm Kassem à Beyrouth apparaît en écho des positions intransigeantes de Téhéran. Comme un message du régime iranien aux Occidentaux, la direction du Hezbollah fait savoir qu’elle ne cédera rien sur le terrain tant que la pression sur l’Iran perdure. Certains analystes y voient un moyen pour Téhéran de renforcer son levier de négociation : en jouant la carte du Hezbollah – ou du moins en affichant une posture inflexible par procuration – l’Iran rappelle qu’une déstabilisation du Liban et une reprise des hostilités avec Israël sont possibles si ses propres intérêts ne sont pas pris en compte.
Des informations de presse non confirmées font même état de discussions au sein de l’appareil sécuritaire américain sur d’éventuelles frappes préventives contre l’Iran. L’objectif serait de neutraliser les « capacités de nuisance » de Téhéran, c’est-à-dire son programme nucléaire et ses relais régionaux comme le Hezbollah, dans l’hypothèse d’un échec de la diplomatie. Ces spéculations alimentent l’inquiétude à Beyrouth : une confrontation ouverte entre Washington et Téhéran aurait immanquablement des répercussions dramatiques sur le Liban, qui pourrait redevenir un terrain d’affrontement indirect entre l’Iran et les États-Unis.
La Syrie, un nouveau facteur d’incertitude
Enfin, un autre acteur régional complique l’équation : la Syrie. La guerre de 2024 n’a pas seulement affaibli le Hezbollah ; elle a aussi rebattu les cartes chez le voisin syrien. Le régime de Bachar el-Assad, allié historique de l’Iran et du Hezbollah, a été renversé à la faveur du conflit. Damas est désormais dirigé par un gouvernement de transition moins hostile à l’Occident, ce qui a permis une timide relance des relations entre Beyrouth et Damas. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam s’est même rendu en visite officielle à Damas en avril pour « recadrer » les liens bilatéraux. Cette recomposition pourrait à terme isoler davantage le Hezbollah, privé de la profondeur stratégique syrienne. Mais dans l’immédiat, elle ajoute de l’imprévisibilité géopolitique : la frontière libano-syrienne, autrefois couloir d’approvisionnement pour la milice chiite, pourrait devenir un front secondaire si des groupes hostiles au Hezbollah s’y implantent avec la bénédiction du nouveau pouvoir syrien. Autant de variables régionales qui pèsent sur le calcul stratégique du Hezbollah comme sur celui du gouvernement libanais.
Une trêve qui s’effrite
Au sud, le long de la frontière israélo-libanaise, la situation reste extrêmement tendue en ce mois d’avril 2025. Si les grandes manœuvres militaires ont cessé depuis le cessez-le-feu, les violations de part et d’autre sont quasi quotidiennes, risquant à tout moment de dégénérer. Israël, en particulier, continue de mettre une forte pression militaire. L’aviation israélienne mène des survols réguliers du territoire libanais et effectue des frappes ponctuelles, officiellement dirigées contre des éléments du Hezbollah. Ces deux dernières semaines, plusieurs bombardements ont visé des localités du sud Liban et même la banlieue sud de Beyrouth (fief du Hezbollah). Le 1er avril, un raid aérien israélien sur le quartier de Dahiyeh, à Beyrouth, a tué au moins quatre personnes, marquant la seconde attaque du genre en moins d’une semaine et ébranlant un peu plus la trêve conclue avec le Hezbollah. Tsahal a justifié cette opération en affirmant avoir éliminé un cadre du Hezbollah lié à la Force al-Qods iranienne qui préparait des actions « terroristes » avec le Hamas palestinien. De son côté, le gouvernement libanais a dénoncé une violation intolérable de la souveraineté du Liban. Mais sur le terrain, il ne dispose guère de moyens de dissuasion immédiats face à la supériorité militaire israélienne, si ce n’est la présence symbolique de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies) et de quelques bataillons de l’armée libanaise déployés au sud.
Pour Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, maintenir une posture de fermeté vis-à-vis du Liban semble servir plusieurs objectifs. D’une part, Tel-Aviv veut empêcher le Hezbollah de se réorganiser après la guerre et de reconstituer son arsenal : les frappes ciblées contre des dépôts d’armes ou des commandants restants visent à affaiblir durablement le mouvement chiite. Selon des observateurs occidentaux, l’armée israélienne frappe désormais les cibles au Liban avec une quasi-impunité, profitant de la retenue forcée du Hezbollah qui ne riposte pas afin de ne pas rompre la trêve. D’autre part, Netanyahou n’a guère intérêt, sur le plan politique intérieur, à un retour au statu quo ante. La guerre de 2024, bien que coûteuse, lui a permis de resserrer les rangs en Israël et de réaffirmer son discours sécuritaire. Une « paix froide » au nord, si elle permettait au Hezbollah de se renforcer à nouveau, serait perçue comme une faiblesse et ne saurait satisfaire son électorat le plus dur.
Surtout, le front de Gaza demeure en ébullition, contribuant à l’intransigeance israélienne. Le conflit déclenché à l’automne 2023 contre le Hamas s’est mué en une guerre d’usure que la trêve de novembre 2024 n’a pas vraiment résolue – au contraire. À Gaza, la situation humanitaire reste catastrophique et aucun accord politique durable n’a émergé. Début 2025, des accrochages sporadiques ont repris, et en avril, Tsahal a lancé certains de ses raids les plus intenses depuis la trêve, ciblant des positions du Hamas dans l’enclave palestinienne. Parallèlement, des négociations indirectes se poursuivent via l’Égypte pour tenter de consolider un cessez-le-feu. Mais les exigences des deux camps semblent inconciliables : Israël exige que le Hamas se démilitarise et restitue l’ensemble des otages capturés en 2023, tandis que le mouvement islamiste refuse de déposer les armes tant que le blocus n’est pas levé et se dit prêt à libérer les captifs seulement en échange d’une fin définitive des hostilités. Ce dialogue de sourds alimente la frustration de Netanyahou, qui voit le Hamas camper sur ses positions. Faute de progrès, une reprise à grande échelle de la guerre à Gaza est jugée plausible par les experts, avec le risque qu’elle rejaillisse sur le Liban. En effet, c’est l’embrasement simultané des fronts sud (Gaza) et nord (Liban) qui avait conduit à la conflagration régionale de l’an dernier. À Beyrouth, on redoute qu’une nouvelle offensive israélienne à Gaza n’incite le Hezbollah – poussé par l’Iran ou par solidarité idéologique – à rouvrir le front libanais, ne serait-ce que pour « soulager » la pression sur les Palestiniens. Un scénario que ni le Liban ni la communauté internationale ne souhaitent revivre, tant il serait synonyme de destruction généralisée.
Gaza, détonateur potentiel au Liban
Cinq mois après la cessation des combats, le Liban demeure sur un volcan. Sur le plan intérieur, le pays profite d’un répit bienvenu : les institutions fonctionnent à nouveau, les déplacements de réfugiés syriens vers leur pays ont repris timidement, et l’économie, exsangue, tente de redémarrer grâce aux promesses d’aide internationale. Mais cet équilibre est d’une extrême fragilité. Le gouvernement libanais est sommé d’agir rapidement pour appliquer les clauses du cessez-le-feu – notamment le démantèlement des positions armées au sud et la saisie des armes non autorisées –, sans quoi l’aide extérieure pourrait se tarir et la situation sécuritaire dégénérer. Pour l’heure, l’armée libanaise a entrepris de fouiller certaines caches d’armes au sud du Litani (plusieurs centaines ont été détruites depuis l’accord de trêve, selon des sources sécuritaires) . Mais toucher aux armes du Hezbollah reste un casus belli potentiel. Le parti chiite argue que l’accord de novembre 2024 ne vise explicitement que la zone au sud du Liban – pas l’ensemble du territoire – et il brandit les violations persistantes d’Israël (frappes aériennes, présence sur les collines frontalières) pour justifier le gel de toute mesure le concernant . En privé, les responsables libanais admettent que le temps joue un rôle clé : ils espèrent que, dans les mois à venir, la donne régionale évoluera suffisamment (apaisement à Gaza, progrès dans les pourparlers irano-américains) pour faciliter un désarmement négocié du Hezbollah sans risquer l’implosion interne. Cette stratégie du « pas à pas », toutefois, teste la patience des Américains et de certains partenaires européens, qui y voient une forme de procrastination dangereuse.
Le risque principal est qu’un incident vienne rompre la fragile retenue actuelle. Une bavure militaire au Liban Sud, une frappe israélienne trop meurtrière à Beyrouth, ou au contraire une attaque d’éléments incontrôlés contre les forces israéliennes, et l’engrenage de la guerre pourrait repartir. L’hypothèse d’une conflagration régionale plus vaste reste également sur la table : si les tensions entre Israël et l’Iran devaient dégénérer – par exemple à la suite d’un coup de force israélien contre les installations nucléaires iraniennes, ou d’une riposte iranienne via ses alliés –, le Liban serait immanquablement pris dans la tourmente. À l’intersection de toutes les lignes de faille du Moyen-Orient, le pays du Cèdre subit de plein fouet les contrecoups des rivalités entre grandes puissances et puissances régionales.
Une paix sous respiration artificielle, un pays en sursis
L’heure est à la vigilance maximale à Beyrouth comme dans les chancelleries étrangères. Le gouvernement Aoun-Salam joue sa crédibilité sur sa capacité à éviter une rechute dans la guerre tout en progressant vers un règlement durable de la question du Hezbollah. Le Hezbollah, de son côté, devra décider jusqu’où pousser son défi sans provoquer l’isolement du Liban ni perdre le soutien populaire dont il jouit encore chez une partie des chiites. Quant à Israël, ses choix – calmer le jeu ou au contraire l’envenimer – auront un impact direct sur la stabilité de son voisin du nord. L’issue reste incertaine. Analystes et diplomates s’accordent à dire que le Liban se trouve à un tournant critique : soit un compromis politique interne et des désamorçages régionaux permettent de consolider la paix relative des derniers mois, soit le pays risque de replonger dans la spirale des violences. Plus que jamais, la moindre étincelle pourrait rallumer l’incendie dans un Liban épuisé par les crises. Et alors que plane encore le spectre de la guerre civile, chacun mesure que la fenêtre pour agir prudemment et éviter le pire est étroite – mais qu’elle existe, à condition d’une volonté commune de tous les acteurs d’épargner au Liban un nouveau chaos.
Le Liban demeure en sursis, suspendu à des décisions qui le dépassent en partie. Le constat est unanime parmi les observateurs : la situation actuelle – ni guerre ouverte, ni véritable paix – n’est pas tenable indéfiniment. Le pays devra soit trouver en lui les ressources d’un sursaut politique pour résoudre la question du Hezbollah dans le cadre de l’État, soit subir les effets d’un embrasement décidé ailleurs. Dans un Moyen-Orient plus volatil que jamais, le Liban joue sa stabilité sur un fil, dans l’espoir précaire que la raison l’emporte sur la fureur. Les jours qui viennent diront si cette espérance d’une sortie de crise pacifique peut se concrétiser, ou si le Liban devra affronter à nouveau les démons de la guerre.