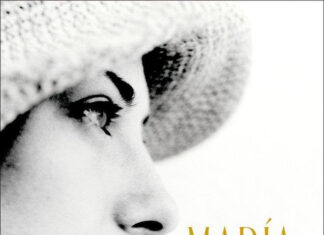Auteur d’une trentaine de livres composée de poésie, de romans, de théâtre, de chroniques et d’essais, Josué Guébo sait de quoi il parle lorsqu’il évoque la vie sociale de l’écrivain en Côte d’Ivoire. Il est d’ailleurs le président honoraire de l’Association des écrivains de Côte d’Ivoire (AECI) et du Cercle d’études Séry Bailly (CESB), du nom d’un universitaire ivoirien décédé en décembre 2018.
Dans cet entretien accordé à Mondafrique, Josué Guébo, par ailleurs Maître de Conférences au Département de philosophie de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan et lauréat de nombreux prix littéraire, dont celui de Tchicaya U Tam’si pour la poésie africaine (2014), le Grand prix national de littérature Bernard Dadié (2016) et le Prix Jeanne de Cavally pour la littérature enfantine (2023), revient sur les conditions de vie et de travail de l’écrivain ivoirien. Il en appelle à plus de soutien de la part de l’Etat.
Correspondance à Abidjan, Bati Abouè
Les assises de l’Association des écrivains de Côte d’Ivoire (AECI) consacrées aux conditions de vie de vos collègues écrivains ont eu lieu le samedi 22 février ici à Abidjan. Et selon votre contribution, il y a urgence. Pouvez-vous nous décrire les conditions de vie actuelles des écrivains ivoiriens ?
Disons-le tout net, la réalité de l’écrivain ivoirien n’est pas du tout reluisante. Tous ceux de la communauté des hommes de plumes qui ne tirent pas le diable par la queue, sont nécessairement ceux qui ont d’autres fonctions dans la vie que le métier de la plume.
N’est-ce pas parce que le marché du livre est compliqué et que les Ivoiriens ne lisent pas assez ?
Qui dit que les Ivoiriens ne lisent pas ? À mon avis, ils lisent. Peut-être pas suffisamment, mais on voit bien qu’ils sont intéressés par tout ce qui s’écrit sur les réseaux sociaux. Pour moi, la faiblesse du rapport de l’Ivoirien au livre provient principalement du regard dépréciatif que les pouvoirs publics ont sur les choses culturelles en général, et sur le livre en particulier. Il y a ici une confusion grave entre le culturel et le spectaculaire. Ce qui est valorisé ici, ce n’est pas la patiente quête de connaissance qu’implique le rapport au livre, mais la promotion du cosmétique. Nous sommes dans une culture d’un matérialisme bricolé. La question de la complexité de la chaîne du livre en découle. Le problème, c’est aussi la vision que nos gouvernants ont du livre. Ils ont l’air de comprendre que la route précède le développement, mais ils n’ont pas l’air de réaliser que le livre, lui précède la route, car sans livre, pas d’ingénieur pour concevoir la route.
Alors, parlez-nous de la complexité de la chaîne du livre et à quel point cela explique-t-il le désespoir des écrivains ivoiriens ?
Ce que l’on peut considérer comme une complexité, bien qu’elle n’en soit pas une, en réalité, c’est ce jeu de la très inégale répartition des bénéfices entre les acteurs de la chaîne du livre. Cette répartition fait des auteurs, les parents pauvres de tout le dispositif du livre. Le livre, ici, ne nourrit pas son homme, mais son ombre. Ceux que j’appelle « l’ombre », ce sont les maillons connexes à l’écrivain dans la chaîne du livre : le libraire, l’éditeur, l’imprimeur. La plupart des éditeurs reversent entre 3% et 5% de la valeur d’un livre à l’auteur. Les plus humains vont parfois à 10%. Sur un livre qui coûte 3000 FCFA, donc l’auteur a en moyenne, 150 f CFA, là où l’éditeur, l’imprimeur et le libraire se partagent les 2850. Ce qui fait qu’aucun de ces trois n’a individuellement moins de 800 FCFA sur ce montant. Voici la réalité de l’écrivain. Cette réalité est portée par l’idée fallacieuse que l’effort intellectuel est un capital économique quasi-nul.
Qu’a fait votre association pour que les choses changent et quel rôle, à votre avis, l’Etat doit-il jouer pour améliorer les conditions de vie des écrivains ?
L’AECI qui aura 40 ans, l’année prochaine, précisément le 31 août 2026, mobilise les auteurs, les défend dans la mesure de ses possibilités et sensibilise sur la nécessité de valoriser les livres et les auteurs. L’un des combats réussis par l’AECI, c’est d’avoir permis une plus grande introduction des auteurs locaux au sein du programme scolaire national. Sur ce point nous voulons sincèrement saluer l’excellence de la coopération avec le ministère de l’éducation nationale qui a permis que les auteurs nationaux soient de plus en plus étudiés dans les écoles.
Mais le chantier, d’une valorisation des conditions de vie des créateurs de l’écrit reste encore en friche. Depuis 40 ans, les militants du livre en Côte d’Ivoire, œuvrent – sans réclamer de médailles – (rires) pour que les écrivains soient mieux traités. Il y va de la santé intellectuelle, voire mentale de ce pays. Nous proposons donc qu’une fois l’an, l’Etat de Côte d’Ivoire lève 250 FCFA sur les salaires de 260 000 fonctionnaires que compte ce pays. Tous les fonctionnaires sont redevables au livre, car passés par l’école. Une telle mesure permettra d’appuyer à hauteur de 65 millions l’Association des Ecrivains de Côte d’Ivoire. Nous suggérons, par ailleurs, que 1% des recettes générées par le Salon du Livre d’Abidjan soit reversé aux écrivains, à travers leur association et que de même soit reversé à l’AECI 1% du bénéfice annuel des librairies. Le BURIDA pourrait être chargé de la collecte et de la répartition de cette somme. Cela permettrait de redynamiser considérablement la chaîne du livre en Côte d’Ivoire.
Maintenant, en tant qu’écrivain, que pouvez-vous faire pour vous valoriser ? Les écrivains ivoiriens sont rarement reçus aux prix internationaux. N’y a-t-il pas réellement un problème de talents ?
Nous n’avons aucun problème de talent. Je ne sais pas quel prix Senghor, Césaire ou Damas ont remporté pour être les auteurs de portée et de résonance universelle que nous connaissons tous. Il faut déjà savoir que l’écrivain n’est pas un chasseur de primes. Sortons du complexe de la marchandise. Les prix conviennent mieux aux produits d’étalage. Par ailleurs, rien ne garantit que les prix soient vraiment le seul gage d’excellence. Il y a les colloques, mais aussi la somme de travaux universitaires sur une œuvre qui peuvent valablement témoigner de sa maturité et de son excellence. Cela dit, il est absolument inexact d’affirmer que les auteurs Ivoiriens sont rarement reçus aux prix internationaux. Le premier Grand Prix littéraire d’Afrique Noire, Aké Loba, est Ivoirien. D’autres lui ont emboîté le pas : Bernard Dadié, Jean-Marie Adiaffi, Véronique Tadjo, Venance Konan.
Oui, mais ça date tout ça…
Aujourd’hui Armand Gauz, caracole : il a remporté, à lui tout seul, le Grand Prix littéraire d’Afrique noire, le Prix Ethiophile et d’autres prix internationaux d’amplitude significative. À titre personnel, j’ai remporté le très sélectif Tchicaya U Tam’si, un prix attribué sous l’égide de l’UNESCO et que j’ai obtenu au même titre que René Depestre, né en 1926, Edouard Maunick, né en 1931 et Jean-Baptiste Tati-Loutard, né en 1938. Lamine Sall, né en 1951 et primé par l’académie française, l’a obtenu juste après moi et l’immense poète Paul Dakeyo, né en 1948, vient à peine de l’avoir.
Alors, dans cette chaîne, il n’y a que l’Etat qui ne répond pas aux attentes ?
A part l’Etat, il y a, à mon avis, les critiques littéraires et les éditeurs : les uns par leur absence et les autres par leur extrême permissivité plombent la qualité générale du livre produit en Côte d’Ivoire.
Ne resterait plus que votre exposition. Est-ce qu’il faut suffisamment d’infrastructures du livre, par exemple les bibliothèques dans chaque commune et des émissions consacrées aux livres dans les médias ?
Absolument. Les bibliothèques manquent cruellement. Même dans les établissements académiques. La politique du livre est beaucoup trop événementielle pour l’instant. Le Salon du Livre est une chose excellente, mais c’est une comète annuelle. Ce qu’il importe de faire vivre ce sont des bibliothèques en nombre au moins égal aux dispensaires et centre de santé de proximité. C’est une question de santé intellectuelle. La place du livre dans les médias est tout à fait problématique. Il n’y a jamais eu dans ce pays, un espace médiatique réservé au livre qu’on ait pu comparer aux plages faites à la musique et à la danse. La culture en Côte d’Ivoire a valorisé Podium et Variétoscope, la musique et la danse. Aujourd’hui, nous sommes reconnus, dans ces domaines, à l’international en étant le pays d’Alpha Blondy, de Meiway et de DJ Arafat. Pour la danse, on n’en compte plus les variantes : zouglou, coupé décalé, Gnakpa, Cacher-regarder et j’en passe. Le théâtre porté aussi à l’écran un temps a porté ses fruits : les humoristes en terre d’Éburnie ne se comptent plus. Si l’Etat avait valorisé le livre comme, il a promu la musique et la danse, il est clair que la littérature ivoirienne s’en porterait mieux. Malheureusement, la Côte d’Ivoire a conditionné ces fils à préférer le Kpankaka (mot popularisé par une influenceuse ivoirienne pour exprimer des choses vulgaires, NDLR) à Climbié. Et c’est un problème. Mais il peut encore aujourd’hui être résolu. Il suffit d’amplifier la place des activités littéraires dans le champ de nos médias audiovisuels en particulier.
Ne songez-vous pas parfois, à votre niveau, à faire du lobbying auprès des décideurs institutionnels, médiatiques ou même scolaires ?
J’ai évoqué à l’instant la collaboration qui a permis une plus grande insertion des ouvrages des auteurs ivoiriens dans le programme scolaire. C’est dire que nous ne restons pas les bras croisés. Nous organisons des caravanes et incitons tous nos confrères à s’activer au sein des établissements scolaires et en dehors de ceux-ci. C’est chose faite. Nous sommes en mouvement. Mais tout ceci reste perfectible.