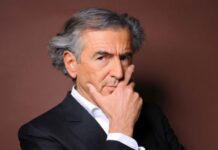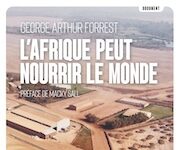C’est un très lourd bilan, humain et matériel, que viennent d’encaisser les hommes de l’opération Mirador à l’intérieur du parc régional du W, à cheval sur les frontières du Bénin, du Burkina Faso et du Niger.
Jeudi 17 avril, les soldats des forces armées béninoises ont subi une double attaque contre leurs positions aux chutes de Koudou et au Point Triple, deux sites du parc tenus par les djihadistes du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) et abandonnés, depuis des années, par les touristes.
Soixante-dix soldats auraient été tués, et leurs corps ramenés à la base septentrionale de Kandi, la ville la plus proche de la frontière du Niger. Dans une vidéo de revendication, un porte-parole du GSIM commente en français les images du butin prélevé sur les militaires morts et bien rangé, comme toujours : «22 PKM et 69 porte munitions, 9 12-7 et 12 porte-munitions, 11 lance-roquettes et 20 roquettes, 78 kalashnikov et 304 chargeurs, 49 caisses de munitions, 5 mortiers et 51 roquettes, 64 grenades, 113 téléphones tactiles, 13 téléphones à boutons, 13 powerbanks, 6 motos, 3 drones et un ordinateur portable.» Il désigne deux gros tas de munitions en vrac «qu’on ne peut pas compter» et poursuit avec 6 motos et 8 véhicules brûlés. Le porte-parole conclut son propos par la promesse que son mouvement combattra jusqu’à la mort pour le retour « à la religion que Dieu nous a dit de pratiquer sur cette terre» et l’affirmation qu’il vengera «les civils [que les autorités] prennent, attrapent et partent enfermer» quelle que soit leur ethnie ou leur couleur de peau.
L’opération Mirador a été lancée en 2021 pour tenter de sécuriser les frontières nord du pays, menacée par les groupes djihadistes sahéliens affiliés aux deux grandes franchises rivales d’Al Qaida et de l’Etat islamique.
La France, partenaire stratégique du Bénin dans la guerre
La revue française Conflits, sous la plume de Pierre d’Herbès, a publié en janvier 2025 un article sur l’effort militaire «ambitieux» du Bénin et de ses partenaires, notamment français. Selon elle, les effectifs sont passés de 7500 hommes en 2022 à 12 300 en 2024 et le budget défense du pays de 60 à 90 milliards dans la même période. La France a fourni en 2023 «des drones (…) 26 véhicules de l’avant blindés et des protections balistiques et d’autres équipements essentiels» et des instructeurs. «La consolidation de l’appui de la France est appréciée, à tel point que Paris est désormais considéré comme un partenaire stratégique», s’enorgueillit la revue dans un article publié, las !, après une première attaque meurtrière au même Point Triple, qui avait déjà fait 35 morts le 8 janvier.
Pour d’Herbès, manifestement très proche des milieux militaires et paramilitaires français, cette embuscade était «la conséquence directe de la dégradation sécuritaire totale dans les pays de l’AES (Mali, Niger, Burkina-Faso) (… où) les groupes armés, terroristes ou non, circulent désormais librement ou presque, au nez et à la barbe des forces de défenses locales et des mercenaires russes», sous l’égide de «juntes confinées dans les capitales (…) qui font subir l’indigence de leur politique à leurs voisins.» Cette rhétorique reflète celle de Paris, pour qui tout est de la faute des Russes et des officiers sahéliens ingrats qui ont demandé à la France de retirer ses forces de la région.
De Barkhane aux coups d’Etat
Au Niger voisin, sur les réseaux sociaux, c’est exactement l’analyse contraire qui fleurit. Pour les autorités, qui gardent la frontière avec le Bénin fermée depuis le coup d’Etat du 26 juillet 2023, la présence des instructeurs et des moyens militaires français dans ce pays est une menace. Niamey accuse régulièrement Paris, sans en fournir de preuves, de comploter avec les groupes terroristes pour déstabiliser les juntes au pouvoir dans les trois pays du Sahel central.
Nul ne peut contester, en revanche, que l’opération Barkhane et ses 5000 hommes n’a, ni au Niger ni au Mali, empêché la progression spatiale et numérique spectaculaire des groupes djihadistes depuis 2013. Cet échec est de mauvais augure pour les pays du Golfe de Guinée, longtemps indifférents aux difficultés de leurs grands voisins du nord et rattrapés par la guerre.
L’organisation ACLED a publié le 25 mars un article sur «les nouvelles lignes de front» de la nouvelle phase d’expansion vers la côte des groupes djihadistes sahéliens (https://acleddata.com/2025/03/27/new-frontlines-jihadist-expansion-is-reshaping-the-benin-niger-and-nigeria-borderlands/). ACLED explique que les régions situées à un nouveau carrefour frontalier, du Niger, du Bénin et du Nigeria, sont désormais ciblées, comme en témoignent les chiffres des incidents en hausse et celui des victimes, qui a doublé. Pour l’auteur de cette étude, «l’investissement du GSIM et de l’Etat islamique au Sahel dans les activités transfrontalières laisse penser que cette région est d’une importance croissante pour l’expansion djihadiste.»
Une expansion continue qui remonte à 2016
L’article raconte l’histoire de l’essor géographique djihadiste sahélien, qu’il fait remonter à 2016, date à laquelle les groupes maliens ont commencé à allonger leur rayon d’opération aux Niger et Burkina Faso voisins. Après avoir atteint, fin 2017 et début 2018, le sud-ouest du Niger et l’est du Burkina Faso, les deux franchises djihadistes d’Al Qaida et de l’Etat islamique ont entrepris de descendre vers les pays côtiers. Cependant, la rivalité militaire entre les deux organisations a stoppé cette avancée à partir de la mi-2019. Le GSIM a finalement affirmé sa supériorité en 2020 dans le centre du Mali et l’essentiel du Burkina Faso, repoussant l’EIS vers la zone dite des trois frontières, le Liptako Gourma. Il a alors fait de l’est du Burkina Faso, en particulier les provinces voisines du parc, sa base arrière pour progresser vers le Bénin et le Togo à partir de 2021 et 2022. Enfin, de 2023 à 2024, les deux organisations ont augmenté la pression sur les régions frontalières entre le Bénin, le Niger et le Nigeria, transformant ces zones en ligne de front volatile.
Cette nouvelle expansion vers le sud, estime l’auteur, «est motivée par la recherche continue de nouvelles opportunités de recrutement pour soutenir la croissance des armées insurgées, aussi bien que par le besoin d’accéder à des ressources à travers de nouvelles routes de contrebande et de trafic illicite essentielles pour leurs opérations. L’expansion dans ces zones reculées et moins sécurisées permet aussi aux deux groupes de créer de nouvelles bases d’opération et d’étendre leurs réseaux logistiques.»
Comme dans d’autres pays, les parcs naturels sont devenus des sanctuaires des groupes armés, leur offrant un couvert végétal et une capacité de mouvement propice au franchissement des frontières, dans des espaces quasiment vides de toute population. C’est à partir du parc transfrontalier du W-Arly-Pendjari que le GSIM, solidement campé à côté de l’ex site touristique des chutes de Koudou, a débuté son expansion vers le Bénin en 2021 et le Togo en 2022, puis qu’il a consolidé sa présence de part et d’autre de la frontière et avancé vers le Nigeria, poursuit l’auteur de l’étude.
Quant à l’Etat islamique, à partir de son bastion stratégique de Menaka au Mali et Tillabéri et Tahoua au Niger, il a intensifié ses activités dans le nord et le centre de la région de Dosso et innové tactiquement par des sabotages du pipeline Bénin-Niger. Après une phase d’approche sans violence, à travers la collecte de la zakat et la gestion de ses besoins logistiques, il a finalement ouvert, à travers la région de Dosso, un couloir d’approvisionnement développé ensuite en zone d’appui. Début 2024, il est passé à l’action militaire contre les forces de sécurité, les civils et les infrastructures. On s’est interrogé sur le rôle joué par un groupe, Lakurawa, installé dans le nord-ouest du Nigeria, dans les actions à la frontière entre le Niger et le Nigeria. Mais pour ACLED, il s’agit d’une émanation de l’Etat islamique au Sahel à partir de ses bases de Dosso, au Niger, et de Sokoto et Kebbi, au Nigeria. L’EIS s’étend désormais aussi vers la frontière Bénin, Niger, Nigeria. A l’issue de trajectoires différentes, les deux organisations convergent donc désormais dans la région de Dosso, au sud-ouest du Niger, au confluent des trois frontières.