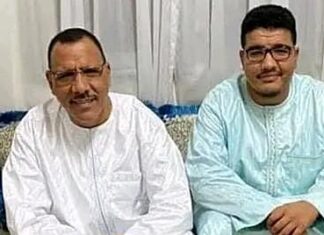Le Front de Libération de l’Azawad (FLA), nouvelle dénomination de la coalition indépendantiste du nord du Mali, a officiellement écrit le 19 septembre au secrétaire général des Nations unies pour demander «la reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple de l’Azawad», qui «continue de subir marginalisation, violences et tentatives d’effacement identitaire.»
Surfant sur les annonces simultanées de reconnaissance de la Palestine à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU, les responsables du mouvement touareg et maure du nord du Mali, poussent les feux d’une offensive politique internationale qui s’est également traduite par une campagne de communication tous azimuts.
La lettre officielle invoque les instruments juridiques universels, onusiens et africains proclamant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (Charte des Nations unies, 1945, déclaration universelle des droits de l’Homme, Résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Résolution 2625 sur les principes du droit international relatifs aux relations amicales, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Acte constitutif de l’Union africaine.)
«Depuis l’indépendance du Mali en 1960, l’Azawad a été livré à des régimes hostiles qui ont instauré une politique d’exclusion et de répression, transformant notre territoire en champ de guerre permanent. Ces violations systématiques – perpétrées parfois avec le soutien de puissances étrangères – constituent une atteinte flagrante aux principes fondateurs des Nations unies et de l’Union africaine», écrit le signataire de la correspondance, Abdoul Karim Ag Matafa, le chargé de l’administration et des bureaux régionaux du FLA.
«Une décolonisation inachevée»
Reprenant l’un des arguments souvent développé par les militants, qui estiment que leur problème remonte à l’indépendance octroyée par la France au Mali à leurs dépens, Ag Matafa affirme que «la situation de l’Azawad (est) une question de décolonisation inachevée relevant de la compétence de l’ONU.» Il demande donc au secrétaire général de «mettre en place une mission spéciale chargée de la protection des populations civiles et de l’examen de la situation des droits humains dans l’Azawad» et d’initier «un processus international permettant au peuple de l’Azawad d’exercer librement son droit à l’autodétermination dans ses frontières historiques d’avant la colonisation française (1893).»
Pour le FLA, la région a été «injustement rattaché(e) au Mali, sans consultation de (sa) population, en violation du principe de libre détermination des peuples consacré par l’article 1 de la Charte des Nations unies (1945) et confirmé par l’article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966).» La responsabilité de la France, l’ancienne puissance coloniale, est mise en cause dans ces événements.
Dans une déclaration publiée quelques jours plus tard, le 23 septembre, le même signataire a salué «le courage de la communauté internationale, en particulier celui des pays européens – à leur tête la France – qui ont reconnu l’État de Palestine lorsqu’ils ont compris qu’Israël menait une politique d’extermination et d’annexion coloniale». Il a également mentionné l’Algérie «qui demeure fidèle à son engagement constant pour la cause palestinienne» et qui est l’un des soutiens – bien qu’ambigu – des Touareg du nord dans leur guerre contre Bamako.
«La cause de l’Azawad est similaire à celle de la Palestine : un peuple privé de son droit à exister, confronté à la violence d’un État oppresseur et à l’indifférence du monde», insiste le FLA dans sa lettre ouverte.
Une crise inextricable
Depuis 1963, plusieurs épisodes de tension et des rébellions se sont succédé dans le nord du Mali, à partir de Kidal et dans toutes les grandes régions qui composent ce que les indépendantistes appellent l’Azawad (pâturage en tamachek), qui s’étire sur presque les deux-tiers du Mali, jusqu’aux frontières de l’Algérie au nord, du Niger à l’est et de la Mauritanie à l’ouest.
Les différents accords de paix conclus ces dernières décennies n’ont pas permis de ramener la paix au Mali, contrairement au Niger voisin, dont les ex-rebelles ont rejoint l’administration et les élites politiques du pays. La situation s’est nettement aggravée avec l’arrivée des nouveaux acteurs djihadistes dans les années 2000, qui ont progressivement marginalisé les combattants touareg. L’échec des accords pour la paix et la réconciliation dits d’Alger, signés en 2015 sous la houlette de l’Algérie, a consacré la reprise du conflit, qui a conduit en décembre à la chute de Kidal et au retour de l’armée malienne, accompagnée de ses supplétifs russes, dans tout le septentrion. De nombreuses exécutions sommaires, destructions de campements et de bétail et meurtres de civils ont été enregistrés depuis lors, dans le cadre de ce qui apparaît comme une volonté, a minima, de terroriser les populations et peut-être même de les faire partir.
Les dernières sorties du FLA s’inscrivent dans un moment délicat pour le mouvement, qui a dû sceller un pacte de non agression avec ses rivaux djihadistes dont les capacités militaires lui sont nettement supérieures. Ses soutiens occidentaux traditionnels restent timides, même si un appui ponctuel de la France et de l’Ukraine a pu être observé, notamment sous la forme d’un appui en formation à l’utilisation de drones artisanaux. Les tensions entre l’Algérie et le Maroc, l’Algérie et l’Alliance des Etats du Sahel (AES), la même AES et ses voisins d’Afrique de l’Ouest, le recul de l’Europe dans la région et le dégagisme anti-français rendent la situation diplomatique et politique de la région inextricable.