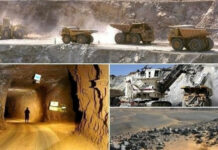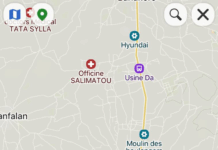Nassera Dutour est la fondatrice de SOS Disparus et préside depuis 1999 le Collectif des familles de disparus en Algérie (CFDA). Son engagement débute en janvier 1997, après la disparition de son fils Amine dans la banlieue d’Alger, qui transforme une douleur intime en un combat collectif. Depuis, elle œuvre sans relâche pour la vérité, la justice et la mémoire des victimes de disparitions forcées de la « décennie noire ». Le CFDA a documenté plus de 5 400 cas, accompagne juridiquement les familles et porte leur voix devant les instances nationales et internationales.
Le 30 juillet 2025, Nassera Dutour a été refoulée à son arrivée à l’aéroport d’Alger. Dans cet entretien, elle revient sur son parcours, son combat, et sa vision d’une véritable réconciliation: « On peut refouler des humains, mais pas la vérité »
Une douleur devenue combat
- Comment la disparition de votre fils a transformé votre vie et quel rôle joue la mémoire dans votre combat ?
La disparition de mon fils Amine en janvier 1997, dans la banlieue d’Alger, a bouleversé mon existence. J’ai refusé de céder au silence imposé par les autorités et, avec ma mère, nous avons sillonné le pays pour convaincre d’autres familles de sortir de l’isolement. C’est ainsi qu’est né SOS Disparus, puis en 1999 le Collectif des familles de disparus en Algérie (CFDA). Ce parcours de militante repose sur une conviction : refuser l’oubli et l’impunité. La mémoire est au cœur de notre action, car recueillir les témoignages et préserver les récits, c’est résister à l’effacement et poser les bases d’une société plus juste. - Quelles sont aujourd’hui les actions de SOS Disparus et du CFDA en Algérie ?
Depuis 1998, nous organisons chaque mercredi un rassemblement à Alger qui, au départ, réunissait des centaines de proches de disparus. Aujourd’hui, seules quelques mères continuent d’y participer, mais cette présence hebdomadaire demeure un acte de résistance. Nous avons également ouvert un bureau à Alger pour offrir une aide juridique et administrative : constitution de dossiers, dépôt de plaintes, accompagnement des familles. Plus de 5 400 cas individuels ont été recensés. Enfin, nous menons un plaidoyer au niveau national et international, auprès d’institutions comme l’ONU ou le Parlement européen, et organisons régulièrement des campagnes de sensibilisation et des actions mémorielles. - Quels obstacles rencontrez-vous face aux autorités et à l’opinion publique ?
Le premier obstacle est politique : l’État refuse de reconnaître les disparitions forcées comme un crime d’État et continue de promouvoir une politique d’amnistie et d’oubli à travers la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Les familles subissent intimidations, refus d’enregistrement de plaintes et blocage d’accès aux archives. Du côté de l’opinion publique, la peur, l’usure du temps et parfois l’indifférence rendent notre combat plus difficile. Malgré cela, le CFDA continue de se battre pour la vérité et la justice, car sans elles, aucune réconciliation n’est possible.
Une expulsion symbolique
- Que s’est-il passé lors de votre refoulement à Alger et quelles explications vous ont été données ?
Le 30 juillet 2025, à mon arrivée à Alger, j’ai été retenue plusieurs heures par la police aux frontières. Comme à chaque fois, des questions m’ont été posées sur mon activité associative, mais contrairement aux autres fois, on m’a finalement conduite de force à l’embarquement d’un vol pour Paris. Ce n’est qu’une fois installée dans l’avion qu’on m’a remis mon passeport accompagné d’un procès-verbal de refoulement. Aucune explication officielle ne m’a été donnée : on s’est contenté de phrases vagues comme « vous êtes membre d’une ONG » ou « nous appliquons ce que dit l’ordinateur ». - Que signifie pour vous cette interdiction d’accès et quel message envoient les autorités aux défenseurs des droits humains ?
Être interdite d’entrer dans mon propre pays est une violence profonde et une humiliation. L’Algérie est celle de mes racines, de ma famille, de mes luttes : on m’arrache un droit fondamental. Ce refoulement n’est pas seulement administratif, il est symbolique. Il signifie que ma parole dérange et que ma présence est jugée indésirable. À travers moi, les autorités adressent un avertissement à tous les défenseurs des droits humains : quiconque ose dénoncer l’impunité peut être réduit au silence. Mais c’est aussi un aveu de faiblesse : on peut refouler une personne, pas la vérité.
La justice confisquée
- Ce refoulement est-il conforme au droit, et quelles démarches juridiques avez-vous entreprises ?
Cette décision est illégale. La Constitution algérienne garantit à tout citoyen le droit d’entrer dans son pays, et l’article 12.4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule qu’« aucune personne ne peut être arbitrairement privée du droit d’entrer dans son propre pays ». Le refoulement dont j’ai été victime, sans motif formel ni recours possible sur place, viole ces principes. C’est pourquoi nous avons saisi la justice algérienne pour en demander l’annulation, et nous avons alerté les institutions internationales, avec le soutien de la FIDH et de l’OMCT. - Comment analysez-vous la position des autorités algériennes vis-à-vis de la mémoire des disparus ?
La position des autorités se résume au déni et à l’effacement. L’État impose une lecture unique des années 1990 à travers la Charte de réconciliation nationale, qui interdit toute poursuite judiciaire et criminalise même les demandes de vérité. Les associations comme la nôtre sont considérées comme dérangeantes et subissent des entraves constantes. Cette politique ne mène ni à la paix durable ni à une véritable réconciliation. Car on ne peut pas tourner la page sans l’avoir lue.
Regards au-delà des frontières
- Quel rôle la communauté internationale peut-elle jouer dans ce combat ?
La communauté internationale a un rôle crucial, car en Algérie, toutes les voies de recours internes sont bloquées. Les ONG et les institutions internationales apportent une légitimité et une protection aux familles, relaient nos témoignages et interpellent les autorités. Leur soutien permet de maintenir la pression et d’empêcher que la question des disparus ne soit enterrée par le silence officiel. - Comment maintenir la mobilisation des familles malgré le silence officiel, et quel message adressez-vous aux autorités et aux proches de disparus ?
La mobilisation tient à la détermination des familles et à leur solidarité. Même si nous sommes aujourd’hui moins nombreuses qu’à nos débuts, chaque rassemblement hebdomadaire, chaque photo brandie est un acte de résistance. Aux autorités, je rappelle que l’avenir du pays ne peut pas se construire sur l’effacement du passé. Aux familles, je dis de garder espoir : notre combat est juste et légitime, et tant que nous continuerons à témoigner, nos disparus ne seront pas oubliés.
Pour une vraie réconciliation
- Quelles conditions sont nécessaires pour une véritable réconciliation et quels mécanismes de justice transitionnelle seraient adaptés à l’Algérie ?
La première condition, c’est la vérité. Sans reconnaissance des faits, aucune justice ni réparation n’est possible. Pour l’Algérie, il faudrait mettre en place une commission vérité réellement indépendante, dotée de moyens concrets et composée de personnalités crédibles issues de la société civile. Elle aurait pour mission de documenter les disparitions, de nommer les responsables et de reconnaître publiquement les crimes commis. Ensuite, des tribunaux spécialisés pourraient juger les responsables identifiés, avec toutes les garanties d’un procès équitable. Les réparations devraient être complètes : matérielles, symboliques et psychologiques. Enfin, des lieux de mémoire — musées, stèles, journées commémoratives — doivent être créés pour inscrire ces événements dans la conscience collective et empêcher leur répétition. - Quel rôle peuvent jouer les familles, la société civile et la jeune génération dans ce processus ?
Les familles et la société civile doivent être au cœur de toute démarche de justice transitionnelle, car ce sont elles qui ont gardé vivante la mémoire et documenté les disparitions quand tout le monde se taisait. Leur expérience, leur souffrance et leur expertise sont indispensables. Quant à la jeunesse, même si elle n’a pas connu directement les années 1990, elle en porte encore les séquelles. Beaucoup refusent le silence, posent des questions et réclament la vérité. Elle a un rôle fondamental à jouer pour briser le mur de l’oubli, réhabiliter les luttes effacées et inscrire la mémoire comme un acte de dignité et de résistance.