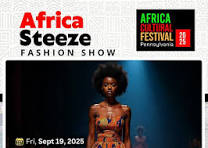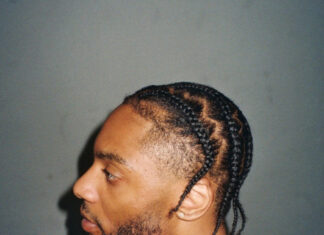L’accord migratoire signé en 2023 entre Rome et Tirana, autorise le transfert de demandeurs d’asile vers des centres de détention en Albanie. De vives critiques ont été émises ces derniers mois. Le projet est défendu par des responsables politiques et des juristes, mais leurs arguments sont-ils juridiquement fondés ? En partenariat avec le projet RightWatch, Annalisa Camilli examine le bien-fondé des allégations du gouvernement italien qui estime que la législation italienne prévaut sur la législation européenne.
Sous l’égide de Giorgia Meloni, le gouvernement italien affirme que les juges ne peuvent pas ignorer le droit national, même s’il entre en conflit avec la législation européenne. Cette prise de position s’inscrit dans le climat de tension qui règne entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire autour de l’adoption d’un décret désignant les “pays sûrs” pour les demandeurs d’asile. Pour ses détracteurs, le texte viole le droit européen. Certains experts, comme Gianfranco Schiavone et Fulvio Vassallo Paleologo réfutent l’allégation de l’exécutif en invoquant la suprématie du droit européen sur le droit national en cas de conflit, telle qu’établie par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Un article initié par VOXEUROP qui a souhaité le diffuser sur Mondafrique. Nous les remercions
Des décisions récentes de tribunaux italiens, dont une demande de renvoi devant cette dernière, mettent en cause la compatibilité du décret de Meloni avec les directives de l’UE, notamment la directive 2013/32, qui établit les critères déterminant quels sont les pays sûrs.a conférence de presse s’était tenue tard dans la soirée, à l’issue d’une réunion qui s’était éternisée au palais Chigi, siège de l’exécutif italien. Les médias s’étaient rassemblés pour une occasion spéciale : le gouvernement de Giorgia Meloni venait d’adopter un nouveau décret énumérant les pays considérés comme sûrs en vue d’appliquer aux migrants une procédure d’asile accélérée. Cette initiative faisait suite à un arrêt du tribunal de Rome du 18 octobre, qui avait annulé la détention de douze demandeurs d’asile. Après avoir été transférés de force vers de nouveaux centres de détention en Albanie, ces derniers avaient donc finalement été renvoyés dans le pays transalpin.
L’affaire a déclenché un véritable bras de fer institutionnel entre les pouvoirs exécutif et judiciaire, menaçant même de réduire à néant le protocole conclu entre Rome et Tirana en novembre 2023. Cet accord prévoyait la construction de deux centres de détention, gérés par l’Italie, dans les villes albanaises de Shëngjin et Gjadër.Après les organisations humanitaires, les juges sont à leur tour sous le feu des critiques. “Je ne pense pas qu’il revienne aux juges de déterminer quels pays sont sûrs, mais au gouvernement”, a par exemple affirmé Meloni le 18 octobre, marquant ainsi son intention de continuer à externaliser l’examen des demandes d’asile.
Lors de la conférence de presse du 21 octobre, le ministre de la Justice Carlo Nordio, ancien magistrat et membre de Frères d’Italie (FdI, extrême droite), le parti dirigé par Giorgia Meloni, a accusé les juges de ne pas avoir “lu ni compris” l’orientation de la Cour de justice de l’Union européenne sur la notion de “pays sûr”, ajoutant que les juges ne pourraient pas ignorer le nouveau décret, ce qui a été très critiqué par les experts.
“Un juge ne peut pas ignorer la législation nationale”, a déclaré le ministre à la presse. Mais tout le monde n’est pas de cet avis, le juriste Fulvio Vassallo Paleologo l’accusant même de “mentir en connaissance de cause”.
Selon Chiara Favilli, professeure en droit européen à l’université de Florence, “il faut respecter le droit européen. C’est notamment en vertu de ce dernier qu’une liste de pays sûrs a pu être établie, de sorte que l’on ne puisse pas donner au concept de ‘pays sûr’ le sens que l’on veut”.kPar ailleurs, le juriste Gianfranco Schiavone, président du Consortium italien de solidarité (Consorzio italiano di solidarietà, ICS) et membre de l’ASGI (Association d’études juridiques sur l’immigration), affirme que “le droit européen prévaut sur le droit national ; en cas de conflit, les dispositions nationales doivent être écartées par les juges”. Il estime dès lors que le nouveau décret relatif aux pays sûrs entrerait en conflit avec le droit européen, particulièrement avec la directive 2013/32 (ou “directive procédure”), tel que confirmé par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 octobre 2024. En effet, cette dernière a considéré qu’un pays ne pouvait être considéré comme sûr que s’il l’était pour tous les individus (y compris les minorités) sur l’ensemble de son territoire.
La position de ces experts a été confortée par l’arrêt du tribunal de Rome du 11 novembre. Ce dernier, en effet, a saisi la CJUE afin qu’elle statue sur la décision de transférer vers l’Albanie sept demandeurs d’asile – faisant partie du deuxième groupe de migrants à y être envoyé – qui avaient été placés en détention après avoir été secourus en Méditerranée. D’après les juges italiens, le nouveau décret du gouvernement sur les “pays sûrs” entre en conflit avec le droit communautaire.
Dans son communiqué de presse daté du 11 novembre, le tribunal de Rome déclare que “les juges ont estimé qu’il était nécessaire d’adresser un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, en lui soumettant quatre questions similaires à celles formulées récemment par deux collèges de la même section […]. Cette demande de décision préjudicielle est l’outil le plus approprié afin de vérifier la compatibilité de différents aspects des dispositions du décret-loi avec le droit supranational”.
La décision de Giorgia Meloni d’élaborer un nouveau décret et de procéder aux retours forcés vers l’Albanie en dépit de l’avis contraire des tribunaux évoque un cas similaire au Royaume-Uni : alors que la Cour suprême de ce pays avait rejeté l’accord conclu entre Londres et Kigali pour externaliser les demandes d’asile au Rwanda, l’ancien Premier ministre conservateur Rishi Sunak avait aussi tenté de faire passer une nouvelle loi pour contourner cette décision. D’autres tribunaux italiens (de Catane, Palerme, Bologne et Rome) ont également demandé à la CJUE, sise à Luxembourg, de rendre un avis sur le sujet.
Dans sa demande adressée à la Cour de Justice européenne, le tribunal de Bologne s’est osé à une comparaison avec l’Allemagne nazie, que Meloni a qualifiée de “propagande” dans une émission télévisée.
“On pourrait dire, paradoxalement, que l’Allemagne nazie était un pays extrêmement sûr pour la grande majorité de la population allemande”, a argumenté le tribunal dans sa requête. “À l’exception des juifs, des homosexuels, des opposants politiques, des personnes d’origine rom et d’autres groupes minoritaires, plus de 60 millions d’Allemands jouissaient d’un niveau enviable de sécurité. On peut dire qu’il en allait de même en Italie sous le régime fasciste. Si un pays était considéré sûr dès que la sécurité de la majorité de sa population était garantie, la notion juridique de ‘pays sûr’ s’appliquerait à la quasi-totalité des pays du monde et serait dès lors vide de toute cohérence”.
Le 25 octobre, le tribunal de Bologne a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne d’émettre un avis et de clarifier sa position à l’égard du nouveau décret-loi adopté par le gouvernement de Giorgia Meloni. La requête se fondait sur le cas d’un réfugié bangladais dont la demande d’asile avait été rejetée, au motif que son pays d’origine était considéré sûr. À cet égard, le tribunal a demandé à la CJUE de se prononcer sur “une série de conflits d’interprétation qui ont surgi dans le système juridique italien et, plus généralement, sur les règles régissant les rapports entre le droit européen et le droit national”.
Suite à cela, le juge à l’origine du renvoi préjudiciel a fait l’objet de diverses menaces et attaques sur les réseaux sociaux, notamment sur des aspects touchant sa vie personnelle, comme son homosexualité. Le même sort a frappé Silvia Albano, l’un des six juges du tribunal de Rome, qui avait annulé le placement en détention de migrants en Albanie. Elle est désormais sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort, entre autres. Les procureurs de Palerme ont également été placés sous protection après avoir requis une peine d’emprisonnement de six ans contre l’actuel vice-président du Conseil des ministres et ministre des Transports, Matteo Salvini. Ce dernier est accusé d’enlèvement et de refus d’exercer ses fonctions publiques. En août 2019, il avait immobilisé pendant 19 jours un navire humanitaire avec plus de cent migrants à son bord le long des côtes de Lampedusa, alors qu’il était ministre de l’Intérieur.
Salvini a finalement été relaxé le 20 décembre 2024, mais les tensions ne font que s’amplifier entre les pouvoirs exécutif et judiciaire. “Il existe une intolérance manifeste à l’égard d’un pouvoir qui ne se conforme pas aux directives du gouvernement”, dénonce Giuseppe Santalucia, président de l’Association nationale des magistrats. Lors d’une réunion extraordinaire à Bologne le 2 novembre, il a ajouté que “les magistrats [n’étaient] pas le bras exécutif du gouvernement”. Le juriste Vassallo Paleologo a estimé sur X (anciennement Twitter ; son compte a été suspendu depuis) que “le gouvernement italien [voulait] faire pression sur le pouvoir judiciaire avant le prononcé du verdict dans le procès de Salvini à Palerme. Il [aspirait] également à une réforme visant à séparer les carrières des magistrats, [lui permettant] d’accroître son emprise sur les procureurs”.
European Data Journalism Network | Display Europe | Pulse network| SPIIL | Covering Climate Now | Association des Journalistes Européens