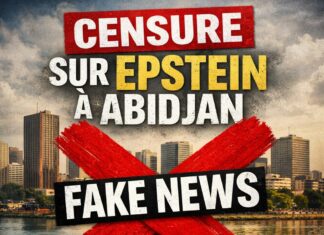L’armée israélienne a annoncé avoir mené mardi des frappes contre des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas, après que des explosions ont été entendues à Doha, la capitale du Qatar. Le bilan des frappes reste incertain en raison d’informations contradictoires. Les autorités du Qatar ont confirmé des frappes contre des domiciles de responsables du Hamas et condamné une attaque «lâche».
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti que les «dirigeants terroristes» ne seraient en sécurité nulle part, après qu’Israël ait ciblé la haute direction du Hamas lors de frappes aériennes sur la capitale qatarie, Doha.
«Les jours où les dirigeants terroristes pouvaient bénéficier d’une immunité partout sont révolus», a déclaré Netanyahu lors d’un événement à l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, ajoutant qu’il avait ordonné l’opération «pour régler leurs comptes avec les meurtriers et garantir la sécurité future des citoyens israéliens».
En frappant le cœur diplomatique de Doha, Israël change les règles : la guerre ne connaît plus de sanctuaire. Ce précédent spectaculaire rappelle que, dans la région, l’assassinat ciblé marque souvent le seuil d’un conflit terrestre généralisé.

L’onde de choc qui a traversé Doha le 9 septembre 2025 dépasse de loin la seule capitale qatarie. C’est tout l’ordre régional qui vacille sous la violence d’une frappe qui, en visant les responsables du Hamas réunis dans un appartement sécurisé, inaugure une nouvelle ère. Désormais, la guerre au Moyen-Orient ne s’embarrasse plus ni des frontières ni des tabous diplomatiques. On n’est plus dans la simple riposte dans la bande de Gaza, ni dans les frappes « préventives » en Syrie ou au Liban. Pour la première fois, une capitale du Golfe, alliée majeure des États-Unis, médiatrice de toutes les négociations régionales, est directement frappée. Au cœur d’un quartier résidentiel de Doha, les missiles israéliens n’ont pas seulement visé quelques dirigeants : ils ont pulvérisé l’illusion d’un sanctuaire, même diplomatique, dans une région qui ne tolère plus aucun espace neutre.
D’après les premiers éléments, « quatre à huit responsables du Hamas se trouvaient sur le lieu visé », mais pour l’instant, aucune déclaration officielle ne permet d’établir le bilan exact, ni l’identité précise des victimes. Comme toujours, après une frappe d’une telle intensité, Israël attend avant d’annoncer les noms des personnes tuées et le détail de la réussite de son opération. Ce n’est jamais immédiat : pour l’heure, on ne sait pas exactement qui s’en est tiré ou pas. Mais l’effet de sidération, lui, est immédiat et assumé.
Le précédent qatari, bascule d’une région sans tabou
Ce raid à Doha ne relève ni du geste improvisé ni de l’accident. Depuis un an, Israël a modifié sa doctrine de sécurité et d’intervention. L’assassinat d’Hassan Nasrallah en septembre 2024, avec une grande partie de la direction du Hezbollah à Beyrouth, avait déjà marqué une rupture, affichant la volonté israélienne de décapiter ses ennemis même au cœur de leurs propres bastions. L’Iran, lui aussi, a subi des frappes répétées contre ses cadres militaires et nucléaires, une séquence qui a préparé le terrain à la guerre totale qui allait suivre. Chaque fois, l’histoire récente l’atteste : l’assassinat ciblé de chefs hostiles n’est jamais un épilogue, mais bien le prélude à une extension brutale du conflit. Ce qui s’est joué à Doha s’inscrit dans cette logique de répétition — une logique où la décapitation stratégique n’est qu’un prélude à la guerre ouverte, parfois même à la tentation d’une « table rase ».
Si la frappe de Doha crée un tel séisme, c’est aussi parce qu’elle expose le Qatar à une violence dont il se croyait préservé. Habitué à jouer le rôle de médiateur entre Hamas et Israël, entre talibans et Américains, entre Iran et Occidentaux, l’émirat cultivait sa position d’interface indispensable, espérant se protéger derrière sa diplomatie active. Mais ce calcul s’est effondré en un éclair : ni la présence de la plus grande base militaire américaine de la région, ni les efforts diplomatiques frénétiques de Doha n’ont suffi à dissuader Israël. Face à ce choc, la réaction officielle du Qatar trahit une impuissance grandissante. L’émirat dénonce une violation de sa souveraineté et laisse éclater une colère froide, mais, dans les faits, il se montre incapable de riposter d’aucune manière.
L’histoire aurait sans doute été toute autre si la Turquie avait été visée par une frappe similaire. Ankara, membre de l’OTAN et puissance militaire régionale, aurait probablement opté pour une riposte immédiate, que ce soit sur le plan militaire ou hybride. Ce contraste éclaire le choix du Qatar comme terrain d’expérimentation : loin d’être anodin, il souligne l’incapacité de la région à fixer de véritables lignes rouges et, peut-être, un consentement implicite à ce nouveau jeu de puissance.
La frappe israélienne interroge la notion même de sanctuaire. Désormais, le calcul de sécurité régionale s’inverse. La diplomatie, censée garantir la protection des médiateurs, s’effondre devant une stratégie israélienne qui assume le passage à une guerre totale, déterritorialisée, sans limite assignable. La doctrine qui prévaut n’est plus celle du compromis, mais celle du choc, de la sidération et de la paralysie de l’adversaire.
Alliances malmenées, diplomatie piégée
Le séisme diplomatique déclenché par cette attaque s’est propagé à une vitesse inédite. L’ONU, l’Union européenne, la Ligue arabe, toutes les capitales du Golfe ont condamné la frappe, mais aucune n’a annoncé la moindre mesure concrète de rétorsion. Le Qatar, pour sa part, affirme n’avoir été prévenu d’aucune manière avant la frappe, une version en totale contradiction avec ce qu’affirment les autorités israéliennes et américaines. Israël dit avoir prévenu Washington, qui assure de son côté avoir alerté Doha « quelques minutes » avant l’attaque. Côté qatari, le démenti est formel, la confusion est totale. Ce brouillage de la communication expose, une fois de plus, la crise de confiance profonde qui mine les alliances régionales.
Comme souvent après de telles frappes, Israël attend avant d’annoncer officiellement les résultats de l’opération. Pour l’instant, aucune annonce sur le sort précis des cibles. Ce flou maintient la tension et amplifie la portée de l’opération, tout en laissant ouvertes toutes les interprétations.
Outre-Atlantique, la gêne politique est manifeste. Donald Trump, en campagne, s’est dit « embarrassé » vis-à-vis du Qatar, tout en refusant de condamner l’action israélienne et en précisant publiquement qu’il s’agissait « de la décision de Netanyahou seul, pas la mienne ». À la Maison Blanche, le discours est très différent : on applaudit l’élimination de cadres du Hamas, accusés d’utiliser Gaza comme bouclier humain tout en vivant dans le confort de l’étranger. Cette dualité, entre malaise diplomatique affiché et satisfaction stratégique, révèle une contradiction désormais impossible à cacher. Comment garantir la stabilité régionale tout en assumant l’internationalisation de la confrontation ?
Les capitales européennes, Berlin, Paris et d’autres, font entendre leur inquiétude. La neutralisation du rôle de médiateur du Qatar consacre la fin d’une diplomatie régionale déjà en grande difficulté. Les pourparlers de cessez-le-feu sont désormais menacés, le canal humanitaire se trouve fragilisé, la confiance est rompue. Israël, en s’en prenant directement au cœur du mécanisme diplomatique régional, coupe les derniers liens qui reliaient encore le Hamas, l’État hébreu et les États-Unis. Doha, jusque-là relais incontournable pour la libération des otages, la trêve humanitaire ou les discussions sur le cessez-le-feu, se retrouve marginalisé. Le Hamas crie à la trahison, le Qatar menace de se retirer du processus, tandis que le reste du monde arabe se résigne à l’emprise de la force brute sur toute forme de négociation.
Le choix du Qatar comme cible envoie aussi un message aux autres États du Golfe. Ils comprennent qu’ils pourraient, eux aussi, devenir des acteurs ou des cibles d’une nouvelle ère de guerre ouverte, où la souveraineté ne constitue plus qu’une variable d’ajustement dans les rapports de force régionaux. L’incertitude s’étend, la crainte grandit, l’équilibre déjà fragile de la région semble trembler un peu plus à chaque étape.
Guerre sans frontières, effondrement des sanctuaires
La frappe de Doha s’inscrit dans une stratégie assumée par Israël : plus aucun refuge ne sera toléré, plus aucune zone ne doit être considérée comme hors de portée. La logique de la « doctrine Dahiya », consistant à frapper même dans les sanctuaires supposés intouchables, se voit transposée au cœur du Golfe. Mais cette extension du champ d’action israélien suscite le vertige. Israël peut-il multiplier les frappes, repousser sans cesse les limites, sans risquer un isolement stratégique, ou même un embrasement régional ? Désormais, aucun dirigeant du Hamas ne se sent à l’abri, aucune capitale n’est certaine d’être protégée. La rue arabe gronde, la colère monte, mais la riposte concrète tarde à venir. La sidération sert de stratégie de dissuasion, mais aussi de provocation.
Pour de nombreux analystes, la question centrale n’est plus taboue : cette opération hors normes annonce-t-elle le lancement d’une campagne d’annihilation totale contre Gaza ? L’histoire récente semble accréditer cette hypothèse. À Beyrouth, à Téhéran, les assassinats ciblés n’ont jamais été isolés. Presque toujours, ils précèdent une intervention terrestre ou un déluge de feu. La frappe de Doha ressemble, à bien des égards, à la séquence de septembre 2024, lorsque la mort de Nasrallah et de la direction du Hezbollah a ouvert la voie à la vaste offensive israélienne au Liban Sud.
Aujourd’hui, le Hamas voit sa direction traquée jusqu’à Doha. Plus aucun chef n’est à l’abri, plus aucune capitale n’est hors d’atteinte. Les signaux convergent : intensification des frappes, rhétorique intransigeante, marginalisation de toute négociation, volonté affichée d’en finir avec Gaza. Ce précédent qatari laisse entrevoir la possibilité d’un conflit sans retour, d’une internationalisation du combat, d’une guerre où la souveraineté s’efface devant la brutalité.
En frappant au Qatar, Israël franchit un seuil inédit, installe une nouvelle norme, celle de la « guerre ouverte ». Ce qui n’était qu’exception devient méthode. Pour la région, le choc de Doha sera durable. Il signifie que la loi du plus fort supplante le droit, que la sécurité ne se garantit plus par la négociation mais par la capacité de frappe, et que plus personne, désormais, n’est à l’abri. La question qui demeure, brutale dans sa simplicité : qui sera le prochain ? Le Moyen-Orient, déjà ravagé par la défiance, entre dans une ère de guerres sans frontières, où chaque capitale, chaque médiateur, chaque acteur régional peut devenir une cible. Le précédent qatari ne sera sans doute pas le dernier. Toute l’architecture, déjà vacillante, de la sécurité au Moyen-Orient en ressort plus menacée que jamais.
ENCADRÉ
Une vague de protestations
L’attaque israélienne survenue mardi à Doha, qui a visé un bâtiment où se trouvaient des représentants du Hamas, a provoqué une vague de condamnations régionales et internationales.
Arabie saoudite
Le royaume a dénoncé «une agression brutale» et «une violation flagrante de la souveraineté» du Qatar. Le prince héritier Mohammed ben Salmane a assuré à l’émir du Qatar le «plein soutien» de Riyad, affirmant mobiliser toutes les capacités du royaume pour appuyer Doha.
États-Unis
Un responsable de la Maison-Blanche a confirmé qu’Israël avait informé Washington avant l’opération. Dans le même temps, l’ambassade américaine au Qatar a donné l’ordre aux citoyens américains de rester chez eux après avoir reçu des informations faisant état de frappes de missiles dans la capitale qatarienne.
ONU
Le secrétaire général António Guterres a condamné une «violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Qatar», saluant le rôle positif de Doha dans les efforts de cessez-le-feu. «Tous les acteurs doivent œuvrer à un arrêt permanent des hostilités, pas à sa destruction», a-t-il déclaré.
Iran
Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné les frappes israéliennes, les qualifiant de «violation flagrante de toutes les règles et réglementations internationales», et a qualifié cette attaque d’«extrêmement dangereuse et criminelle» et de violation de la souveraineté du Qatar.
Turquie
Le ministère des Affaires étrangères a dénoncé l’attaque contre la délégation du Hamas, affirmant qu’elle démontre qu’Israël a adopté «la politique expansionniste dans la région et le terrorisme» comme politique d’État. Le ciblage d’une délégation en pleine négociation de cessez-le-feu montre selon Ankara que le pays ne cherche pas la paix, mais à poursuivre le conflit.
Oman
Mascate a exprimé sa «solidarité totale» avec le Qatar, dénonçant les «crimes» et la «trahison» d’Israël, qui constituent selon lui «une escalade dangereuse menaçant la stabilité régionale».
Émirats arabes unis
Abou Dhabi a condamné une attaque «lâche et flagrante», appelant au respect du droit international.
Koweït
Le gouvernement a dénoncé une «agression brutale» contre l’État «frère» du Qatar.
Jordanie
Le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi a fustigé une attaque «lâche » et une «violation manifeste du droit international».
Pape Léon XIV
Le pape Léon a exprimé son inquiétude quant aux conséquences des frappes israéliennes sur le Qatar.
«Il y a actuellement des nouvelles très graves : l’attaque israélienne contre certains dirigeants du Hamas au Qatar. La situation dans son ensemble est très grave», a déclaré Léon devant la résidence d’été du pape à Castel Gandolfo, selon l’agence de presse ANSA.