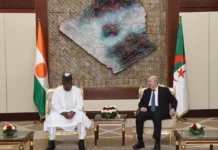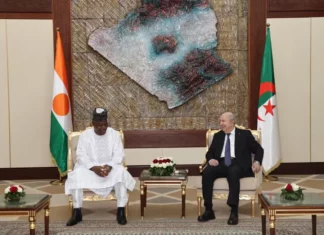En dépit des apparences, Kaïs Saïed n’a pas ramené la Tunisie au temps de Ben Ali. Les différences sont substantielles entre les deux régimes. Mais derrière elles, les structures à l’origine de la dérive autoritaire et de l’injustice sociale demeurent. C’est là que se joue la possibilité de renouer avec une trajectoire démocratique.
Par Selim Jaziri
Deux présidents, Ben Ali et Kaïs Saïed, réunis en un seul visage, celui de la contre-révolution. C’est la banderole choc, avec pour slogan «Nous ne refermerons pas la parenthèse de la révolution », sous laquelle quelques centaines de manifestants ont défilé à Tunis à l’occasion du 15ème anniversaire de la chute de Ben Ali, le 14 janvier. L’idée revient souvent en effet que Kaïs Saïed aurait ramené la Tunisie au temps de la dictature d’avant la révolution.
Les partisans du Parti social destourien, héritiers assumés du régime de Ben Ali dont ils défendent toujours le bilan et qui tiennent la révolution pour le fruit d’un complot américain, ne partagent pas cet avis. Leur cheffe de file, Abir Moussi, a été condamnée en décembre dernier à douze ans de prison et c’est au nom de la démocratie qu’ils s’opposent aujourd’hui à Kaïs Saïed.
Naturellement, le parallèle a déplu également aux partisans du Président actuel qui prétend au contraire remettre la révolution sur les rails dont elle aurait dévié depuis 2011. Bien des aspects suggèrent pourtant un retour en arrière : l’ouverture du journal de 20 heures de la chaîne nationale par les faits et dires du Président, les procès d’opposants et l’instrumentalisation de la Justice par le pouvoir, la peur de s’exprimer en public, les restrictions de la vie associative… Mais si le parallèle a le mérite d’alerter sur la régression des libertés depuis 2021, il est simpliste de réduire le régime de Kaïs Saïed à une simple restauration. L’enjeu d’une bonne description du système politique n’est pas simplement théorique. Espérer la répétition du scénario de 2011 et parier sur une chute de Kaïs Saïed pour revenir à la démocratie, comme celle de Ben Ali avait ouvert la voie à la transition, est une illusion. Les différences sont substantielles et les tâches d’un renouveau de la révolution démocratique dépassent de loin le changement d’un dirigeant.
Le discours de légitimation
Ben Ali s’inscrivait dans la suite de la conception de Habib Bourguiba de l’État comme instituteur du peuple et de la nation à composer à partir « d’une poussière d’individus, d’un magma de tribus, tous courbés sous le joug de la résignation et du fatalisme », selon la formule de Bourguiba. Une élite sûre de son droit de gérer l’État se chargeait de faire le bien d’un peuple immature, quitte à mater ses impulsions anarchiques. Les destouriens se réclamaient de la philosophie des Lumières pour justifier la transformation par le haut de la société. La valeur que prétendait ajouter Ben Ali au bourguibisme était d’instituer progressivement une démocratie calquée sur la conception libérale européenne. La répression des islamistes justifiait, aux yeux des partenaires européens notamment, les entorses « temporaires » aux libertés.
Kaïs Saïed porte, lui, des conceptions diamétralement opposées. Son slogan de campagne était « le Peuple veut », inspiré directement de celui de la révolution. Tout son dispositif est censé s’appuyer sur le principe d’une volonté populaire immanente qui se serait exprimée dans les premiers mouvements de la révolution et dont il serait le porte-parole. En son nom, il s’est assigné la mission de restituer au peuple le pouvoir accaparé après la révolution par des fonctionnaires à la solde d’intérêts privés, des élites intellectuelles vendues aux influences étrangères et une classe politique qui s’est substituée à lui par le biais du gouvernement représentatif. La construction de « démocratie par la base » qu’il a instituée par le haut est censée rapprocher le peuple du pouvoir.
Pour restaurer la souveraineté, l’État doit retrouver la vocation « sociale » qu’il a perdue depuis les années 1970, c’est-à-dire redevenir pourvoyeur d’emplois, d’éducation et de santé, mais il doit être purifié de ses éléments corrompus et non-patriotiques. Là encore, Kaïs Saïed estime être le garant de ce redressement de l’État. De sorte qu’il incarne à la fois le peuple et l’État, et toute divergence est suspecte de trahison.
Jusqu’à présent, le ressentiment populaire à l’encontre des bénéficiaires de la transition démocratique et des carences de l’État lui a offert, au moins par défaut, un relatif soutien intérieur. Lors de la présidentielle de 2024, Kaïs Saïed a obtenu quasiment autant de voix qu’en 2019 (2,4 millions contre 2,7), même si la composition de son électorat a changé, désormais plus âgé et plus rural qu’en 2019. Mais la dynamique s’épuise et l’absence politique du « peuple » est à la mesure de son omniprésence dans la rhétorique saiedienne. La défiance populaire accumulée à l’égard de la classe politique n’offre pas davantage de prise à l’opposition démocratique.
Géopolitique du régime
Ces deux discours de légitimité induisent deux bases géopolitiques différentes. Sur ce registre aussi, Ben Ali s’est inscrit dans la continuité de Habib Bourguiba qui a toujours maintenu de bonnes relations avec la France et les États-Unis et tenait le nationalisme arabe pour une lubie régressive. Le régime de Ben Ali tirait une part de sa légitimité de sa reconnaissance par les pays européens et les institutions financières internationales. L’adhésion de la Tunisie au partenariat euro-méditerranéen de Barcelone en 1995 traduisait son adhésion, au moins formelle, à l’idée directrice promue par l’Union européenne d’une démocratisation progressive sous l’effet de la libéralisation économique. Dans les faits, le partenariat bénéficiait aux protégés du Président et permettait au régime de perdurer en donnant un minimum de gages sur ses intentions démocratiques.
Kaïs Saïed fonde au contraire sa légitimité interne sur sa capacité à s’affranchir de la tutelle occidentale, tant en termes de modèle politique que de dépendance financière. Après avoir bénéficié, lors de son coup de force de juillet 2021, du soutien de l’Égypte, des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite qui voyaient en lui le moyen d’écarter Ennahdha du pouvoir, il a revendiqué une affiliation avec ce qu’il reste du « Front du refus » anti-occidental, de Damas à Alger, et il s’est engagé dans un renforcement des relations avec l’Iran.
En contrepartie de l’appui financier et énergétique algérien, Kaïs Saïed a accueilli le chef du Front Polisario, Ibrahim Ghali, à l’occasion de la tenue du Forum économique Japon-Afrique en août 2022, une rupture avec la neutralité jusque-là observée par la Tunisie sur ce contentieux intra-maghrébin. Au prix d’une crise avec le Maroc. En avril 2023, il a éconduit le FMI en adoptant une ligne du « compter sur soi ».
Mais depuis, Bachar el Assad est tombé et Téhéran est plus pressé de négocier la survie de son régime avec les États-Unis que de miser sur les maigres retombées d’une relation avec Tunis. Ce sont paradoxalement le pari américain sur la stabilité et sur la possibilité de renforcer la coopération sécuritaire ainsi que l’appui européen, notamment sous l’influence italienne, en contrepartie du contrôle de la migration clandestine, qui constituent la base géopolitique réelle du régime. Les ressources internationales qu’offrait le grand récit démocratique aux opposants tunisiens sont largement épuisées.
La relation à l’appareil sécuritaire
Dans ce registre, la différence est flagrante. Ben Ali était un pur produit de l’appareil sécuritaire. Il en partageait la culture et la vision, en connaissait toutes les arcanes et toutes les ruses. La symbiose entre le pouvoir politique et les forces de police était telle que le ministère de l’Intérieur apparaissait comme le pivot du régime. Cet « État policier » reposait sur un quadrillage étroit de la vie sociale, notamment à travers les cellules du RCD (le parti du pouvoir) et un réseau d’informateurs. Depuis l’indépendance, ce dispositif a permis, par l’intimidation ou la violence, voire l’usage systémique de la torture, la répression de toute contestation et de toute politisation dissidente.
Kaïs Saïed, lui, est totalement étranger à ce sérail et l’appareil policier dont il a hérité a paradoxalement renforcé sa position au cours de la transition démocratique. Délégitimé en 2011 par son rôle dans la dictature de Ben Ali, il a démontré son utilité grâce à la lutte contre le djihadisme et la création de syndicats de police l’a constitué en corporation. Au nom de la « police républicaine » érigée en principe, il a conquis une autonomie à l’égard du pouvoir politique. Fort de cette position renouvelée le corps sécuritaire a pu écarter toute forme de contrôle externe et garantir son impunité en échange de sa loyauté.
L’affaiblissement des contre-pouvoirs démocratiques permet aux forces de sécurité de débrider les penchants liberticides de Kaïs Saïed et à ce dernier de régler ses comptes. La paranoïa du Président est aisément manipulable par des services qui détiennent l’accès aux renseignements. Mais il s’agit d’une convergence d’intérêts : l’appareil sécuritaire n’est plus le prolongement de la présidence. Le pouvoir ne dispose plus du maillage de la société qui assurait son emprise. Même si le chef de l’État peut certes compter sur l’appui de la Garde nationale et de la Garde présidentielle, on n’est plus en présence d’un « régime policier ». Et la sortie de Kaïs Saïed du jeu politique ne transformera ni les mentalités ni les pratiques de l’appareil sécuritaire.
Les modalités de la répression
La répression sous le régime de Ben Ali, dans le prolongement de celui de Bourguiba, visait essentiellement les deux familles politiques qui contestaient son fondement idéologique et appelaient à étendre la rupture post-coloniale à l’ordre économique et social (pour l’extrême
gauche) et à l’ordre culturel (pour les islamistes). La répression s’élargissait par cercles concentriques à tous ceux qui militaient pour le respect des libertés et la police matait violemment toute rébellion populaire. Le recours à la torture était organiquement lié à la relation de l’État avec la société, mais les incriminations étaient prévisibles et les procès respectaient les formes. Ce qui ne rendait pas la répression plus légitime.
Le pouvoir de Kaïs Saïed ne veut plus éradiquer une idéologie ni une force politique cherchant à conquérir l’État, comme c’était le cas pour Ennahdha. Le pouvoir actuel traque les réseaux d’influence réels ou supposés qui contestent sa légitimité. Les incriminations sont arbitraires, souvent sans rapport avec la politique ; l’interprétation des faits pour établir l’existence de complots est inspirée par la paranoïa. La contrepartie paradoxale de cette méthode, c’est que la torture n’est plus nécessaire. En revanche, les procès n’ont plus besoin des faits et des formes extérieures de la légalité pour condamner. La vérité judiciaire est écrite ailleurs. Si Ben Ali était une sorte de super ministre de l’Intérieur imposant la toute-puissance d’un État démiurge, Kaïs Saïed serait plutôt une sorte de super procureur, qui dicte son récit avec l’aide d’une ministre de la Justice entièrement dévouée à sa cause. Les affaires sont instruites et les verdicts prononcés sur injonction, par des magistrats tenus par la crainte de sanctions, en dépit des garanties constitutionnelles classiques, puisque le chef de l’État s’est arrogé le droit de révoquer tout magistrat « en cas d’urgence, ou d’atteinte à la sécurité publique ou à l’intérêt supérieur du pays » en vertu du décret-loi du 1er juin 2022.
Tributaire des transactions partisanes, la transition démocratique a échoué à renouveler le corps des magistrats et à poser les bases structurantes d’une indépendance judiciaire pour rompre avec une longue tradition d’instrumentalisation politique. Ce discrédit et la persistance des habitudes ont facilité l’offensive de Kaïs Saïed pour transformer le « pouvoir judiciaire » en simple « fonction juridictionnelle» au service de son entreprise politique.
Un pouvoir sans parti
Le pouvoir du régime de Ben Ali, comme celui de Bourguiba, était relayé jusque dans le moindre espace de la société, les quartiers et les entreprises par la présence de cellules du parti de l’État (le Parti socialiste destourien sous Bourguiba, le Rassemblement constitutionnel démocratique sous Ben Ali). Il était à la fois instrument de surveillance, voie incontournable de la promotion sociale et réseau de redistribution clientéliste. Le pouvoir de Kaïs Saïed ne dispose de rien de tel. Les sociétés communautaires, censées porter un modèle économique alternatif mais, surtout, permettre l’accès des exclus du système économique aux ressources publiques (le financement, la terre, l’emploi…) peuvent jouer un rôle dans la constitution d’une base sociale du régime. Mais il s’agit d’un maillage beaucoup plus faible, sans fonction coercitive, aux ressources limitées.
La défiance de Kaïs Saïed à l’égard des partis politiques et le système d’élections par la base qu’il a institué a fait, en revanche, émerger une nouvelle génération politique. Ce nouveau personnel, à la différence des candidats cooptés par le parti quasi-unique sous l’ancien régime, ne doit pas sa position à sa loyauté à l’égard du pouvoir. Même s’il adhère au projet de Kaïs Saïed, il conserve une relative autonomie que certains députés commencent à exprimer en critiquant ouvertement les insuffisances du Président dans la réalisation de ses objectifs. Ce qui a valu au plus virulent d’entre eux, Ahmed Saïdani, d’être arrêté pour « offense » au chef de l’État, le 4 février. Cet espace d’autonomie contrôlé peut, à terme, contribuer à une dynamique de démocratisation.
L’affairisme, la faille du régime
Le discrédit de Ben Ali auprès de la majorité des Tunisiens devait surtout à la rupture du contrat moral qui compensait les difficultés sociales par une redistribution marginale plus ou moins « juste » des faveurs de l’État. Quand la belle famille de Ben Ali, les Trabelsi, a exhibé sans pudeur les signes de sa richesse accumulée en accaparant toutes les opportunités économiques lucratives, au mépris de toute règle légale et administrative, le fondement de la légitimité du régime – l’idée que l’État était au service de la construction nationale – s’est effondré. Le renouvellement de ce contrat social était le message implicite de la révolution. La transition a échoué sur ce point fondamental.
Kaïs Saïed a capitalisé sur cette frustration et doit son arrivée au pouvoir à son image d’intégrité. Sans lien avec les milieux de l’argent, rien dans son ethos n’indique en effet un rapport intéressé au pouvoir. Tout obsédé qu’il est par les complots, on ne lui conteste pas une forme de sincérité. En revanche, des rumeurs de favoritisme et de népotisme prospèrent sur son frère, Naoufel Saïed, et surtout sur la sœur de son épouse, Atka Chebil, décrite par sa rivale Nadia Akacha, ancienne directrice de cabinet de Kaïs Saïed aujourd’hui condamnée, comme de plus en plus influente au Palais présidentiel. Rien qui atteigne cependant l’ampleur et la visibilité de la prédation des Trabelsi, mais si ces rumeurs venaient à s’amplifier voire à se confirmer, l’effet pourrait être dévastateur pour la présidence de Kaïs Saïed alors que les Tunisiens continuent de voir leur situation se dégrader et les carences de l’État s’accumuler.
Les chantiers de l’après Kaïs Saïed
Le retour à une trajectoire démocratique suppose des transformations qui vont bien au-delà de la question du dirigeant : dépasser la figure du « peuple » comme abstraction rhétorique, asseoir la légitimité du personnel politique, réformer l’appareil sécuritaire et le système judiciaire, transformer le système qui permet la collusion des pouvoirs économique et politique, rechercher un modèle économique qui garantisse à la fois la redistribution et les conditions matérielles de la souveraineté, construire des relations internationales qui préservent l’indépendance des choix nationaux… Rouvrir la parenthèse de la révolution, comme le clamaient les manifestants du 14 janvier, ne pourra pas se limiter au départ de Kaïs Saïed. L’avenir de la Tunisie reste à inventer.