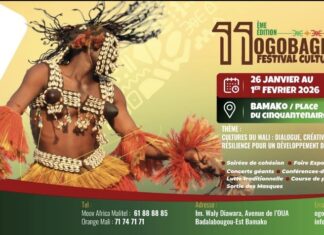Nabih Berri, silhouette indétrônable du Parlement libanais depuis plus de trois décennies, fascine et irrite. Figure de l’ombre, maître de l’équilibre et de la survie politique, il incarne à lui seul les paradoxes d’un Liban naufragé entre mémoire et pouvoir.
Le 31 mai 2022, dans une salle tendue du Parlement libanais, Nabih Berri est réélu pour un septième mandat consécutif à la présidence de l’Assemblée. À 84 ans (il en a aujourd’hui 87), le chef du mouvement Amal, allié indéfectible du Hezbollah, obtient 65 voix sur 128, un score modeste pour un homme habitué aux plébiscites, mais suffisant pour conserver ce trousseau de clés qu’il tient serré, littéralement, dans sa poche. Car au Liban, la clé du Parlement n’est pas une métaphore : c’est bien Nabih Berri qui verrouille, déverrouille, ouvre ou claque la porte de l’Assemblée au gré de ses humeurs. Ici, l’exercice du pouvoir ne s’embarrasse pas d’apparences : c’est lui, et nul autre, qui fait la pluie et le beau temps sur la scène politique. Le pays tangue, mais l’ordre du jour dépend, in fine, de son bon vouloir.
La scène, qui s’est jouée sous le regard désabusé d’une nation exsangue, a révélé, plus que jamais, la fracture entre une population éreintée et une élite indéboulonnable. Sur certains bulletins, des slogans : « Justice pour les victimes de l’explosion de Beyrouth », « Lokman Slim ». Protestations symboliques, qui s’abîment dans l’air moite de l’hémicycle, pendant que le maître des lieux, imperturbable, orchestre la partition d’une politique sans surprise — et sans partage.
Pour comprendre la nature du pouvoir au Liban, il faut s’arrêter sur la trajectoire de Nabih Berri, fils d’émigrés du Sud, né en 1938 dans la moiteur de la Sierra Leone, loin des vergers du Liban méridional. Le hasard de l’exil, déjà : ses parents, comme tant d’autres, fuyant la précarité d’une terre déshéritée. Le diamant, ensuite : la fortune, le commerce, l’Afrique comme horizon. On devine, dans cette enfance partagée entre l’éloignement et la nostalgie, les racines d’un destin singulier, une mobilité féconde, qui façonnera un homme d’entregent, maître du compromis et du réseau, plus négociant que prophète.
Ce goût du jeu et des alliances, Berri l’a poli à l’université, d’abord à Beyrouth, puis sur les bancs de la Sorbonne. De la France, il gardera le goût du droit, mais surtout la conviction que la politique, au fond, n’est qu’une question de rapport de force, de narration et d’habileté rhétorique. C’est dans les années 1970, alors que le Liban s’enfonce dans la guerre civile, qu’il rejoint Amal, le mouvement des « déshérités » fondé par l’imam charismatique Moussa Sadr, mystérieusement disparu en Libye en 1978. Deux ans plus tard, Nabih Berri hérite d’un parti blessé mais stratégique, tremplin idéal pour celui qui rêve déjà d’une influence qui ne se limite pas à la banlieue sud.
De la guerre à l’État
Les années de plomb forgent les leaders à coups de tragédie et d’opportunité. Dans le chaos de la guerre civile, Berri s’impose, non comme un chef de milice flamboyant, mais comme un habile manœuvrier. Aux yeux des Libanais, il incarne l’intelligence de la survie : tantôt l’allié de la Syrie tutélaire, tantôt l’interlocuteur des grandes familles sunnites et chrétiennes, tantôt le rival, puis l’allié du Hezbollah. Il fait feu de tout bois, comme un général qui choisit la bataille à mener, et celle à différer.
La « guerre des camps » (1985-1988) reste l’une des pages les plus sombres de son histoire : les miliciens d’Amal, sous sa direction, affrontent les troupes palestiniennes fidèles à Yasser Arafat, au nom d’une logique d’alignement sur Damas. Plus tard, c’est contre Israël, puis contre les contingents occidentaux, qu’il engage ses hommes. Mais la guerre, au Liban, n’est jamais tout à fait finie, jamais vraiment tranchée. Berri le sait, lui qui deviendra, à la faveur des accords de Taëf, l’un des artisans de la transition, passant sans effort apparent du treillis au costume de ministre.
Cinq fois ministre, il accumule portefeuilles et réseaux, jusqu’à se hisser, en 1992, à la présidence du Parlement, fonction réservée aux chiites, dans un Liban en proie à la mécanique complexe du confessionnalisme. Il ne la quittera plus. Les années passent, les majorités changent, la Syrie se retire, les vents d’instabilité soufflent, mais Berri tient bon, immuable, comme si le fauteuil lui était dû.
Le vrai Premier ministre
On dit parfois, au Liban, que le président préside, que le Premier ministre gouverne… mais que c’est le président du Parlement qui tranche. Un adage qui sied à merveille à Nabih Berri. Lui seul dispose de la clé – physique, concrète, précieuse – du Parlement. Lui seul décide si la République doit fonctionner, ou s’accorder une pause. Quand la crise menace, il temporise ; quand il faut une porte de sortie, il orchestre le compromis. Chef d’orchestre ou gardien du temple ? À Beyrouth, nul ne s’y trompe : c’est bien lui, le vrai maître de l’agenda, le faiseur de roi, celui qui tient les rênes du jeu.
Son pouvoir ? Un mélange de ruse, de patience et de mémoire. Il a l’art de la manœuvre, l’humour grinçant qui désamorce tout, et cette capacité presque théâtrale à paraître incontournable. Derrière ses boutades et ses éclats de voix, il gouverne sans gouverner, décide sans décider, fait et défait les alliances à son rythme. La pluie, le beau temps, et même les orages d’été passent d’abord par lui.
Richesse, famille, et Madame 51 %
On ne saurait évoquer Nabih Berri sans parler de fortune. L’homme, que ses détracteurs accusent de s’être enrichi à l’ombre du pouvoir, cultive un train de vie princier qui ferait pâlir plus d’un ministre des Finances. On murmure qu’il pèserait plusieurs milliards – deux, peut-être trois ? – et qu’il possède une galaxie d’intérêts, entre commerce, banques et investissements en Afrique. Il s’en défend, attribuant sa prospérité à la sagacité de sa famille et à ses affaires légitimes, héritage des années diamantaires au Sierra Leone.
Mais la dynastie Berri ne serait pas complète sans la figure de la très influente Randa Berri, surnommée « Madame 51 % » – un clin d’œil, non dénué d’ironie, à sa réputation d’actionnaire invisible et omniprésente. Car au Liban, l’économie politique se joue souvent à huis clos, entre maris puissants et épouses stratèges. Madame Berri, que certains qualifient de véritable bras armé du président, sait défendre ses parts et ses intérêts dans les arcanes du business libanais, parfois avec une efficacité redoutable. Là encore, la famille s’invite dans la République, et les affaires privées fusionnent, sans pudeur, avec les affaires publiques.
Le revers de la médaille, bien sûr, n’échappe à personne. Nabih Berri cristallise aussi la rancœur d’un peuple épuisé par la corruption, le clientélisme, l’immobilisme. On le dit milliardaire, protecteur d’un système où les prébendes se transmettent plus sûrement que les idées. Ses détracteurs voient en lui l’incarnation d’une classe politique verrouillée, qui survit en entretenant la paralysie.
Et pourtant, l’homme dégage une forme de nostalgie. Comme tous les grands survivants, il porte en lui les blessures du pays : l’exil, la guerre, la perte, mais aussi la conviction que le Liban, malgré tout, vaut la peine qu’on se batte pour lui. Dans ses discours, il aime rappeler sa fierté d’avoir « fondé la résistance contre Israël », de défendre « les frontières terrestres et maritimes » face aux agressions. Un patriotisme sans fard, sans illusions, à mille lieues du romantisme, mais animé d’une gravité réelle.
La solitude du survivant
Au fond, Nabih Berri ressemble à ce Liban paradoxal, à la fois fatigué et indestructible, résilient et prisonnier de ses chaînes. Grand de taille, le verbe haut, il traverse les décennies comme on traverse une mer démontée : sans jamais tomber, sans jamais s’arrêter. Il a vu passer tous les espoirs déçus, tous les printemps inaboutis, toutes les crises qui auraient dû le renverser. À chaque fois, il a trouvé une issue, un compromis, un nouvel ennemi à désigner.
Il est le produit d’une époque, d’un système, d’une histoire qui n’a pas su, ou pas voulu, trancher dans le vif. À ceux qui réclament son départ, il répond par l’attente, sûr que l’alternative serait pire — ou qu’elle viendra, de toute façon, trop tard.
À 87 ans, Nabih Berri n’ignore rien de la lassitude qui gronde, du désir de renouvellement, du souffle court d’une jeunesse privée d’avenir. Mais il sait aussi que le Liban est un pays où le temps se mesure en catastrophes plus qu’en révolutions. Alors, il continue, fidèle à lui-même et à ses méthodes éprouvées. Faiseur de rois, gardien des clés, expert en immobilisme créatif. Le soleil peut bien se lever à l’est ou à l’ouest : au Liban, la météo dépend, in fine, de son bon vouloir.
À la sortie de l’hémicycle, Nabih Berri referme la porte à double tour, lâche une dernière boutade, puis s’éloigne d’un pas tranquille, après tout, pourquoi se presser ? Au Liban, les mythes ont l’éternité devant eux, surtout quand ils détiennent la clé du Parlement.