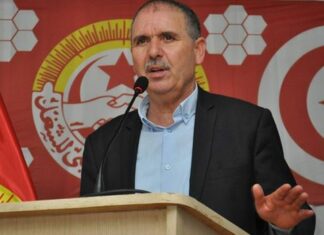Bill Bazzi, l’ambassadeur choisi par Donald Trump, prend ses fonctions à un moment où les États Unis redéfinissent les équilibres régionaux dans lesquels la Tunisie est de plus en plus isolée.
Selim Jaziri
La « Pax Americana » passera-t-elle par Tunis ? Bilal « Bill » Bazzi, le nouvel ambassadeur des États-Unis à Tunis, a remis le 21 novembre ses lettres de créances à Kaïs Saïed. Donald Trump l’avait désigné en mars dernier pour succéder à Joey Hood. Un choix très politique, puisque ce chiite, originaire du Sud-Liban, ancien Marine et maire d’une ville du Michigan, avait soutenu le candidat républicain lors de l’élection présidentielle. C’est aussi un proche du conseiller de Massad Boulos, lui aussi libanais, conseiller du Président pour les affaires arabes. Auditionné par la commission des affaires étrangères du Sénat le 3 septembre, il a été nommé au terme d’un vote très polarisé (par 51 voix contre 47).
Pour l’heure sa prise de fonction n’a pas donné lieu à des déclarations fracassantes, il s’est borné, lors de son audition au Sénat, à évoquer « l’importance de développer des partenariats dans la lutte contre le terrorisme, la maîtrise de l’immigration illégale et la promotion du commerce ». Mais il prend ses fonctions dans un moment où les États-Unis réaffirment leur prépondérance dans la redéfinition des équilibres régionaux.
Donald Trump est parvenu à faire endosser par le Conseil de sécurité des Nations unies sa main mise sur le processus de reconstruction et de « sécurisation » de la bande de Gaza, en coopération avec Israël. Même l’Algérie, lors du vote, n’a eu d’autre choix « pragmatique » que de voter la résolution 2803, le 18 novembre.
Trump à la manoeuvre
De même, Washington est à la manœuvre pour clore la question sahraouie sur la base de la position marocaine en faveur de l’autonomie. Là encore, isolée, l’Algérie n’a même pas voté contre la résolution du Conseil de sécurité, du 31 octobre. Elle s’est contentée de ne pas prendre part au vote. Sous pression de l’administration américaine pour rentrer dans le rang, Alger dernier bastion du « Front du refus », semble prêt à transiger avec ses principes pour préserver un rôle régional. Son ambassadeur aux États-Unis, Sabri Boukadoum, est même allé jusqu’à répondre, concernant une normalisation des relations avec Israël, que « tout est possible ».
Enfin, les États-Unis travaillent à un arrangement entre les deux pouvoirs libyens de Tripoli et Benghazi, en s’appuyant sur les fils du maréchal Haftar. La Tunisie, qui, un temps, a servi de relais à l’Algérie pour contrebalancer l’influence égyptienne derrière Khalifa Haftar, n’a plus son mot à dire.
Dans ces conditions, on voit mal de quelle marge de manœuvre disposera Tunis, placée dans l’orbite algérienne, pour préserver une autonomie diplomatique. Les tentatives pour diversifier les alliances stratégiques, avec la Chine, la Russie, n’ont jusqu’à présent aucune traduction concrète. Même le rapprochement avec l’Iran, sur la défensive, reste pour le moment de l’ordre symbolique.
Les éléments structurants de la position internationale de la Tunisie demeurent inchangés : son principal partenaire commercial reste l’Union européenne, l’armée est intégrée de longue date dans le dispositif stratégique américain, et l’Arabie saoudite contribue à combler le déficit budgétaire. Quant au voisinage algérien, plus pressant que jamais depuis la conclusion d’un accord de défense et le soutien politique, énergétique et monétaire au régime de Kaïs Saïed, on le voit, il pèsera de moins en moins lourd pour préserver une voie internationale indépendante.