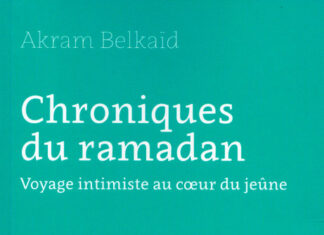Dix ans après, la blessure du 13 novembre 2015 reste vive, qui résonne chez notre ami et critique musical, Nidam Amdi, comme une question obsédante : comment la musique, cet espace universel de fête, de liberté et d’échange, a-t-elle pu devenir une cible idéologique pour de jeunes Français et Belges musulmans ?
Nidam ABDI, critique musical
Ce drame dit-il quelque chose d’une rupture dans la transmission de l’histoire et de la culture d’un islam cosmopolite dont Paris fut longtemps l’une des capitales ? La décision récente du Bangladesh de renoncer à recruter des professeurs de musique sous la pression islamiste, ou encore le procès intenté contre Google par des parents américains dont la fille est morte dans les attentats du 13 novembre, rappellent que ce combat pour l’âme de la musique est loin d’être terminé.
Dix ans que la mélodie s’est brisée, que l’écho du Bataclan se mélange à un silence saturé de questions. La plus insistante : comment en est-on arrivé là ? Comment des jeunes, grandis entre la France et l’héritage familial, ont-ils pu voir dans la musique, la fête, le vivre-ensemble, des blasphèmes méritant la mort ?
Pour tenter d’y répondre, il faut s’éloigner du lieu du drame et revenir à l’histoire du Bataclan lui-même, mais aussi à celle de Paris — cette ville qui fut, depuis la Seconde Guerre mondiale, l’un des creusets majeurs de la musique arabe.
Paris, capitale oubliée de la musique arabe
Ce rôle méconnu, que l’histoire officielle a souvent voulu effacer, doit beaucoup à une amitié exceptionnelle : celle de deux producteurs, l’un musulman, l’autre juif.
Si Soulimane, décédé dans un quasi-anonymat le 15 juillet dernier, fut l’ami des géants Oum Kalthoum et Abdel Halim Hafez. À ses côtés, son ami de toujours, le musicien et producteur Kahlaoui Tounsi, proche de Farid El Atrache et des grandes vedettes maghrébines des années 1960-70.
Inséparables depuis les Trente Glorieuses, ils ont façonné l’âge d’or des musiques orientales à Paris. Le Bataclan fait partie de cette histoire : la rumeur veut que Farid El Atrache ait aidé Kahlaoui Tounsi à en devenir propriétaire dans les années 1970. À cette époque, Tounsi dirigeait déjà l’un des plus grands orchestres orientaux, accompagnant des stars dans les salles mythiques de la capitale, de l’Olympia au Palais des congrès.
Ce lieu de fête, devenu théâtre d’horreur le 13 novembre, était donc aussi un symbole puissant du cosmopolitisme musical qui a longtemps caractérisé l’islam de France.
Islam et musique : une transmission interrompue
Si cette amitié judéo-musulmane, fondatrice de la culture orientale parisienne, est tombée dans l’oubli, c’est peut-être parce que la racine du drame du 13 novembre est un problème de transmission.
Contrairement aux représentations actuelles, l’islam n’a pas toujours été hostile à la musique. Au XIXᵉ siècle, l’orientaliste Armand Caussin de Perceval rédigea une étude majeure sur la pratique musicale en Arabie à l’époque du Prophète. Sauvé par son élève Charles Defrémery et publié en 1873 dans Le Journal Asiatique, ce texte, véritable recueil sur les musiciens des premiers siècles de l’hégire, rappelle qu’aux origines, musique et chant faisaient pleinement partie de la vie sociale — à l’opposé des anathèmes lancés aujourd’hui par les extrémistes.
Mais ce savoir n’a pas été transmis. Et c’est dans ce vide que les récits de haine se sont engouffrés.
Quand les algorithmes enseignent la haine
Aujourd’hui, la menace ne vient plus seulement de l’oubli, mais de la saturation numérique. Des enfants, des adolescents peuvent être radicalisés sur un smartphone. Ce danger, la famille de Nohemi Gonzalez, jeune étudiante américaine d’origine mexicaine, l’a affronté de plein fouet.
Malgré les obstacles — dans une Amérique où les bourses pour étudier en Europe sont captées par les classes aisées — Nohemi avait décroché les moyens d’intégrer Strate, grande école de design de Sèvres. Elle a été fauchée sur une terrasse parisienne le soir du 13 novembre.
Ses parents ont porté plainte jusqu’à la Cour suprême, accusant Google et YouTube d’avoir contribué à la diffusion de la propagande djihadiste. En 2023, la Cour a refusé de remettre en cause l’immunité des plateformes. Mais la question demeure :
qui porte la responsabilité de la pédagogie de la haine, enseignée à la vitesse d’un algorithme ?
Du Bangladesh à Montmartre
Le péril est toujours là. Au Bangladesh, le gouvernement nous on donne un exemple, cédant aux pressions islamistes pour qui cet art est « haram ». Cette interdiction dans le système éducatif d’enseigner la musique est un pas supplémentaire vers l’obscurantisme : une manière d’étouffer l’âme même d’une culture.
Et pourtant, c’est à Paris, en haut de Montmartre, que vivait Deben Bhattacharya, immense collecteur des musiques du Bangladesh. Dans les dernières années de sa vie, il a enregistré certaines des plus belles mélodies de ce pays. Il avait choisi Paris comme refuge : preuve supplémentaire de la vocation musicale universelle de cette ville.
Paris, laboratoire du désir musical
Nous avons le devoir de comprendre ce qui a été perdu — et ce qui doit être reconstruit. Le Bataclan n’était pas seulement une salle de concerts : il rassemblait une histoire oubliée, celle d’une amitié judéo-musulmane, du rôle central de Paris dans les cultures orientales et d’un islam qui n’a jamais interdit l’art ni le chant.
Le 13 novembre nous apprend que la lutte contre la radicalisation est aussi une lutte culturelle et pédagogique. Paris n’est pas seulement une ville-monde : elle doit redevenir un centre de transmission, un lieu où aucune musique ne peut être frappée d’interdit, un espace où l’on enseigne les chants de Médine comme les récits de Si Soulimane et Kahlaoui Tounsi, ou le combat des parents de Nohemi Gonzalez.
Honorer les victimes, dix ans après, c’est refuser que l’obscurantisme gagne la bataille des esprits.
C’est laisser la musique résonner à nouveau au cœur de Paris.