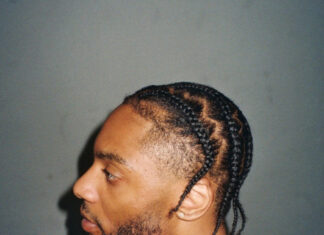Sous couvert de refondation souverainiste, le régime militaire d’Abdourahmane Tiani s’est mué en système absolutiste et népotique. Les révélations du Dr Seyni Ganda et du journaliste Hamid Amadou N’Gadé lèvent le voile sur une dérive politique, économique et morale sans précédent depuis l’indépendance. Entre arbitraire, prédation et effondrement budgétaire, le Niger s’enfonce dans une crise d’État totale.
Mohamed AG Ahmedou, Journaliste et analyste des dynamiques sahélo-sahariennes
Deux ans après le coup d’État du 26 juillet 2023, le Niger vit sous l’empire d’un seul homme : le général Abdourahmane Tiani.
Arrivé au pouvoir sans effusion de sang, il règne désormais comme un souverain sans loi ni contre-pouvoir.
« Il se comporte comme Alexandre le Grand ou Gengis Khan », écrit le Dr Seyni Ganda, universitaire et essayiste nigérien, dans un texte au vitriol intitulé Une dérive absolutiste.
Et de constater : « Il est le seul chef d’État sur terre qui, en plus des pouvoirs traditionnels d’un exécutif, cumule les pouvoirs législatif et judiciaire. Sa volonté fait office de loi. »
Des prisons d’État et un silence imposé
Ce constat glaçant illustre le cœur du régime Tiani : un pouvoir sans Constitution, sans Parlement, sans serment, sans garde-fou.
Le général rédige seul ses ordonnances, les promulgue sur les réseaux sociaux et nomme à sa guise les plus hautes autorités du pays.
Ainsi, il a maintenu quatre magistrats à la retraite pour leurs liens avec son entourage, et radié deux syndicalistes avant de modifier la loi rétroactivement pour justifier sa décision.
« Une manipulation grossière », dénonce encore le Dr Ganda, rappelant que même sous la dictature de Seyni Kountché, les militaires respectaient encore les formes républicaines.
Mais le signe le plus emblématique de cette personnalisation du pouvoir demeure la Charte de la Refondation, texte fondateur imposé après des “Assises” vidées de sens.
Sans consultation, Tiani y a introduit une clause élevant le haoussa, sa langue maternelle, au rang de langue nationale.
Un geste jugé méprisant envers le plurilinguisme nigérien, symbole d’un nationalisme identitaire et exclusif.
Ce pouvoir absolu s’accompagne d’une répression silencieuse.
L’ancien président Mohamed Bazoum et son épouse sont détenus arbitrairement depuis plus de deux ans.
L’ancien ministre du pétrole Barké, le directeur de la Somaïr ou encore le ministre de l’intérieur Hamadou Souley ont connu le même sort, malgré des décisions de justice ordonnant leur libération.
Les jugements sont ignorés, les magistrats intimidés, les libertés suspendues.
Le Niger vit désormais sous un régime de détention à volonté, où l’État de droit est dissous dans la volonté d’un général.
Le naufrage économique : un pays au bord du gouffre
Si le coup d’État a réduit au silence les institutions, il a aussi asphyxié l’économie.
En 2023, le budget national atteignait 3 200 milliards de francs CFA.
En 2025, il chute à 2 700 milliards, malgré les 100 000 barils de pétrole exportés chaque jour depuis 2024.
Une perte sèche de 500 milliards, que le Dr Seyni Ganda compare à un « effondrement budgétaire sans précédent ».
Selon lui, le Niger a perdu plus de 860 milliards de ressources potentielles depuis le putsch, en raison de la suspension de l’aide extérieure et de la désorganisation des finances publiques.
Les conséquences sont lourdes :
arrêt du barrage de Kandadji, faillite d’entreprises, licenciements massifs,
crise de liquidités bancaires, dette intérieure colossale et retards chroniques de paiement des salaires des fonctionnaires.
Dans les rues de Niamey, le désespoir se mêle à la colère.
La fermeture prolongée de la frontière avec le Bénin, décidée par Tiani au nom d’une “souveraineté retrouvée”, a étranglé le commerce transfrontalier.
Et la suspension du secteur de l’uranium, moteur historique de l’économie nigérienne, a frappé au cœur même des recettes publiques.
« Tiani a détruit le tissu économique du pays de façon méthodique », résume le Dr Ganda.
Les affaires sales du clan Maidaji
Au centre du système Tiani, un nom revient sans cesse : le colonel Maidaji, son aide de camp, bras droit et exécuteur du putsch.
Les enquêtes menées par le Dr Ganda et le journaliste Hamid Amadou N’Gadé révèlent l’existence d’un réseau de prédation économique construit autour du colonel et de son entourage familial.
L’entreprise Kibiya Solutions, créée le 7 septembre 2023, un mois après le coup d’État, en est le symbole.
Officiellement dirigée par Abdoulaye Harouna Rachid, elle appartient en réalité à Issa Ibrahim Daoura, beau-fils de Maidaji.
Ses activités couvrent tous les domaines : équipement militaire, forages, énergie, marketing, nettoyage industriel…
Une omniprésence qui trahit une logique d’accaparement total.
Les marchés publics remportés par Kibiya Solutions défient toute transparence : 81 millions de francs CFA pour le nettoyage des résidences de l’ancien président Issoufou Mahamadou, réglés directement par la présidence ; plus d’un milliard de francs CFA pour des effets d’habillement militaire, dont 330 millions d’avance versés sans appel d’offres ni TVA. Le ministre de la Défense, le général Salifou Modi, numéro deux de la junte, apparaît dans le dossier comme complice et bénéficiaire du dispositif. « On comprend alors que ces militaires n’ont pas pris le pouvoir pour sauver le pays, mais pour s’emparer de ses ressources », résume Ganda.
Dans le même temps, le peuple nigérien est mis à contribution forcée. Le régime a instauré le Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (FSSP), un prélèvement obligatoire jusque sur les écoliers. Hamid Amadou N’Gadé le rebaptise avec ironie “le fonds de l’aigle voleur”, symbole d’un État qui dépouille ses citoyens au nom de la patrie.
Refondation ou confiscation ?
Le discours officiel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) prétend restaurer la dignité du Niger face aux puissances étrangères.
Mais les faits montrent l’inverse : sous le drapeau de la souveraineté, le pays s’est enfoncé dans la dépendance et la régression.
La gouvernance par ordonnances, la corruption systémique et l’isolement diplomatique ont transformé la “refondation” en une captation totale de l’État par un clan militaro-familial.
Le modèle nigérien, loin d’être une alternative à l’ordre ancien, en devient le miroir grossissant : un système autoritaire où la “résistance” n’est qu’un masque pour le pillage.
Le réveil des consciences
Dans ce climat de peur et de censure, les voix du Dr Seyni Ganda et de Hamid N’Gadé résonnent comme un acte de résistance intellectuelle.
Le premier, universitaire rigoureux, dissèque les rouages d’un absolutisme naissant ; le second, chroniqueur incisif, met en lumière la misère d’un peuple trompé par la propagande souverainiste.
Tous deux rappellent une évidence : la souveraineté ne se décrète pas en uniforme, elle se construit dans la justice, la vérité et la responsabilité.
Le Niger, aujourd’hui pris entre l’arbitraire d’un pouvoir militaire et l’effondrement d’un État, semble rejouer le même drame que ses voisins sahéliens : celui d’une indépendance confisquée par ceux-là mêmes qui prétendaient la défendre.
“Le pouvoir absolu corrompt absolument” La formule, souvent citée, prend tout son sens à Niamey. En concentrant entre ses mains toutes les fonctions régaliennes, en muselant la presse, en manipulant le droit et en transformant l’administration en patrimoine personnel, le général Tiani s’est érigé en roi sans Constitution. Loin d’une refondation, son régime apparaît comme une contre-révolution de la médiocrité et du clanisme.
L’histoire retiendra que, dans ce chaos, quelques voix ont refusé la peur et l’oubli.
Elles rappellent que la véritable refondation du Niger ne passera ni par les casernes, ni par les réseaux d’affaires familiaux, mais par le retour du droit, de la transparence et de la justice — seules fondations possibles d’une République digne de ce nom.