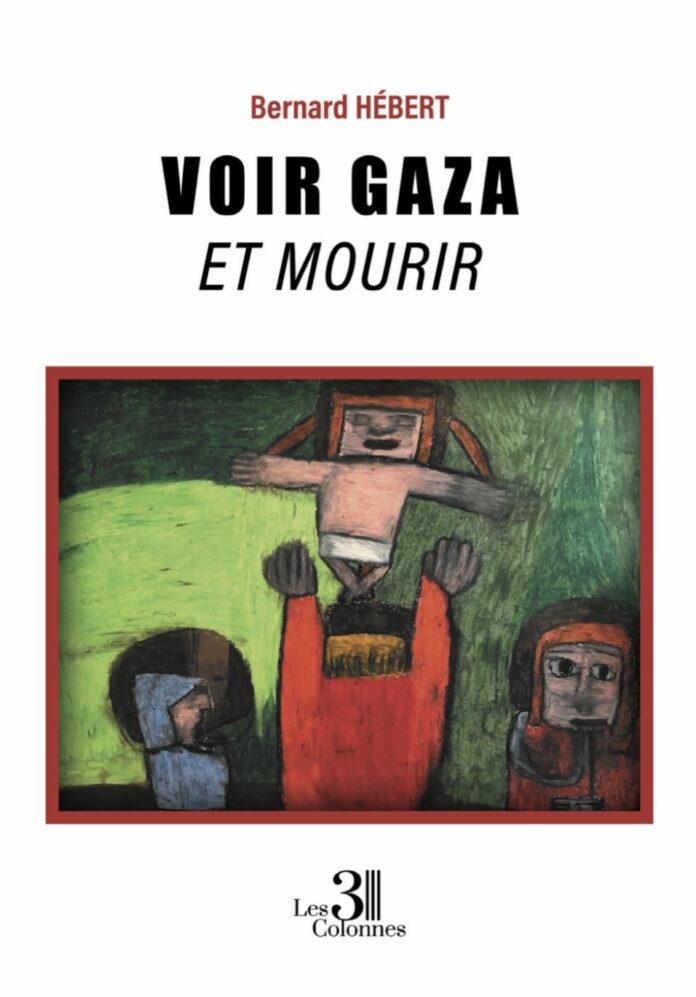Dans « Voir Gaza et mourir », Bernard Hébert livre un roman dont la force n’est pas seulement littéraire mais historique, archéologique, profondément humaine. Une fresque où l’intime et le politique s’entremêlent, et où la fiction, loin d’enjoliver, fouille la réalité au scalpel.
Il arrive que la littérature s’empare d’un sujet si brûlant, si obstinément tragique, qu’elle s’apparente à un acte de courage. C’est le pari, réussi, de Bernard Hébert avec « Voir Gaza et mourir », roman ambitieux et grave, qui traverse l’Histoire, les frontières et les consciences avec la précision d’un chirurgien – ce que l’auteur a d’ailleurs été, Médecin sans frontières, arpenteur de terrains où l’excès de réalité menace toujours de submerger la fiction. Dans ce livre, rien n’est décoratif : chaque page, chaque dialogue, chaque paysage tendu de douleurs anciennes, éclaire la complexité du Proche-Orient et, au-delà, la ténacité de la quête humaine de vérité.
Le roman s’ouvre à Jérusalem, ville-monde, ville-fossile, ville en guerre avec elle-même, où trois archéologues, figures d’une humanité inquiète, cherchent – littéralement – à exhumer la vérité. Ce sont des passeurs : leur regard perce les couches du temps, scrute les sédiments d’un passé que la violence ne cesse de brouiller. Leur quête – la découverte d’un manuscrit ancien – pourrait n’être qu’un prétexte à l’aventure ; elle devient ici une opération à cœur ouvert sur l’Histoire, celle d’une Palestine que les récits officiels, bibliques ou politiques, n’ont cessé de dissimuler sous la poussière des siècles.
Le livre se distingue d’emblée par sa rigueur documentaire. Hébert, nourri de lectures et d’expériences de terrain, recompose l’odeur du souk, la lumière crue du désert, le silence de Jérusalem pétrifiée par l’attaque du Hamas. Mais ce réalisme n’est jamais plat ; il ouvre sur l’abîme d’une question obsédante : que savons-nous vraiment du passé ? Et qu’est-ce qu’une vérité historique dans une région où chaque pierre est contestée, chaque souvenir menacé de falsification ?
Dès les premières pages, le lecteur est happé par la tonalité intérieure du narrateur, ce mélange de lassitude et d’ironie triste, dont témoigne cet aveu :
« J’ignorais tout encore de l’assaut du Hamas et j’avais décidé de consacrer les dernières heures de mon voyage en Israël à faire du shopping. Mes recherches se soldaient par un lamentable fiasco, dans deux jours je rentrerais bredouille à Paris et je voyais déjà la tête qu’allaient faire Michel et Gérard, déçus de me voir revenir les mains vides.
Le début de cette histoire prometteuse sur le point de se terminer de façon si pitoyable remontait à quelques mois et le but avoué de mon voyage était une visite chez un oncle et une tante installés depuis trente ans dans un kibboutz au sud d’Israël. Mais en fait je partais à l’aventure et, muni de mon double passeport, j’avais envie de m’initier aux réalités de ce pays étrange qui m’avait accordé la nationalité israélienne sans que je n’y aie jamais résidé. J’avais envie de voir le soleil et de comprendre la fureur qui se dresse depuis un demi-siècle entre les Arabes et les Juifs. »
Ici déjà, le regard n’est jamais extérieur, jamais totalement neutre : c’est la voix de celui qui cherche sans certitude, et qui devine derrière la banalité des courses ou la nostalgie familiale le grondement de l’Histoire.
Humanité en suspens
Ce n’est pas un roman d’aventure, ni un traité d’histoire. C’est un livre où la fiction assume sa fragilité, où les personnages doutent, échouent, reculent parfois devant l’ampleur de la tragédie. Les dialogues et la pesanteur de l’attente en Israël sont restitués sans effets, comme dans cette scène où la violence imminente pèse sur les gestes les plus ordinaires : « Le plus urgent était de partir avant que n’éclatent les premières bombes et mettre mon trésor à l’abri. Je réglai ma note et montai faire ma valise, une valise bien légère, les trois rouleaux du vieux juif constituant l’essentiel de mon bagage puis j’errai de bar en bar en attendant l’heure de l’embarquement. L’atmosphère était lourde, les visages crispés et ce que je comprenais des conversations laissait deviner le désarroi, la haine et un désir de vengeance que je ne partageais pas. Un ivrogne qui parlait hébreu avec un fort accent d’Europe centrale, tenta de me prendre à partie et je pensai que le teint bistre de mon visage lui faisait croire que j’étais Palestinien. Mais je refusais de répondre à ses invectives, j’étais trop triste et me sentais trop démuni pour discuter de la tragédie qui venait de s’abattre sur la Palestine, ni pour prendre à moi seul la défense des réfugiés de Gaza menacés par un génocide annoncé et une mort presque probable. Je fus lâche et pour éviter d’affronter la meute, je réglai ma consommation et traversai la rue pour aller me réfugier dans le hall de l’Hôtel Ibis encombré de journalistes et de touristes, comme moi esseulés dans l’attente d’un avion. »
Ce passage dit tout : la fatigue, la peur, la tentation du repli, l’impuissance devant la tragédie collective. Le roman, ici, ne cherche jamais à faire la leçon : il donne à voir, à ressentir, cette humanité empêtrée dans la douleur et le doute.
Le style de Bernard Hébert se distingue par sa sobriété lyrique, une manière de creuser la langue sans la surcharger. Il écrit avec le scalpel du médecin, disséquant les affects, sondant les ombres, mais aussi avec la plume du romancier : les dialogues sonnent juste, les scènes collectives prennent la densité d’une tragédie antique. On songe parfois à certains grands écrivains de la région qui, de l’intérieur du chaos, savent faire entendre la polyphonie d’un peuple et la solitude de l’individu.
Mais c’est sans doute dans sa description des lieux – Jérusalem, Gaza, Éphèse – que le roman atteint sa densité poétique. La ville n’est pas un décor, mais un personnage à part entière, hanté de mémoires, traversé de fantômes. Chaque ruelle, chaque pierre semble raconter sa propre histoire, composer la longue litanie d’un deuil sans fin.
« Voir Gaza et mourir », loin d’être un livre neutre, se lit comme une prise de position et comme une invitation à la nuance. L’auteur rappelle – à rebours des lectures hâtives – que la guerre n’est jamais un accident surgissant du néant, mais l’aboutissement de décennies de spoliations, d’humiliations et de récits concurrentiels. On pourrait se demander à quoi sert la littérature face à tant de violences. Pourquoi écrire, pourquoi lire, alors que la réalité pulvérise toute tentative de compréhension ? Bernard Hébert répond à sa manière : la littérature ne sauve pas, mais elle résiste à la fatalité. Elle porte la mémoire des vaincus. Elle donne la parole à ceux que l’histoire officielle condamne au silence.