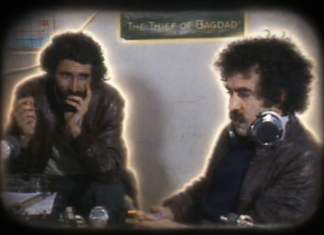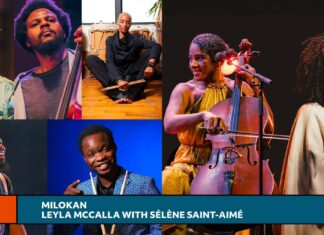Il est des figures qui, par leur simple volonté d’exister politiquement, deviennent le révélateur des failles d’un système. En République centrafricaine, Anicet Georges Dologuélé est aujourd’hui ce miroir tendu à une nation en quête de cohérence.
Jadis incontestée, sa nationalité centrafricaine qu’il aurait perdue en devenant français est désormais brandie comme une arme politique. Ce qui se joue autour de lui dépasse sa personne : c’est la démocratie elle-même qui vacille.
Une candidature qui dérange
Contre toute attente, Dologuélé a déposé sa candidature à la présidentielle, muni de tous les documents requis. Aucun texte ne l’avait déclaré apatride. Pourtant, à peine sa candidature enregistrée, le Tribunal de Grande Instance de Bangui, saisi par le procureur, annule son certificat de nationalité. Motif : il aurait perdu sa nationalité centrafricaine en devenant Français en 1994.
Ce coup de théâtre survient après une lettre adressée au Président Touadéra, dénonçant un acharnement politique. La réponse du Directeur de Cabinet, transmise “sur instruction du Président”, confirme ce que beaucoup redoutaient : l’affaire est devenue une manœuvre politique.
Une élimination par le droit
Comment un homme qui fut député, ministre, Premier ministre et candidat en 2020 peut-il être soudainement déclaré non centrafricain en 2025 ? La réponse n’est pas juridique, elle est stratégique. Derrière cette décision se profile une volonté d’éliminer un adversaire sans passer par les urnes.
Dologuélé incarne une rare stabilité dans un paysage politique fragmenté. Son éviction redessinerait les équilibres d’une élection déjà sous tension.
Ce n’est pas seulement l’affaire d’un homme. C’est celle de milliers de Centrafricains binationaux, qui vivent désormais dans la crainte d’être considérés comme des citoyens de seconde zone. Dologuélé lui-même l’a souligné : « J’étais candidat il y a cinq ans. Pourquoi n’a-t-on pas trouvé que je n’étais plus centrafricain ? Maintenant que je ne suis plus Français, on fait de moi l’unique apatride de l’histoire du pays. » Son combat devient celui de tous ceux que la loi de 1961 exclut ou divise. Une loi obsolète, utilisée comme outil d’exclusion politique.
Une justice sous pression
L’ordonnance du tribunal, rendue sans audience publique ni débat contradictoire, interroge. À la veille d’une présidentielle, peut-on encore croire à l’indépendance de la justice ? Le sentiment d’un procès politique déguisé en procédure administrative s’installe, minant la confiance des citoyens.
Dologuélé est devenu un test : celui de la solidité du système judiciaire, de la sincérité du processus électoral, de la maturité démocratique. Face à l’appareil étatique, il défend un principe fondamental : l’égalité devant la loi. S’il est écarté, c’est le droit qui chancelle. S’il reste, c’est la justice qui respire encore.
Une loi qui fracture la nation
La question de la nationalité ne peut plus être traitée comme une affaire individuelle. Elle divise, marginalise, fragilise. Dans un pays où tant de cadres et responsables ont la double nationalité, le risque d’une fracture identitaire est réel. Et cette fracture est visible jusqu’au sommet de l’État. Plusieurs ministres, conseillers et hauts fonctionnaires sont binationaux. Le contraste avec le traitement réservé à Dologuélé nourrit un sentiment d’injustice et révèle une application sélective de la loi.
Et si Dologuélé n’était que l’arbre qui cache la forêt ? Son cas révèle une peur du pouvoir face à toute alternative crédible. Derrière cette exclusion, c’est le verrouillage du débat démocratique qui se joue.